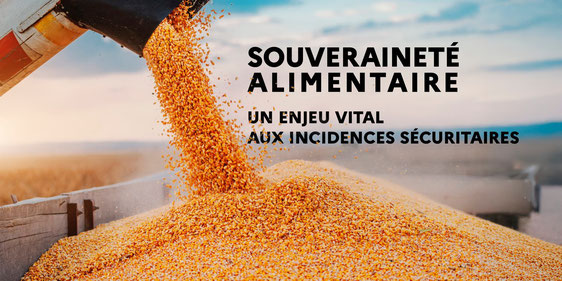
En 2005, la France décidait de faire de la protection de l’environnement une valeur constitutionnelle. Une décision qui ne coûtait rien, mais qui permettait de s’afficher en phase avec son temps. Déjà à l’époque, les alertes sur les limites des ressources naturelles se faisaient entendre. Depuis combien d’années entendons-nous, chaque mois de juillet, que nous avons consommé ce que la Terre peut produire en un an ?
Vingt ans plus tard, en mars 2025, alors que les agriculteurs — ceux qui produisent l’essentiel — sont étranglés par des normes parfois absurdes, une concentration des exploitations étouffant les plus petits, une pression constante sur les prix, et une concurrence déloyale alimentée par des traités de libre-échange plus que discutables… la nouvelle loi d’orientation agricole proposait un principe simple : la non-régression de la souveraineté alimentaire.
Un symbole fort, une tentative de dire : « assurons-nous, au minimum, de ne pas reculer sur ce qui nous permet de nourrir notre population. »
Et pourtant, que croyez-vous qu’il advint lors du passage de la loi devant le Conseil constitutionnel, saisi par des députés de La France insoumise et des écologistes ? Ce principe de non-régression a été censuré. Motif : il contrevenait à la valeur constitutionnelle de l’environnement. Oui, l’affirmation de la souveraineté alimentaire a été jugée incompatible avec la protection de l’environnement.
La France est sans doute l’un des pays les plus exigeants en matière environnementale. À tel point que cette exigence finit souvent par la rendre moins compétitive, lui faire perdre des parts de marché, et désormais affaiblir sa capacité à nourrir sa population.
Dans un monde de plus en plus instable, où le plus fort impose sa loi, ne pas pouvoir garantir notre souveraineté alimentaire est une forme de trahison.
Un renoncement inquiétant, masqué derrière des principes qui, mal appliqués, finissent par nuire à ceux qu’ils prétendaient défendre.
Il est temps que les responsables politiques renouent avec l’essentiel : l’intérêt général. Qu’ils aient le courage de prendre des décisions qui assurent notre résilience, plutôt que de s’acharner à agir sur des terrains où, trop souvent, ils n’ont ni prise réelle ni compréhension suffisante des enjeux.

Pierre Bouchacourt est directeur associé du cabinet Lysios Public Affairs.
Expert en politique de la ville, aménagement du territoire, logement, sécurité et prévention, gestion de collectivités territoriales et relations institutionnelles.
Militant antiraciste, laïque et républicain, il fut conseiller municipal de Villiers-le-Bel, directeur de cabinet de l’agglomération de Cergy-Pontoise et maire adjoint de Cergy Pontoise (95), mandat durant lequel il a été amené à participer à la définition de la stratégie territoriale de l'agglomération au sein du projet du Grand Paris. Pierre Bouchacourt est membre du conseil scientifique du PRé.
Écrire commentaire