Les Notes du PRé sont des articles thématiques ou généralistes
- ou des esquisses - qui ont pour ambition de donner à voir les réflexions, les analyses critiques et les propositions du PRé, en s'efforçant de ne pas trop céder à l'esprit du temps. Elles sont
le fruit du travail coopératif des membres dans un esprit collaboratif avec les sympathisants, et de dialogue avec les membres du conseil scientifique et les contributeurs.
L'assiégé - Dans la tête de Dominique Venner, le gourou caché de l'extrême droite
Eléments de réflexion pour gouverner la transition écologique & énergétique
L'empire du confusionnisme
Inventer une démocratie continue
Transition écologique & énergétique : l'écueil communicationnel
A la recherche du temps présent - Eléments de réflexion éparse par temps de Covid
La République dans toute son exigence
Peut-on croire en une renaissance démocratique ?
De la crise sanitaire à l'alternative politique ?
Le monde d'après, c'est maintenant
Le difficile gouvernement de la santé par le marché. Le cas des chartes d’engagements volontaires de progrès nutritionnel
Risques potentiels pour la santé liés aux nouveaux contaminants dans les principales rivières et les eaux traitées
Renaissance de l'Europe ?
Gouverner la transition écologique & énergétique
Penser le monde, panser la planète & re-panser l'humain
Protéger le modèle républicain des libertés individuelles
La laïcité répudiée ?
Ou est Charlie dans la France d'aujourd'hui ?
Un idéal démocratique abîmé
Eléments de réflexion par temps mauvais
La démondialisation après la mondialisation ?
Les valeurs, mais quelles valeurs ?
Guerre et environnement, le cas syrien
La question du principe de sécurité juridique
La Social-écologie a-t-elle un avenir ?
Aspects de la crise centrafricaine
Rééquilibrer le Commun par l’individualité : La piste Levinas
L'Europe, c'est par où ? Les enjeux européens de la France pour le prochain quinquennat
La question de l'obsolescence programmée
Histoire de l'immigration et ruptures mémorielles
Pour un 1% logement de la Fonction publique
Silver economie, usages, technologies et seniors
Vers une éthique concrète de la sollicitude ?
Les médicaments et molécules chimiques sont-ils les "nouveaux contaminants" de nos environnements marins, rivières, eaux profondes et souterraines en France en 2015 ?
D'une obligation de dépense à un investissement immatériel : allons jusqu'au bout de la réforme de la formation professionnelle
Pour une écologie républicaine
Europe & Défense : la nécessité d’une volonté politique forte et renouvelé
Vers une "social-écologie" ?
Pour des Jeux olympiques écolos à Paris en 2024
Actualité de la laïcité
Quel espace politique pour les écologistes ?
Construction européenne, la nécessité d’une révolution démocratique
Médiator, la pilule ne passera pas
Le point sur la parité femme-homme
Quelques jalons pour repenser les politiques énergétiques
Santé, quelles politiques publiques ?
Culture, fille publique
A quoi servent les banques ?
Agriculture : le maïs sur la temps des paysans
Dépendance, 5° branche et dignité
Déchets, le retard français
Une autre diplomatie est-elle possible ?
« Consommer durable » : au-delà de slogans
Delta du Niger : la marée noire permanente
Sommet de Cancun : l’ONU sauve les meubles, mais pas encore la Planète
Par Eric Osmond
Hors les cercles militants, on connait peu Dominique VENNER, essayiste, nationaliste européen, (obsessionnellement) identitariste, idéologue de l’ombre de la galaxie d'extrême droite qui n’eût de cesse de vouloir la rassembler, la recomposer et avant tout la réarmer intellectuellement. Cet ancien para, activiste dans les années 50 du groupe néofasciste Jeune Nation, membre ensuite de l’OAS puis du GRECE, s’est suicidé le mardi 21 mai 2013. Homme de conviction et de fantasmes, d'insatisfactions, de ressentiments et de paradoxes, celui qui était furieusement occidentaliste, antichrétien, païen, raciste et militariste, fomenteur un temps d’un projet de prise de l’Elysée, se fit sauter la bouche, un genou à terre, au pied de l’autel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Contempteur de la médiocrité de la démocratie et du suffrage universel, foncièrement anticommuniste, mais fasciné par Lénine...
16-11-2021
Lutter contre « le réchauffement climatique », autrement (mieux) dit, contre le dérèglement climatique, nécessite d’agir dès maintenant, mais sans s’agonir à coup de « Il est trop tard » ou de « on n’a plus que trois ans pour agir ». Contrairement à ce que l’on peut lire dans biens des médias ou entendre dans la bouche de certains écologistes politiques ou autres adeptes du catastrophisme, il n’existe pas de date butoir au-delà de laquelle il n’y aurait plus rien à sauver. Si on lisait plus attentivement les rapports du GIEC au lieu de ne songer qu’à les instrumentaliser ou à alimenter ses propres peurs, on s’apercevrait que les experts ne disent pas autre chose...
Note présentée par Dominique Lévèque
En France, l’air du temps est plutôt à se payer de mots, sans toujours aborder les vrais problèmes ou la racine de ces problèmes. Ou alors est-ce une façon de préférer le déni à la réalité ?
Il est par exemple assez symptomatique de constater les réfutations des formations politiques, et singulièrement celles situées à gauches, sur le fait que le fond de l’air est ultra-conservateur, que les espaces publics se sont extrême-droitisés depuis au moins 2007. Même si la société, sur le temps long, depuis quelques 30 ans, est plus tolérante, plus ouverte, ce qui invite à être prudent sur l’hypothèse d’une « droitisation de la société » elle-même. Mais en même temps, le fait est que cette société, depuis 2010, est plus crispée et plus en demande de sécurité, d’autorité, de traditions interroge. Tandis que le rapport aux « valeurs » est devenu plus ambivalent...
27-05-2021
La « fatigue », la « désaffection » démocratique, c’est comme un marronnier, on en parle régulièrement, ça fait les titres dans les journaux et les magazines, les accroches dans les meetings politiques, sauf que rien de décisif ne se passe, alors que le diagnostic semble largement partagé : la nécessité d’inventer la démocratie du XXIème siècle.
L’on (ré) évoque, non sans raison, « le désenchantement du monde », le sentiment d’incomplétude chez les Hommes, le besoin irrépressible de croire, le retour de la religion ou de ses usages dans l’espace public, et le constat qu’avec sa sortie, les hommes qui ambitionnaient de se gouverner eux-mêmes, n’ont trouvé que de manière imparfaite avec la démocratie, le moyen de le faire. Le régime représentatif et le suffrage universel, aussi précieux demeurent-ils, montrent leurs limites dans leur utilisation ...
25-02-2021
10-12-2020
I- LE MIROIR DE NOS DERELICTIONS, p 4
La montée du confusionnisme, p 5
Le risque d’une glaciation idéologique p 7
Que faire ?, p 9
II- LES EFFETS COVID, p 10
Un renforcement des tendances stratégiques géopolitiques, p 12
Vers une Europe européenne ?, p 14
De nouveaux axes de convergences possibles, P 16
III- UNE NOUVELLE DUALITE DES TEMPS, p 18
Peut-on croire en une renaissance démocratique ?, p 19
La République dans toute son exigence, p 22
Se ré-intéresser à la politique, p 24
IV- D’UN CHAOS A L’AUTRE, p 28
Quelques leçons de la crise, p 29
Echapper au gâchis de la sensibilisation à la transition écologique, p 31
Arrêter de fixer des objectifs lointains, p 36
V- « LE MONDE D’APRES », C’EST MAINTENANT, p 37
Pour un nouveau cap, p 38
10 Propositions écologiques ET sociales, p 38
Le besoin de nouveaux imaginaires politiques, p 40
12-11-2020
La République est l’objet d’un gâchis qui pourrait tout emporter. On fait peu de cas d’elle.
On la néglige, on la raille, on la découpe, on la fragilise, on la soupçonne même parfois, quand on ne se dit pas que l’abolir, cela ne serait pas plus mal. Comme si tout pouvait devenir plus simple sans elle...
15-10-2020
La démocratie n’est pas un régime politique parmi d’autres, elle n’est pas davantage un élément d’un processus historique global, elle est par définition instable, imparfaite, comme les interrelations humaines et, comme le postulaient déjà les philosophes antiques, toujours inachevée. Elle est en permanence à recommencer. elle est juste un cadre (précieux) qui permet sinon de les résoudre, du moins d'atténuer les tensions dans la société, qui permet de transformer nos vies en acceptant de passer par un processus délibératif qui mérite aujourd’hui d’être renforcé pour honorer la promesse démocratique, viser une « démocratie réelle » en passant par une démocratie en effet continue, pas exclusivement représentative, réellement plus coopérative ; la démocratie est (devrait être) cet espace d’élaboration en commun de sens, tout en recherchant un peu d’efficacité, voire un peu de vérité.
13-05-2020
Quelles que soient la rapidité des progrès thérapeutiques attendus dans les mois à venir et la plus ou moins grande saisonnalité du virus Covid 19, le pays s' installe comme beaucoup d’autres dans une séquence sanitaire de « stop and go » assez longue, inédite, dramatique et destructrice. Les ressorts et les conséquences psychologiques, culturelles et civilisationnelles de cette crise font l'objet de nombreuses analyses. Je me contente de soumettre à votre sagacité une réflexion sur ses effets au plan politique français et dans ce cadre l’hypothèse suivante : la situation chez nous peut ouvrir plus rapidement que prévu une autre alternative que l'affrontement entre le "macronisme" et l'extrême droite.
26-04-2020
Les Français croyaient durs comme fer à la toute-puissance de la médecine, pensaient aussi que leur système de santé était l’un des meilleurs du monde - la France n’est-elle pas « la fille aîné de la modernisation » ? - ils réalisent maintenant qu’il n’est pas aussi parfait qu’ils l’imaginaient, qu’il y a comme un déficit de coordination et d’organisation entre la multiplicité des acteurs de la santé publique en France. Ils découvrent que l’empilement successif des réformes hospitalières et des réseaux de soins, pas si coordonnés que cela au final, la conversion des établissements sanitaires au mantra managérial, budgétaire et de performance économique, confrontant les soignants à un phénomène d’injonctions institutionnelles souvent paradoxales...
09-04-2020
En prenant pour objet une mesure de politique publique de lutte contre l'obésité, cet article met l'accent sur les conditions de construction de la confiance dans un dispositif d'action publique. Celles-ci sont d'autant plus exigeantes quand, comme dans le cas étudié des chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnels, un instrument d'action publique a vocation à initier des dynamiques marchandes. Loin d'être garantie par le seul soutien des pouvoirs publics, l'efficacité d'un tel outil dépend aussi, de façon décisive, de sa capacité à assurer l'alignement des intérêts des parties qu'il met aux prises (pouvoirs publics, mais aussi acteurs économiques industriels). Cet alignement des intérêts est néanmoins mis à mal par un travail de gestion du dispositif qui, guidé par le souci de préserver sa réputation,mine son efficacité en contribuant régulièrement au désalignement des i
Olivier Pilmis est sociologue, chargé de recherche au Centre de Sociologie des Organisations (CNRS, Sciences Po)
Henri Bergeron est sociologue, directeur de recherche au Centre de Sociologie des Organisations (CNRS, Sciences Po).
Membre du CS du PRé.
N.B : cet article a été publié par la revue Sciences sociales et Santé en mars 2020
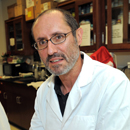
DOSSIER
LA QUESTION DES PESTICIDES ET INSECTICIDES PRESENTS DANS L'EAU DES FLEUVES ET L'EAU POTABLE, présentée par Philppe T Georgel
14-01-2020
La présence de perturbateurs endocriniens (PE) dans nos cours d'eau locaux devient une menace croissante pour la population environnante. Ces composés et leurs produits de dégradation (présents dans les pesticides, les herbicides et les déchets plastiques) sont connus pour interférer avec toute une série de fonctions biologiques allant de la reproduction à différenciation. Pour mieux comprendre ces effets, nous avons utilisé une analyse ontologique in silico des voies de transmission pour identifier les gènes affectés par les PE les plus couramment détectés dans les grandes réserves d'eau des rivières, que nous avons regroupées en fonction de quatre fonctions communes : Les lésions organiques, la mort cellulaire, le cancer et le comportement.
En plus des PE, nous avons inclus dans notre étude la buprénorphine, un opioïde, car cette menace écologique similaire est de plus en plus souvent détectée dans les réserves d'eau des rivières. Grâce à l'identification des effets biologiques pléiotropiques associé à l'exposition aiguë et chronique aux PE et aux opioïdes dans les réserves d'eau locales, nos résultats mettent en évidence une grave menace pour la santé qui mérite des investigations supplémentaires, en mettant potentiellement l'accent sur l'augmentation des lésions de l'ADN.
*Philippe Georgel est professeur agrégé en biochimie et biologie moléculaire à l'Université Marshall (Huntington en Virginie-Occidentale, Etats-Unis) dans le Département des sciences
biologiques. Il est membre du conseil scientifique du PRé.
Dernier ouvrage paru : (avec Abbas, A., Patterson, W.)The epigenetic potential of dietary polyphenols in prostate cancer (Biochemistry and Cell Biology Vol. 91. 2013).
Philippe Georgel est l'auteur à qui tout correspondance à propos de cette étude peut être adressée.
Philippe T Georgel - Labome.Org
N.B : Cet article a également été publié dans la revue internationale WATER
26-11-2019
Si l’on veut tenir l’Europe loin des nationalismes et des identitarismes de tous poils, il faudra mieux faire voir ses bienfaits économiques et ne plus remiser à plus tard la question du projet européen dont le moins que l’on puisse dire est que son approche par les Etats membres est loin d’être convergent. Il faudra surtout et avant tout accorder (enfin) du crédit à la forte demande de protection que les peuples expriment. Comme les aider à se réapproprier l’idée même de l’Europe.
Cela passera à n’en pas douter par une démocratisation d’une façon ou d’une autre des instances européennes, et sans doute par un renforcement du rôle du parlement qui n’a actuellement pas de pouvoir d’initiative, qui ne peut pas présenter des propositions d’actes. Mais cela passera aussi par un certain réalisme, par la capacité collective à affronter la question des frontières...
21-11-2019
Les organisations, les Etats, nos sociétés, sont soumis à un niveau d’incertitude impressionnant : changement climatique, transition énergétique, Brexit, révolution numérique, pression migratoire, mal-développement, etc. Pourtant, notre façon de prendre des décisions pour agir semble faire fi de cette nouvelle donne. Avons-nous seulement conscience de la manière dont nous raisonnons pour appréhender une décision ? Peut-on appréhender une situation complexe comme nous appréhendons une situation compliquée ?
20-11-2019
Alors que les pollutions, la destruction des écosystèmes et la disparition des espèces ont atteint des niveaux rarement égalés, dans un contexte de tensions sociales qui s’amplifient pareillement depuis 10 ans et de l’angoisse du retour d’une crise financière et/ou économique, ce nouvel objet de séduction reste sinon problématique, du moins nécessite d’être sans cesse interrogé. Peut-on considérer que cet horizon normatif, qui depuis plus de 30 ans est censé assurer un équilibre à la fois économique, social et environnemental, est globalement positif ? Faire du développement durable est-ce agir pour l’environnement ? Il est souvent avancé que son seul problème est un problème de délai dans sa réalisation, alors que l’on pourrait tout aussi bien se demander si la définition même du concept et les instruments de politique de mise en œuvre ne tendent pas à limiter la prise de responsabilité
13-11-2019
Notre tradition républicaine est un atout précieux pour préserver l’unité de la France dans ces nouveaux défis, notamment ceux de la « diversité », tant les facteurs de dispersion, dans un monde ouvert où l'argent, la finance, les néo-féodalismes, les égoïsmes, les groupes tribaux et les communautarismes triomphent, peuvent contribuer à sa dislocation. Encore faudrait-il que cette tradition puisse être revivifiée par un projet collectif pour pallier à son manque cruel actuel, rendant au pays une confiance en lui-même qui l’a quitté.
Encore faut-il que face à la progression d’une radicalisation des esprits et des mœurs que l’on peut observer à la périphérie des métropoles, mais aussi en banlieues, en France et en Europe, on accepte de regarder cette réalité en face.
Comme celle qui fait que la France est multi ethnique et multi confessionnelle..
06-11-2019
La question de la laïcité est souvent caricaturée, soit qu’elle apparaisse comme la marque d’un universalisme républicain post-colonial ou le faux nez de « l’islamophobie », soit que l’on soupçonne ceux qui voudraient la définir comme voulant faire le lit du communautarisme. Nous le disions déjà en 2013. Le résultat est un silence souvent gêné, ou une parole empruntée sur les questions de société ou d’actualité qui s’y rattachent. Nous appartenons tous à des « communautés » d’origine diverses, de fait, parfois au moins autant qu’à une catégorie sociale. Sans que nous nous définissions comme tels, ni même que nous y songions ! Ces communautés peuvent être culturelles, ludiques, professionnelles, géographiques, sexuelles, religieuses, philosophiques, etc.
Ces appartenances sont même constitutives de nos identités individuelles.
28-10-2019
Certains s’étonnent à la faveur de l’actualité que la banalisation de la multiplication des foulards islamiques notamment dans la France dite « périphérique » ne soulève pas plus d’interrogations sur la montée de l’intégrisme islamique. Alors que cette pratique en est l’expression la plus basique. La banalisation est telle qu’on ne veut pas voir que le port du voile, dans certains pays, comme en Albanie (ou même en Europe, comme en Belgique dans certaines villes), est financé par le wahhabisme (notamment d’Arabie Saoudite et du Qatar) qui gangrène progressivement l’islam des Balkans, remettant en cause l’autorité des imans traditionnels pour s’imposer, etc. Comme on ne se pose pas plus de questions que cela sur le fait que nous sommes d’abord en face d’une guerre mondiale dans l’islam sunnite.
15-10-2019
Différents signes dans le monde semblent indiquer une certaine fragilisation du modèle démocratique de nos sociétés occidentales. Parfois même comme une certaine gangrènisation.
Ou quand la dictature adopte la stratégie du coucou pour habiter la démocratie.
Ainsi ces « démocratures » dénommées par des philosophes pour caractériser des pays dont le chef du pouvoir central décide de tout à la place de tout le monde, dont le régime est dénué de tout libéralisme politique constitutionnel, rognant les libertés à chaque occasion, jouant des compétitions et des conflits ethniques et n’hésitant pas à miser sur la guerre pour régler leurs problèmes.
La régression de l’idéal démocratique
Un horizon démocratique commun peut-il encore se dessiner ?
Le tirage au sort serait-il alors LA solution ?
La démocratie numérique peut-elle constituer un système de substitution ?
13-06-2019
Depuis une dizaine d’année, la démondialisation nourrit toutes les controverses. Comme avant elle la mondialisation. Réaction à l’impérialisme financier, retour à une économie juste et équitable pour les uns, prenant en compte les besoins des peuples, signant la fin de la folie néolibérale pour les autres, ou encore hiver glaçant pour l’économie mondiale…
C’est peu dire que si le couple mondialisation / démondialisation cristallise les débats, la démondialisation peine à trouver une définition claire.
27-11-2018
A quoi tient que le monde subisse toute une série de dérèglements aussi bien d’ordre climatique, géopolitique, social et financier, qu’il soit en proie à un recul des coopérations, de la bienveillance, des libertés, à une régression religionnaire, en même temps que progressent les égoïsmes, la déréliction sociale, les replis identitaires, le tribal, les excommunications intellectuelles, le fanatisme, la violence, la privatisation du vivant et l’impraticabilité de la vie ? L’on observe, depuis quelques années, des dérives de plus en plus inquiétantes qui menacent d'anéantir tout ce que l’espèce humaine a bâti jusqu'ici, tout ce dont elle peut être légitimement fière, tout ce que l’on a coutume d'appeler « civilisation ». Comment en sommes-nous arrivés là? Résister ou se révolter ne suffit pas sans une « idée régulatrice » de l’humanité ou de la société souhaitable.
19-09-2018
S’il est un sujet que l’on brandit souvent à l’envi pour en dénoncer la fin ou la « crise » : les valeurs. Les valeurs sont souvent mises en avant pour tenter de se définir ou de se redéfinir politiquement, pour expliquer l’état de la France et du monde, ou son propre état, sans que l’on sache toujours ce que cela recouvre. Tout un chacun les met en avant pour expliquer leur affaiblissement ressenti. Mais y a-t-il vraiment, depuis le temps que l’on en parle - approximativement depuis 25 ans - une « crise » des valeurs, comme il y aurait une crise du clivage droite-gauche ? Et si, plus que la « crise des valeurs », ce qui nous guettait c’était une certaine banalité démocratique ?
12-11-2018
La question des impacts environnementaux des conflits armés a fait l'objet d'un grand nombre d'études scientifiques et universitaires ces deux dernières décennies. Si l'aide aux populations et la gestion humanitaire des sites restent la priorité, s’intéresser aux conséquences environnementales de la guerre est également un aspect primordial. Face à l’urgence de certaines situations, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) a ainsi créé une « Post-conflict and disaster management branch »1 afin d'intervenir sur ces problématiques, et une Journée internationale de la prévention et de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé a été instaurée.
05-07-2018
A quoi tient que parfois l’on ait le sentiment de quelque chose qui aurait à voir avec un naufrage ? Un signe qui ne trompe pas : que fait l’Europe en faveur de ce que l’historien Benjamin Stora appelle les « Damnés de la Mer », ces centaines de milliers de migrants qui traversent la Méditerranée, ces milliers d’entre eux qui ont trouvé la mort pour avoir juste voulu échapper, pour la plupart d’entre eux, à la guerre ?
A quoi tient que le projet le plus important, pour la planète et ses habitants, la Transition écologique, connaisse un tel retard à l’allumage depuis la COP 21 ? La transition écologique est comme La lettre volée d’Edgar Poe, elle est sur la table - depuis au moins 16 ans - mais personne ou presque ne la voit. L’on sait pourtant qu’elle pourrait être une formidable opportunité de (re)faire société, de renforcer l’affectio societatis...
20-06-2018
Une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel avec le cas de l’arrêt du Conseil d'État, 18 mai 2018, CFDT Finances.
Serait-on sur une voie restrictive du contentieux administratif français ?
Par un arrêt Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT (CE, 18 mai 2018, n° 414583), le Conseil d’Etat a jugé que les vices de forme et de procédure n’étaient plus opérants lors de la contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception ou lors du recours contre le refus d’abroger un tel acte.
Cette décision, motivée par la volonté de renforcer la prise en compte du principe de sécurité juridique, est révélatrice d’une sévérité atténuée du juge administratif vis-à-vis de l’administration. Elle suscite, en outre, des interrogations quant à sa combinaison avec certaines dispositions législatives.
02-09-2017
Les Français aspirent à être de plain-pied dans leur vie, à ne plus « remettre l’existence à plus tard » selon la formule de Baudelaire. Sachant qu’il a été démontré que les inégalités de revenu et de pouvoir jouent un rôle non négligeable dans la question environnementale, l’excès de richesse comme l’extrême pauvreté étant souvent à coroller avec les dégradations écologiques, la transition écologique devient un enjeu y compris social primordial. Il ne suffit plus de penser le lien entre écologie et question sociale, mais de le traduire politiquement pour qu’il soit le plus largement partagé, car le court-termisme symptomatique de nos sociétés tendant à en faire d'irréductibles contraires continue à prévaloir. La social-écologie peut porter ce message : nos sociétés seront plus justes si elles sont plus durables et elles seront plus durables si elles sont plus justes.
23-12-2016
La crise politique et socio-sécuritaire qui a marqué la République Centrafricaine ces dernières années est une crise de longue durée, émaillée de violences chroniques sur fond de faillite de l’Etat, d’économie de la débrouille et de profonds clivages entre groupes socio-ethniques. Alors que les groupes armés (les anti-Balaka et les ex-Seleka, parfois orthographié Séléka) se caractérisent par leur criminalisation, leur fragmentation et leur lutte pour le pouvoir, les tensions intercommunautaires ont mis à mal l’unité nationale et le contrat social centrafricain. Cette instabilité a atteint un degré de violence si élevé de sorte que la communauté internationale s’est portée au secours de la RCA. La solution pour la sortie de crise, au-delà des interventions militaires de stabilisation, passe par une réflexion de fond sur des questions aussi importantes que complexes.
REEQUILIBRER LE COMMUN PAR L'INDIVIDUALITE : LA PISTE LEVINAS
Par Philippe Corcuff
06-12-2016
Le texte présenté par le sociologue Christian Laval au séminaire de recherche ETAPE du 20 mai 2016, sur « Commun : de quelques rapports que nous entretenons avec la « tradition libertaire » » constitue une contribution majeure à une actualisation de la pensée anarchiste se sentant redevable des apports de la tradition, et dans ce plus particulièrement de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865).
Générosité intellectuelle
Le séminaire ETAPE, dispositif hybride entre le militantisme et la recherche, a l’habitude de bénéficier de la bienveillance de ses invités, qui nous font des cadeaux exprimant la possibilité de l’amitié intellectuelle, trop absente, malheureusement, des milieux académiques professionnels (1). La guerre des egos, des « écoles » et des réseaux fait ainsi souvent rage dans le monde universitaire et les blessures de la reconnaissance apparaissent souvent abyssales. Cependant, il y a des contre-tendances dans une réalité socio-historique, qui comme la plupart des zones du réel, n’est jamais univoque, percée de grains de sable et de résistances au mainstream. Quelle belle contre-tendance que le texte de Christian Laval !
Christian Laval offre ainsi un texte inédit dans le cadre d’un « séminaire » non reconnu comme tel par les canons scientifiques et qui ne compte en rien pour les progressions de carrière. Plus, de formation marxiste, ce foucaldo-marxien s’expose sur le terrain de ses invitants en explorant la composante anarchiste de la démarche entreprise avec Pierre Dardot dans leur livre Commun (2), peu explicitée de manière systématique jusqu’à aujourd’hui.
Et Christian Laval, hérétique par rapport au poids des préjugés dans sa famille politico-intellectuelle d’origine, les marxistes, va jusqu’à réhabiliter la figure de Proudhon. Or, cette dernière a vécu si longtemps sous les crachats marxistes depuis que le bourgeois Marx lui-même, après l’avoir admiré, a stigmatisé ce prolétaire comme un « petit-bourgeois, ballotté constamment entre le capital et le travail » dans Misère de la philosophie en 1847 (3) ! Une leçon d’anti-dogmatisme. Une fraternité de l’émancipation. Un antidote aux aigreurs trop souvent actives dans les relations interpersonnelles dans les univers intellectuels ou politiquement organisés.
Les apports de Proudhon nourrissent donc profondément la démarche de réactualisation et de reformulation du commun qu’il a élaborée avec Pierre Dardot, nous dit Christian Laval dans son texte pour le séminaire ETAPE :
« Proudhon nous intéresse sous de multiples aspects, et depuis assez longtemps. Sa théorie de la force collective comme son analyse de la captation de cette même force collective par la propriété et l’État sont à nos yeux des références fondamentales. Nos travaux ont toujours eu pour intention assez explicite de lui rendre justice sur un certain nombre de ses apports philosophiques et politiques. »
Les analyses de Proudhon alimentent, partant, une reproblématisation du commun, qui refuse nombre d’usages actuels essentialistes, ceux qui en font une essence, une entité homogène, donnée et stable. Contre ce qu’ils nomment fort justement « la réification du commun » (4), la piste principale de Pierre Dardot et Christian Laval, c’est celle du processus, du faire, de l’action, du mouvement de la coopération :
« Le commun est à penser comme co-activité, et non comme co-appartenance, co-propriété ou co-possession. » (5)
Et d’ajouter :
« Contre ces façons d’essentialiser le commun, contre toute critique du commun, qui réduit celui-ci à la qualité d’un jugement ou d’un type d’homme, il faut affirmer que c’est seulement l’activité pratique des hommes qui peut rendre des choses communes, de même que c’est seulement cette activité pratique qui peut produire un nouveau sujet collectif, bien loin qu’un tel sujet puisse préexister à cette activité au titre de titulaire de droits. » (6)
Dans ce cadre, Christian Laval souligne dans son texte, en réorientant le regard vers Proudhon :
« Proudhon nous permet de faire une distinction majeure entre des versions à beaucoup d’égards contraires de ce que l’on peut et doit entendre par « commun ». Ce point est décisif. Il oppose la force collective à la transcendance propriétaire et étatique, la coopération à la communauté ».
Substituer la co-activité à la co-appartenance, la coopération à la communauté, voilà bien un déplacement pour penser le commun qui nous éloigne de dérives identitaristes fort actuelles, dans la valorisation des « communautés » et des « appartenances », débouchant sur nombre de résurgences communautaristes (au sens dans l’enfermement dans une « communauté » exclusive) et nationalistes en cours. Je pense notamment à l’éloge de « l’appartenance » en général et de « l’appartenance nationale » en particulier dans l’ouvrage Imperium du penseur dit « critique » Frédéric Lordon (7). D’ailleurs, cette divergence conduit le même Frédéric Lordon à caricaturer dans l’amalgame l’orientation du livre de Pierre Dardot et Christian Laval, en l’associant à « la pensée libérale » qui infecterait « toute la pensée libertaire » (8). Mazette, pour un prétendu « radical » infecté par le national-étatisme ! On préfèrera, en nos temps troublés par la montée de néoconservatismes identitaires et nationalistes, la rencontre de la lucidité internationaliste et de la générosité cosmopolitique chez Pierre Dardot et Christian Laval :
« Une politique du commun effective doit prendre acte du caractère mondial des luttes qui se mènent aujourd’hui, comme des interdépendances de toutes natures qui structurent nos univers de vie et de travail, notre imaginaire et notre intelligence. Un nouvel internationalisme pratique est d’ores et déjà à l’œuvre dans les combats qui se mènent » (9).
La focalisation sur le commun ou les pièges du « logiciel collectiviste »
Cependant, l’énorme travail de reconceptualisation du commun effectué par Pierre Dardot et Christian Laval, à partir de l’histoire des débats philosophiques et politiques comme des enjeux portés par les mouvement sociaux actuels, a des points aveugles. La générosité intellectuelle appelle l’honnêteté critique entre pairs, une critique amicale et généreuse, privilégiée par les séminaires ETAPE. Je ne traiterai que d’un point. Le commun, pensé comme co-activité, est présenté comme l’axe principal de l’alternative au capitalisme aujourd’hui ; alternative déjà en action dans les mouvements sociaux s’opposant au moment néolibéral du capitalisme. Selon moi, cette configuration oublie un autre pôle central pour les anarchistes comme pour Marx (pas le Marx des marxistes mais, par exemple, celui redécouvert par le philosophe Michel Henry, 10), en tension avec le pôle du commun : l’individualité.
Au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une variété de courants ouvriers et socialistes nouaient, sous des modalités particulières, individualités et liens sociaux :
-Les penseurs anarchistes ainsi que les militants libertaires qui ont animé le syndicalisme révolutionnaire fin XIXe/début XXe siècles, celui des Bourses du travail et de la première CGT (Pelloutier, Pouget, etc.), ont tout particulièrement mis en avant la promotion de l’autonomie individuelle au sein de relations de réciprocité contre la double tyrannie du capitalisme et de l’État (11). Par exemple, Émile Pouget, militant anarchiste et secrétaire national adjoint de la section des fédérations de la CGT de 1901 à 1908, va jusqu’à parler en 1910 dans sa brochure L’action directe de « l’exaltation de l’individualité » (12). Tout en précisant : « l’indépendance et l’activité de l’individu ne peuvent s’épanouir en splendeur et en intensité qu’en plongeant leurs racines dans le sol fécond de la solidaire entente. » (13)
-Le socialisme républicain de Jean Jaurès, en association avec le thème de « la propriété sociale » des grands moyens de production et d’échange, a fait de « l’individu » l’une des valeurs cardinales de la gauche. Il n’a pas alors hésité à avancer dans son article « Socialisme et liberté » de 1898 : « Le socialisme est l’individualisme logique et complet. Il continue, en l’agrandissant, l’individualisme révolutionnaire » (14). Pour lui, le socialisme créerait les conditions sociales de l’avènement pour tous de « l’individu » annoncé par la Révolution française (à travers la figure du citoyen, de la raison individuelle, etc.).
-Les figures socialistes et associationnistes comme Pierre Leroux, Benoît Malon ou Eugène Fournière, sorties de l’ombre, dans laquelle les avait plongées la prégnance des références marxistes, par le sociologue Philippe Chanial (15), ont su également penser ensemble individus et association.
Cette liste n’est qu’indicative et on peut y ajouter un Marx marqué par de nettes composantes individualistes le plus souvent passées sous silence par les lectures marxistes.
Toutefois, à un certain moment – après la guerre de 1914-1918 dans le cas de la France (16) – le thème de « l’individu » va s’effacer progressivement de l’espace des questions centrales des gauches dominantes, dans les familles socialiste, communiste et syndicales, au profit de thèmes plus « collectivistes ». La jambe individualiste des gauches va ainsi se trouver anémiée, sauf dans les courants libertaires. Un « logiciel collectiviste » va alors largement prédominer à gauche, que l’on parle de « socialisme » ou de « communisme ». Le risque ici, c’est que le commun, même repensé de manière ouverte et mobile par Pierre Dardot et Christian Laval, ne devienne un nouvel avatar de ce « logiciel collectiviste ».
Il m’apparaît qu’une piste plus heuristique consiste à déplacer le regard vers les tensions entre commun et individualité. Au croisement de la tradition juive et de la phénoménologie, le philosophe Emmanuel Levinas est justement un philosophe de la singularité du visage d’autrui. Ce qui signifie que l’individualité est immédiatement appréhendée chez lui dans un cadre intersubjectif, relationnel. Il a ainsi insisté sur le fait qu’on ne peut jamais complètement comprendre autrui, au double sens du mot : le connaître totalement et l’englober. Car il y a quelque chose dans autrui qui échappe à nos prises totalisatrices : justement l’unicité irréductible de son visage.
Pourtant, amorçant quelque chose comme une philosophie politique, Levinas a aussi suggéré une piste quant à la mise en rapport de deux dimensions : la part de l’incommensurable – en ce que l’individualité saisie de manière intersubjective tend à déborder toute mesure commune tout en étant tissée d’’une variété d’expériences collectives – et la part du commensurable – le commun saisi comme co-activité. Il écrit ainsi dans un livre d’entretiens, Éthique et infini :
« Comment se fait-il qu’il y ait justice ? Je réponds que c’est le fait de la multiplicité des hommes, la présence du tiers à côté d’autrui, qui conditionnent les lois et instaurent la justice. Si je suis seul avec l’autre, je lui dois tout, mais il y a le tiers […]. Il faut par conséquent peser, penser, juger, en comparant l’incomparable » (17).
Levinas a donc commencé à pointer la nécessaire et irréconciliable tension entre le caractère incommensurable de la singularité d’autrui, d’une part, et l’espace commun de mesure, de justice et de solidarité, outillé d’institutions, d’autre part. C’est ce qu’il appelle « comparer l’incomparable ».
Une telle perspective ne caractérise pas l’émancipation comme un cadre « harmonieux » (selon une expression d’inspiration religieuse) ou comme un « dépassement » des contradictions sociales (selon une certaine vision marxiste du communisme inspirée de la philosophie dialectique de Hegel). Car la formule « comparer l’incomparable » assume et affronte une dynamique infinie de contradictions entre la logique de l’individualité et la logique du commun, dans une inspiration proche de la figure proudhonienne de « l’équilibration des contraires » (18).
Cette piste levinassienne ne fait que compléter les solides appuis que nous fournissent Pierre Dardot et Christian Laval dans Commun, en s’efforçant d’éviter les dérives « collectivistes », et donc en approfondissant une perspective libertaire qu’ils ont eux-mêmes amorcé, et que Christian Laval a prolongé dans le beau texte (19) qu’il a offert au séminaire ETAPE.
Philippe Corcuff est enseignant-chercheur, maître de conférences de science politique à l'Institut d'Études politiques de Lyon. Il y enseigne et y mène des recherches de sociologie (sur la place des individualités dans les sociétés individualistes-capitalistes contemporaines), de philosophie politique (sur la question de l'émancipation), et autour de dialogues transfrontaliers entre sciences sociales, philosophie et cultures ordinaires (romans noirs, cinéma, chansons, séries télévisées...). Il est rattaché au laboratoire de recherche CERLIS (CNRS/Université de Paris Descartes). Il est également co-animateur du séminaire de recherche libertaire ETAPE.
Cofondateur de l'Université Populaire de Lyon (en janvier 2005), puis l'Université Populaire de Nîmes (en décembre 2008), dont l'Université Critique et Citoyenne de Nîmes a pris la suite (en octobre 2011), Philippe Corcuff se définit comme social-démocrate libertaire et anarchiste pragmatique. Cofondateur (en février 1995) du Club de réflexions sociales et politiques Maurice Merleau-Ponty (aujourd'hui disparu) - où devait le rejoindre notre ami Dominique Lévèque, sec gl du PRé - qui a constitué un des pôles de la pétition de soutien aux grévistes (dite "pétition Bourdieu") lors du grand mouvement social de l'hiver 1995.
Il peut être noté que ses engagements, comme son goût de la pédagogie et sa volonté d’essaimer, voire de marcotter, l’ont mené du MJS, PS et ES de Bordeaux (courant Ceres) au MDC, les Verts, LCR, puis NPA. Désappointé, entre autres, par le peu d’appétence générale des organisations qu’il a pratiquées depuis 1994 pour le débat d’idées et le travail intellectuel, il a fini par rejoindre la FA (en février 2013).
Philippe Corcuff est un contributeur (libre, exigeant et bienveillant) du PRé et nous a amené à approfondir et à nuancer notre travail sur le « Commun » entamé depuis 2010.
Cet article a également été publié sur le site de Grand Angle, vers une réflexion libertaire (23-11-2016) qui a l’habitude de publier les travaux
d’ETAPE.
*Partout dans le monde, des mouvements contestent l’appropriation par une petite oligarchie des ressources naturelles, des espaces et des services publics, des connaissances et des réseaux de communication. Ces luttes élèvent toutes une même exigence, reposent toutes sur un même principe : le commun.
Pierre Dardot et Christian Laval montrent pourquoi ce principe pourrait s’imposer aujourd’hui comme le terme central de l’alternative politique pour le XXIe siècle : il noue la lutte anticapitaliste et l’écologie politique par la revendication des « communs » contre les nouvelles formes d’appropriation privée et étatique ; il articule les luttes pratiques aux recherches sur le gouvernement collectif des ressources naturelles ou informationnelles ; il désigne des formes démocratiques nouvelles qui ambitionnent de prendre la relève de la représentation politique et du monopole des partis.
Notes :
(1) Je l’ai déjà souligné dans le cas de la séance sur Michel Foucault avec Geoffroy de Lagasnerie, dans « Pragmatiser l’horizon révolutionnaire et désétatiser la gauche. Quelques remarques critiques sur un texte de Geoffroy de Lagasnerie « Du droit à l’émancipation. Sur l’État, Foucault et l’anarchisme » », site de réflexions libertaires Grand Angle, 8 octobre 2016, [http://www.grand-angle-libertaire.net/pragmatiser-lhorizon-revolutionnaire-et-desetatiser-la-gauche/].
(2) Pierre. Dardot (philosophe) et Christian. Laval (sociologue), Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, réédition La Découverte/Poche, 2015.
(3) K. Marx, Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon (1eéd. : 1847), dans Œuvres I, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 93.
(4) P. Dardot et C. Laval, Commun, op. cit., version 2015, pp. 32-40.
(5) Ibid., p. 48.
(6) Ibid., p. 49.
(7) F. Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015, pp. 37-53 et p. 190 ; pour des critiques, voir P. Corcuff, « En finir avec le « Lordon roi » ? Les intellos et la démocratie », Rue 89, 4 février 2016, [http://rue89.nouvelobs.com/2016/02/04/finir-lordon-roi-les-intellos-democratie-263066], et Jérôme Baschet, « Frédéric Lordon au Chiapas », site de la revue Ballast, 9 mai 2016, [http://rue89.nouvelobs.com/2016/02/04/finir-lordon-roi-les-intellos-democratie-263066].
(8) F. Lordon, Imperium, op. cit., p. 74.
(9) P. Dardot et C. Laval, Commun, op. cit., version 2015, p. 461.
(10) Voir P. Corcuff, « Le Marx hérétique de Michel Henry : fulgurances et écueils d’une lecture philosophique », revue Actuel Marx, n° 55, pp.132-143, [http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2014-1-page-132.htm].
(11) Voir, entre autres, Irène Pereira, L’anarchisme dans les textes. Anthologie libertaire, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2011.
(12) É. Pouget, L’action directe (1e éd. : 1910), Nancy, édition du « Réveil Ouvrier », s. d., repris sur le site de la Bibliothèque nationale de France, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84028z], p. 6.
(13) Ibid.
(14) J. Jaurès, « Socialisme et liberté » (1re éd. : 1898), repris dans Rallumer tous les soleils, textes choisis et présentés par J.-P. Rioux, Paris, Omnibus, 2006, p. 346.
(15) P. Chanial, La délicate essence du socialisme. L’association, l’individu & la République, Lormont, Éditions Le Bord de l’eau, 2009.
(16) Sur cette césure de 1914-1918 quant aux rapports entre la gauche et l’individu en France, voir P. Corcuff, « Individualisme », dans A. Caillé et R. Sue (éds.), De gauche ?, Paris, Fayard, 2009, p. 199-208.
(17) Dans E. Levinas, Éthique et infini (1e éd. : 1982), dialogues avec P. Nemo, Paris, Le Livre de Poche, 1990, p. 84.
(18) Sur « l’équilibration des contraires » chez P.-J. Proudhon, voir Théorie de la propriété (1e éd. posth. : 1866), Paris, L’Harmattan, collection « Les introuvables », 1997, p. 206.
(19) "Commun : de quelques rapports que nous entretenons avec la 'tradition libertaire'", par Christian Laval (sociologue, co-auteur avec Pierre Dardot de Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2014), 23 novembre 2016, http://www.grand-angle-libertaire.net/commun-de-quelques-rapports-que-nous-entretenons-avec-la-tradition-libertaire/
AU DELA DE CETTE LIMITE, VOTRE PRODUIT N'EST PLUS VALABLE
Présenté par Thierry Libaert
20-10-2016
L’obsolescence programmée est un terme apparu au lendemain de la grande crise de 1929, mais qui n’est réellement entré dans notre espace public qu’après le début des années 2010. L’expression a été définie par le législateur français comme étant « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement » (Loi du 17 août 2015). Dans les faits, la problématique est beaucoup plus large et le problème de l’obsolescence programmée ne réside pas tant dans la réduction planifiée de la durée de vie d’un produit que dans la multiplication des entraves à sa réparabilité.
Les conséquences de l’obsolescence programmée sont nombreuses et concernent l’augmentation du volume des déchets et notamment ceux de la filière électrique et électronique (10 millions de tonnes annuelles dans l’Union Européenne). Elles sont sociales avec la diminution des PME de réparation qui constituent pourtant un vivier majeur d’emplois qualifiés et non délocalisables. Ainsi, en France, 44 % des produits électriques et électroniques ne sont pas réparés. Les conséquences sont également culturelles, car le spectacle des pannes à répétition ne peut que contribuer à la distanciation des consommateurs et de leurs entreprises, mais au-delà même c’est toute notre relation aux objets qui nous entourent qui ne peut qu’être questionnée par un caractère éphémère et jetable accentué.
Les entreprises ne sont pas les seules responsables, le système économique en lui-même qui favorise les productions là où la main d’œuvre est peu onéreuse rend délicate une réparation qui ne peut s’effectuer qu’à proximité, là où les rémunérations sont plus élevées. C’est ce qui amène souvent les distributeurs à conseiller une nouvelle acquisition plutôt qu’une réparation.
De même, nos pratiques de consommation sont également à considérer. Les fabricants de téléphones portables ont pu nous faire remarquer qu’il ne servirait à rien de produire des téléphones ayant une durée de vie d’une dizaine d’années, puisque nous en changeons toues les deux ans.
Il faut signaler également que la critique relative à l’obsolescence programmée ne doit pas être trop générale. L’Ademe a ainsi pu mettre en évidence que pour certains types de produits, il était préférable de remplacer des produits encore en état de fonctionnement, simplement en raison d’innovations technologiques permettant une moindre empreinte environnementale aux nouveaux produits.
Alors, que faire ?
Bien sûr, il n’est pas envisagé d’empêcher toute pratique d’obsolescence programmée, notamment en période de croissance faible. Il est toutefois possible de mieux réguler les dérives les plus flagrantes, tout en favorisant les filières de réparation. Un groupe de travail que j’ai piloté au sein du think tank « La fabrique écologique », a publié en septembre dernier une note de réflexion sur le sujet et listé près d’une vingtaine de pistes de progrès. Parmi celles-ci, trois mesures sont apparues davantage structurantes. C’est notamment le cas d’une meilleure application des lois existantes, dont la loi Hamon du 17 mars 2014, relative à la consommation et qui est très imparfaite en matière de disponibilité des pièces détachées. De même, le dispositif d’éco-contribution pourrait intégrer le critère de la durabilité des produits afin d’inciter aux pratiques industrielles les plus vertueuses.
Enfin, une solution simple et peu onéreuse serait d’afficher la durée de vie des produits. Celle-ci devrait bien sûr être contrôlée pour éviter de fausses allégations. On sait depuis cette année et la première grande étude européenne sur le sujet que les consommateurs sont sensibles à l’information sur la durée de vie des produits et sont prêts à payer plus cher des produits plus durables. C’est en plus une demande forte exprimée par 92 % des consommateurs français. On comprend dès lors assez mal ce qui freine encore nos pouvoirs publics.
Thierry Liebaert, membre du conseil scientifique du PRé est expert en communication des Organisations. Il a fait une première communication publique de ses travaux dans le cade du PRé le 5 décembre 2015. Ses réflexions sur la question de l'obsolescence programmée rencontrent un écho de plus en plus large; elles ont été également publiées récemment par La Fabrique écologique à la faveur d'un groupe de travail qu'il a présidé.
Responsable de la stratégie de communication (direction développement durable) du groupe EDF à l’occasion de la COP 21.
Membre du Comité Economique et Social Européen (rapporteur de l'avis du CESE du 17-10-2013 relatif à l'obsolescence programmée, premier texte européen à se prononcer sur ce sujet) et du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot (au nom de laquelle il a participé au Grenelle de l'environnement au sein de la commission "Gouvernance").
Collaborateur scientifique de l’Université catholique de Louvain (Institut Langage et Communication) et membre du conseil d’orientation du MBA «Marketing et Développement durable» du pôle universitaire Léonard de Vinci. Directeur scientifique de l'Observatoire international des crises (OIC) dont il est le co-fondateur avec Didier Heiderich, Christophe Roux-Dufort; membre du comité de rédaction de la revue «Recherches en Communication» (depuis 2009), du comité de lecture de «Communication & Organisation», de la revue « Public Relation Inquiry », et du conseil d’orientation du MBA «Marketing et Développement durable» du pôle universitaire Léonard de Vinci.
Membre du conseil d’administration de l’Institut des futurs souhaitables, de celui de l’association pour le commerce équitable Max Havelaar France, et du Conseil d’Ethique Publicitaire.
Dernier ouvrage paru : (avec Jean-Marie Pierlot) Les nouvelles luttes sociales et environnementales (Ed Vuibert, 2015)
1) La première préconise de garantir la réparabilité des produits par une application plus résolue et quelques modifications de la loi consommation du 17 mars 2014 (Loi Hamon).
2) La deuxième vise à intégrer dans les prix des produits des critères favorables à l’intensité d’usage et à la durée de vie. Ceci passe par la modulation des éco-contributions sur la base de ces critères.
3) La troisième a pour objet l’affichage pour le consommateur d’une information relative à la durée de vie du produit afin de lui permettre de s’engager plus fortement vers une pratique d’achat responsable.
L'EUROPE, C’EST PAR OU ?
Les enjeux européens de la France pour le prochain quinquennat
Présenté par Stanislas Hubert
02-10-2016
L'Europe est régulièrement mise au banc des accusées tant il est vrai que la succession des crises (financière, monétaire, migratoire) a montré son incapacité à relever les défis que le monde globalisé du XXIème siècle lui soumettait. Pour autant, quelle autocritique et quelle part de responsabilité les politiques nationales et notamment françaises ont-elles dans cette inexorable chute vers les abîmes ?
Par ailleurs, à quelques mois des
présidentielles, comment le prochain exécutif devra aborder les enjeux européens ? Car il y aura bien sûr à négocier le tournant de la sortie de la Grande Bretagne mais plus
généralement, il est tout aussi urgent de formuler un projet de relance de l’UE.
L'Europe, éternelle absente du débat public
Identité, lutte contre le terrorisme, chômage, seront les sujets qui occuperont les candidats à la présidentielle française de 2017. Le devenir du projet européen ne sera probablement évoqué que marginalement, de manière convenue et désabusée, tant les convictions semblent s'être estompées sur le sujet. Le débat public est ainsi biaisé : la gestion des crises et la mise en œuvre des politiques publiques sont de plus en plus européennes dans leur approche, mais les politiques font mine de l'ignorer.
Aujourd'hui, les anti-européens, échauffés par le Brexit, n'ont plus peur de parler de sortie de l'UE. Les europhiles sont quant à eux discrets (euphémisme) et peinent à renouveler leur discours.
L’Europe, serait trop libérale, trop technocratique... Mais la faute à qui ?
Un peu à nous Français qui n'avons pas su occuper le terrain, celui en faveur d’une Europe solidaire pesant sur le futur de notre planète.
Un Erasmus pour les élus et les hauts fonctionnaires?
Agriculture, contrôle des frontières, gouvernance économique, lutte contre le terrorisme, etc... tous ces sujets ont évidemment une résonance européenne. Chacun sait que dans le processus de décision européen, le volontarisme doit s'accommoder du compromis et du "smart power".
Au lieu d'appréhender cette complexité, les politiques la considèrent comme un aveu de faiblesse qu'ils préfèrent refouler et taire.
Mais plus grave, la classe politique française et plus généralement ses élites, n'ont jamais été aussi peu tournées vers l'Europe qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse des institutions ou plus généralement de ses Etats membres, de sa culture et de ses habitants. L'Union ne se résume pas aux Institutions bruxelloises, elle se construit à travers les échanges nourris sur ses territoires, avec ces citoyens, ses élus locaux, ses jeunes, sa société civile.
Au-delà du manque d'assiduité de nos députés européens, d’une présence française déclinante à Bruxelles et Strasbourg, combien d'hommes et de femmes politiques parlent des langues européennes ? Combien ont su nouer des relations privilégiées avec des pays européens au-delà du poussiéreux groupe d’amitiés de nos assemblées parlementaires ? Quels est le classement de nos universités lorsque il s’agit d’émarger aux programmes scientifiques européens ?
Le constat est identique lorsque l’on évoque nos intellectuels, il n’est d’équivalent aujourd’hui à un Romain Rolland ou à un Stefan Zweig qui faisaient vivre à leur époque une véritable conscience européenne.
L’Europe doit se faire par « le bas », c’est une évidence, mais sans oublier « le haut », au risque d’un continent de plus en plus recroquevillé où les Français auraient perdu toute influence.
Europe terra incognita
Ce désamour pour l’Europe se retrouve malheureusement dans tous ses États membres. Les liens se distendent. La construction européenne n’a plus d'échos, les traumatismes des conflits qui ont ravagé le continent, constituent de moins en moins un ciment, et naturellement le narratif nationaliste reprend des forces, se revigore. La crise des migrants a révélé le schisme qui existait au sein de l’Union européenne sur la question primordiale des ‘valeurs’.
Dans les anciens pays du bloc communiste, le rêve européen a laissé sa place aux illusions et fantasmes d'une puissance passée mythique. Croatie, Pologne, Hongrie, les démocraties illibérales ont le vent en poupe. Et pour cause, ni la démocratie, ni le libéralisme (aux deux sens du terme) ne transcendent.
A-t-on élargi trop vite ? Probablement, mais il convient surtout de rappeler qu'à la fin des années quatre-dix, l'adhésion au projet européen constituait encore un formidable horizon pour les peuples, appelant des réformes. Aujourd'hui : non.
Que faire ? Ressasser un discours "européen" usé ? Non Il faut inventer un nouveau narratif renvoyant le nationalisme dans les tréfonds de l’histoire.
Le prochain ou la prochaine présidente devra permettre d’insuffler une nouvelle dynamique dans la construction européenne à désormais 27, concevoir le « plus d’Europe » autrement que comme une « pensée magique » et définir une méthodologie pour en faire outil à long terme au service de la transformation écologique et sociale.
Une nouvelle posture européenne de la France : plus modeste mais plus fédératrice.
La France doit jouer ce rôle d’impulsion et mettre en œuvre une véritable stratégie d’influence à contrepied de sa politique de puissance traditionnelle : privilégier les intérêts aux enjeux symboliques.
Pour prendre un exemple, la France a-t-elle réellement « intérêt » à se s’arcbouter sur la présence du parlement à Strasbourg qui crispe l’ensemble des délégations et n’aurait-elle pas intérêt à abandonner cet enjeu symbolique au privilège d’autres enjeux sociaux par exemple.
La France devra s’inventer une nouvelle posture pour permettre de dessiner les contours d’un projet ciblé, crédible pour l’Europe. Les chances de succès dépendront aussi de la capacité des citoyens d’adhérer à ce projet.
Une révolution démocratique, seule issue à une relance de la construction européenne
L’Europe s’est enlisée dans un libéralisme dont elle a totalement intériorisé l’idéologie et dans un refus de la démocratie qu’elle considère comme superfétatoire dès lors qu’elle aurait à s’intéresser aux « choses sérieuses », en l’occurrence l’économie.
La crise de 2008 a eu le mérite de mettre à nu les carences du modèle économique et la faiblesse des institutions de la zone euro. Et il n’est pas question de contester que la construction européenne doit irrémédiablement prendre le chemin du renforcement de la gouvernance économique, qui jusque-là, faisait cruellement défaut dans le cadre d’une union monétaire. Il conviendra ainsi de mettre en œuvre une véritable politique budgétaire qui soit contra-cyclique, coordonnée à l’échelle européenne, et capable de rompre avec les dogmes libéraux.
Car on le sait l’UE doit aussi, prôner autre chose que la rigueur et l’austérité au risque de voir le continent européen sombrer dans une récession durable. Mais elle ne doit pas aussi négliger le fait que les crises sont liées : économique, sociale et environnementale et elle doit impérativement et réellement s’appuyer sur les peuples. Aussi, il faut plaider pour le renforcement d’une Union européenne avec des objectifs à long terme d’une société européenne écologiquement responsable et socialement juste, à côté d’un gouvernement économique qui sera nécessairement concentré sur la gestion à court-moyen terme. Une sorte de système de « check and balances » entre l’avenir des générations futures et les impératifs économiques à court terme.
Elle doit aussi miser sur ses réussites, valoriser ses succès. On n’a pas assez relevé que l’Union européenne a joué un rôle prépondérant dans les négociations climatiques. On minore les espoirs fondés par des projets tels que celui de taxes sur les transactions financières initiés par une coopération renforcée de dix États, etc.
Une révolution démocratique de la techno structure bruxelloise, non seulement par conviction mais aussi par pragmatisme.
L’Union européenne doit concilier impératif d’efficacité et besoin de légitimité. L’Europe s’est construite sur le postulat selon lequel l’intégration européenne était un processus continu où l’on passait d’une thématique d’intégration à une autre. Cette dynamique est enrayée et il nous faut lui en substituer une autre : peut-on imaginer que la révolution démocratique puisse constituer le fer de lance de la construction européenne ?
Cette révolution démocratique que nous appelons de nos vœux ne doit pas être conçue comme un exercice incantatoire mais comme un impératif pragmatique. Nous ne devons pas y chercher une légitimation de la décision des ‘despotes éclairées’ qui composent nos institutions bruxelloises mais une mobilisation pour l’amélioration de la mise en œuvre de décisions européennes. Autrement dit, parions sur le fait que la décision sera meilleure si le citoyen a été consultée et qu’elle sera mieux appliquée, si celui-ci y a adhéré.
L‘accusation de déficit démocratique au sein des institutions européennes est récurrente, pourtant elle n’a jamais été traitée de manière convaincante et ne s’est traduite en définitive que par des maxi ‘plans de communication’, comme s’il suffisait d’éclairer le citoyen européen des lumières bruxelloises pour leur faire prendre conscience de l’évidence européenne. Cela démontre à quel point la technocratie européenne est profondément convaincue d’agir pour le bien des peuples d’Europe et incapable de produire une autocritique de l’organisation et du fonctionnement de l’UE.
Une démocratie sans les lobbies
De quoi souffre la bureaucratie européenne ? De s’être volontairement mise -hors sol- pour ne pas être rattrapée par l’intérêt particulier des Etats mais elle n’a sans doute pas songé à la nécessité de se prévaloir de l’influences des lobbies. Il est inconcevable de penser que les groupes d’experts qui conseillent la Commission européenne sur les politiques du secteur financier sont sous l’emprise des représentants des banques, des assurances, des fonds spéculatifs, etc. L’Union européenne contrevient ainsi à l’article 9 de son propre Traité, qui parle du « principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions »
Retisser le lien avec les citoyens tout en rompant avec les lobbies doit être un leitmotiv :
▪ rapprocher les institutions du terrain
▪ innover en matière de participation
▪ Émergence d’une démocratie sociale européenne
▪ développer l’accès réel de la société civile aux Institutions européennes,
Une « Europe des résultats » oui……mais au service du modèle social européen.
L’Europe, quand elle le veut, sait être redoutablement efficace si on la juge par exemple à l’aune de son action « en faveur » du droit de la concurrence. Il n’y a dans ce domaine pas d’arsenal législatif plus complet, d’action publique mieux outillée, de politique plus interventionniste. Il faudrait transposer cette efficacité au service du modèle social afin de permettre que la diversité de l’Union provoquée par l’élargissement devienne un atout et non un espace de mise en concurrence des territoires et des salariés.
L’UE devrait travailler entre autres à :
▪ L’établissement d'un revenu minimum d'existence financé par chaque État membre. A contrario, l’idée d’un salaire maximum pourrait s’imposer aussi au niveau européen.
▪ La définition d’un cadre davantage protecteur pour les services publics notamment sociaux.
▪ Imposer un plancher d’objectifs minimaux quantifiés de dépenses sociétales pour les Etats membres en pourcentage de PIB (par exemple pour les dépenses d’éducation, de santé, de politiques familiales -sachant qu’un des principaux handicaps de l’Europe est son vieillissement).
▪ Exiger que tous les travailleurs soient protégés au travers de conventions collectives et/ou de la législation assurant l’égalité de traitement
▪ Et bien sûr une politique fiscale commune pour les pays de la zone euro et/ou harmonisée dans l’ensemble de l’UE.
L’affirmation d’une Europe des valeurs
Nous souhaitons en finir avec l’Europe subie et permettre l’affirmation d’une Europe voulue. L’Europe doit cesser de n’être que l’ « Empire de la norme » qui caricature son action et désespère ses défenseurs. Il y a fort à parier que les citoyens européens se retrouveraient autour d’objectifs donnant un sens nouveau à la construction européenne :
▪ Le développement des énergies renouvelables, les questions de dépendance énergétique, de sûreté technologique (rappelons qu’il y a 146 centrales nucléaires en activité dans l’UE) sont par nature à traiter à l’échelle du continent.
▪ La reconversion industrielle/ ré- industrialisation concernent les travailleurs européens.
▪ La politique de transport durable (pendant du principe de libre circulation des marchandises).
Reste la question du financement ? Hormis le fait qu’il faille lever un impôt européen (ou en tout cas que l’UE bénéficie de ressources propres) il convient de noter qu’aujourd’hui les principaux postes de dépenses du budget européen sont impopulaires et/ou incompris et /ou inefficaces :
Les gros chèques versés à quelques agriculteurs donnent le sentiment d’un dispositif à deux vitesses et en ce qui concerne la politique dite « régionale » le mythe d’une Europe du sud (Espagne, Portugal, Grèce) rattrapant son retard grâce aux miracles des fonds structurels a été balayé par l’effet révélateur de la crise de l’Euro. Le miracle (ou mirage) était en réalité davantage dû à un dumping fiscal ou social ou à des bulles spéculatives sans parler de l’effet stimulant de la corruption.
Les toutes prochaines années s’annoncent particulièrement complexes pour l’Union européenne qui devra gérer de manière parallèle deux fronts : celui de la négociation avec les britanniques dont on sait qu’elle sera particulièrement chronophage et tendue, mais aussi la réforme de ses institutions, qu’elle devra adapter à cette nouvelle donne.La France dans ce vaste chantier devra prendre en considération au moins deux aspects de la nouvelle Europe : celle de son centre de gravité plus à l’est qui n’est pas spontanément son terrain de jeu, mais aussi, et c'est une opportunité, celui d’une Europe, sans les britanniques, plus réceptive à une vision inclusive et citoyenne. La France est attendue sur ses valeurs de liberté, égalité, fraternité. Il est de sa responsabilité de tendre la main à tous ceux qui défendent au sein de la société civile européenne nos valeurs communes.
HISTOIRE DE L'IMMIGRATION ET RUPTURES MEMORIELLES
Par Benjamin Stora
22-06-2016
Après les attentats de janvier 2015, une rencontre des présidents d'universités s'est tenue autour de questions sur l'origine de la violence et des radicalisations. A cette occasion, plusieurs pistes de recherches sont apparues, notamment sur la compréhension des ruptures mémorielles à l'œuvre dans l'histoire de l'immigration maghrébine. La présente note est la reproduction de l'intervention de Benjamin Stora le 4 mai 2015 à l’Assemblée nationale à la rencontre organisée par la Conférence des Présidents d’universités.
Ce seront simplement quelques réflexions que je ferais ce matin devant vous, sans l’ensemble des graphiques savants et précieux de l’exposé que nous venons d’entendre, et qui prouvent aussi à quel point la recherche démographique française a énormément progressé. Et le travail remarquable de François Héran n’y est pas pour rien, son travail est tout à fait indispensable. Mais il nous indique aussi à quel point existe un fossé entre l’accumulation de ce savoir académique et universitaire, et sa transmission, sa diffusion dans le grand public. Il existe autour de la question migratoire, je le sais encore plus depuis que je préside le Conseil d’orientation du Musée de l’Histoire de l’Immigration, énormément d’idées reçues, des préjugés négatifs et des stéréotypes sur, évidemment, le grand « débarquement », l’envahissement des immigrés dans la société française. Tout le travail accumulé ici montre l’inverse, notamment au niveau du pourcentage d’étrangers dans la société. Combattre ces stéréotypes est un défi redoutable, porté par la Recherche française et l’Université et qui n’est pas simplement dans l’accumulation du savoir que dans sa transmission. Je pense en effet que le grand problème est celui de la transmission, de la diffusion. Il faut donc aussi se préoccuper de la question médiatique. Nous le savons, nous vivons dans une société de l’instantanéité, de la diffusion avec une grande rapidité des préjugés, des idées fausses et des idées reçues. Et pour résister à cela, l’Université est peut être mal outillée.
Le second aspect que je voudrais développer est celui-ci : dans la problématique des flux migratoires, des chiffres, des statistiques, il existe le point de vue de l’historien. Qui intervient dans le rapport aux histoires vécues. Bien entendu, l’histoire vécue par la société française et l’histoire vécue par les immigrés eux-mêmes se modifient suivant les mises en contexte historique. Aujourd’hui la société française est peut-être, à tort ou à raison, persuadée que il y a énormément d’immigrés, beaucoup plus qu’auparavant, qu’ils arrivent en nombre encore plus nombreux. Nous avons vu que cela ne correspond pas à tout ce qui vient d’être dit à l’instant. Mais au titre de ces vécus, de ces traumatismes et de ces blessures de l’histoire, il y a, entre autre, le rapport à la France à la colonisation française et de l’esclavage dans l’histoire de la longue durée. Ce sont des questions historiques fondamentales qui traversent aujourd’hui l’ensemble de la jeunesse française. J’ai moi-même pu en faire l’expérience dans une série de conférences que j’ai donné dernièrement. Je suis allé à Villetaneuse tout de suite après les attentats contre « Charlie » et l’hyper casher, de Villetaneuse aux Mureaux, des quartiers nord de Marseille, à Lyon et Villeurbanne, etc. À chaque fois, des assistances nombreuses et des questions qui reviennent toujours de manière lancinante et terrible avec le rapport à l’histoire. L’histoire française qui a du mal à assumer ce passé. Et disons les choses clairement, cela a été évoqué par François Héran avant moi, ceux qui ont commis ces attentats récents ne sont pas des immigrés. Ce sont des Français, ils sont nés en France mais ils portent une histoire. Une histoire qui est, si on regarde leurs parcours familial (Merah, frères Kouachi, l’attentat de Villejuif) d’origine algérienne. C’est une hypothèse qui a été soulevé, le rapport très particulier de l’histoire française, algérienne, et coloniale. Il faut traiter de cette question. Ma seule intervention ne peut naturellement pas apporter toutes les réponses. Ces personnages qui ont commis ces attentats portent en eux une histoire singulière, qui est en fait une histoire de rupture, de traumatisme, de blessure du rapport à la France coloniale, à leurs parents, à leur histoire familiale (qui n’est pas simple). On pourrait avoir une première interprétation très schématique qui serait celle d’une continuité des traces de la violence coloniale, mal supportée par les enfants issus de la deuxième ou troisième génération, et transférée ensuite sur le territoire français. Ce continuum historique est porté d’ailleurs par un certain nombre d’associations et de groupes qui expliquent que la société française vit toujours comme une société coloniale. C’est dit de manière explicite dans les rencontres, les conférences. Je pense qu’il y a des méconnaissances de la société française sur cette histoire, j’y reviendrais.
Mais il y a aussi des ruptures. Et pas de continuité, pas de déterminisme. On a beaucoup parlé de déterminisme social par exemple, mais il n’y a pas de déterminisme historique. Si on examine les trajectoires de ces personnes, on s’aperçoit qu’il y a à la limite plus de ruptures que de continuités. Rupture avec la tradition familiale, rupture avec la tradition religieuse, rupture avec les nations, française et algérienne. Par exemple pour ce qu’il s’agit des jeunes Algériens d’origine, la plupart ignorent tout du mouvement des Oulémas de Ben Badis, ils ne connaissent pas ce mouvement réformiste algérien apparu dans les années 1930, et qui voulait une séparation entre la pratique du culte et les autorités de l ‘époque. Ils ignorent la tradition singulière algérienne, et qui a façonné tout un imaginaire y compris familial. Il y a une rupture par rapport à la culture familiale traditionnelle, qui était celle du nationalisme politique longuement porté en France par des associations présentes depuis cinquante ou soixante ans, dont ils ignorent tout de l’existence. Il faut donc, à mon sens, s’interroger sur ce mécanisme de rupture à la fois familial, culturel et politique. Plutôt que de simplement chercher des continuités par rapport à l’histoire coloniale, ou l’histoire religieuse.
Pourquoi les ruptures ?
Pourquoi ceux qui passent à l’action terroriste ne connaissent pas l’histoire de leurs grands-parents qui ont été, pour certains, membres de la fédération de France du FLN ? Pourquoi ils ne connaissent rien de la tradition religieuse islamique, au sens classique du terme, portée ou non par leur famille ? Bref, il faut s’interroger sur ces mécanismes qui créent des fossés mémoriels. Les fossés mémoriels m’intéressent car ils nous permettent de travailler sur des mécanismes de l’oubli, de l’absence de mémoire. Ces espèces de béances, de trous de mémoire, à l’intérieur d’une même immigration ou d’émigration. Ces trous de mémoires peuvent s’expliquer de différentes manières. D’abord en France, il y a une très grande méconnaissance de l’histoire du Maghreb contemporain. La Ministre parlait tout à l’heure des postes à créer. Vous savez combien il y a de postes en France de professeurs des universités qui sont spécialistes de l’histoire du Maghreb contemporain ? Quatre. Il y a quatre professeurs de l’histoire du Maghreb contemporain en France. Je ne parle pas de l’islam, du terrorisme, de la langue. Je parle de l’histoire. C’est à dire au XIXème et XXème siècle, quelle est l’histoire du Maghreb contemporain ? Algérie, Maroc, Tunisie, Libye ? Il y a des sociologues, des anthropologues, des politologues, mais l’histoire… Connaître l’histoire de ces gens qui sont venus en France depuis longtemps maintenant, et qu’on appelle aujourd’hui des Arabes, des Musulmans, et qui viennent à 80% du Maghreb. À partir de ce moment-là, vous pouvez avoir en cascade le problème de la transmission d’un savoir académique au niveau de l’enseignement secondaire, de l’IUFM, des concours, du CAPES… S’il y a des postes à créer en France, c’est de se réapproprier le fil de la continuité historique du savoir sur ce que c’est que le Maghreb. On a le sentiment de tout connaître sur le Maghreb parce qu’il a une très grande proximité géographique avec nous, une proximité historique par rapport à la question coloniale. Dans la mesure où de nombreux Maghrébins parlent français, au niveau de leurs élites en particulier, alors on a le sentiment de cette connaissance, connivence. Il y a beaucoup de gens en France qui disent connaître l’Algérie. Sauf que l’Algérie, depuis l’indépendance de 1962, à quatre fois plus d’habitants, elle en a 38 millions aujourd’hui. Peu de gens le savent, peu s’y rendent, et peu parlent la langue. À partir de là, on ne sait peu de choses de cette histoire, de ce pays, de ses élites, de ses acteurs, de ses ministres, de ses gouvernements, de ses militaires, de ses industriels, de ses intellectuels, de ses artistes, de ses caricaturistes, etc. Il y a là un déficit de connaissance. Il faut partir de cet aspect simple. À mon avis, une rupture dans la tradition historique de ces pays, tout de suite après la décolonisation, est préjudiciable. Le regard a été porté ailleurs, pour de nombreuses raisons sur lesquelles je ne peux pas m’attarder aujourd’hui. Il faut donc se réapproprier ce savoir, et se demander quelles sont les histoires propres et singulières de chacune de ces personnes.
L’autre grande explication, c’est la singularité des histoires migratoires. Chacune des grandes immigrations en France portent des singularités. Il y a des immigrations qui sont en situation d’évidence par rapport à la société française, et puis les immigrations qui sont dans des positions de conflictualité. C’est fondamental, on ne peut pas considérer que les immigrations soient les mêmes. Autre proposition, il faut donc renforcer le pôle de connaissance des histoires de l’immigration. Or, j’ai constaté, depuis ma prise de Présidence du Musée de l’Immigration, que le nombre de chercheurs en France sur l’immigration avait diminué en histoire. Ce n’était pas le cas jusque dans les années 2000 où on avait réussi à surmonter ce handicap de connaissance par une formation plus grande des jeunes chercheurs et doctorants en histoire de l’immigration. On voyait des thèses soutenues. Et bien à ma grande surprise, en discutant de la recherche avec des responsables du Musée, ils m’ont expliqué qu’il y avait de moins en moins de chercheurs en France sur l’histoire de l’immigration. Il y a un déclin dans la connaissance ; il faut aussi créer des postes en tant que tels sur l’histoire des immigrations. Qu’est-ce que qu’une immigration, quelle est son histoire, les statuts juridiques, les acteurs. Voilà une grande explication sur ces trous de mémoire. Ce n’est pas simplement un problème d’éducation scolaire, mais aussi un problème de formation des élites.
Cette formation des élites qui ne connaissent pas les histoires singulières du Maghreb et les histoires des immigrations, cela se réfracte dans le monde de l’économie française. Quand vous avez des entrepreneurs qui veulent implanter des entreprises au Maghreb, ils se heurtent de plus en plus à une méconnaissance de l’histoire de ces sociétés. Et se retrouvent dans une situation où ils connaissent de moins en moins la société dans laquelle ils croient pouvoir investir facilement. Je ferme cette parenthèse, mais je propose donc de reprendre, oui, pour ne pas faire de l’histoire de l’immigration une question périphérique dans le savoir académique, puisque nous sommes ici dans une journée sensée promouvoir des propositions en termes de postes, de thèmes de recherches. Cela permettrait également, de proposer enfin des sujets sur l’immigration dans les épreuves du baccalauréat.
La troisième chose, c’est de regarder en face cette histoire coloniale, de l’appréhender. Il y a une très forte tendance à la régression dans le regard porté sur le passé colonial. Il y avait eu, dans les années 1990, incontestablement un progrès dans la recherche sur l’histoire coloniale, avec l’émergence de nombreux jeunes chercheurs. Et puis depuis les années 2005-2010, de moins en moins de chercheurs travaillent à nouveau sur cette histoire. Il existe des lobbys puissants, des mouvements d’extrême droite en France qui entretiennent au contraire une mémoire voulant inverser le regard que l’on pourrait avoir sur le passé colonial. Dans le midi de la France aujourd’hui, il est difficile pour les chercheurs sur la colonisation de porter un regard distancié et critique sur cette histoire. Je ne vais pas citer le nom des villes aujourd’hui, de Perpignan à Béziers, de Béziers à Nice, de Nice à… et bien cela devient difficile de parler de l’histoire de la colonisation parce qu’on se fait accusé d’être des propagandistes de la "repentance". On ne peut plus parler d’histoire coloniale, du 8 mai 1945, de ce qui s’est passé à Sétif, en Indochine, au Maroc, à Madagascar... C’est pourtant un sujet important. Mais on n’en parle peu. Par contre dans les banlieues (Vaulx-en-Velin, Quartiers Nord de Marseille, en Seine Saint Denis où j'ai longtemps enseigné, à Roubaix, etc.), on parle beaucoup du 8 mai 1945 ! Des réunions sont planifiées, et qui rassemblent beaucoup de monde. On ne peut pas être absents de cela.
Dernière proposition donc, et je terminerai là-dessus, il faut également développer les études postcoloniales en France. Cela existe aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Les études postcoloniales posent le problème des mémoires et de la connaissance de ces mémoires à l’intérieur de nos sociétés.
Je fais donc très rapidement trois propositions, pour reprendre si l’on peut dire le fil de propositions:
Il faut développer :
1) l’histoire du Maghreb contemporain
2) l’histoire des migrations françaises et internationales
3) l’histoire postcoloniale
Ce sont trois domaines d’activité de recherche. Le désir de connaissance des populations issues de ces immigrations postcoloniales est très grand. Je n’ai pas noté le chiffre qu’a donné François Héran, c’est dommage, sur le pourcentage de populations issues des immigrations postcoloniales, il est considérable dans la société française d’aujourd’hui. Et il y a un décalage que vous n’imaginez pas entre ces populations scolaires et le niveau de connaissance des enseignants, désarmés, face aux questions posées par ces enfants ou adolescents. C’est cela qui entretient aussi la question des fantasmes, de l’intégrisme, de « l’identité malheureuse », de tous les termes que vous trouverez dans les grands médias, fréquemment. A ce désir de connaissance de soi, peu de réponses sont apportées. Mon propos, est très simple. Plaider pour un renforcement de la discipline de l’histoire, et non pas simplement pour l’entretien des mémoires blessées.
Benjamin Stora est professeur des universités, président du Conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration. Il est membre du conseil scientifique du PRé.
Il enseigne l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et XXe siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire de l’immigration maghrébine en Europe, à l’Université Paris 13 et à l’INALCO (Langues Orientales, Paris).
Docteur en sociologie (1978), et Docteur d’Etat en Histoire (1991), il a été le fondateur et le responsable scientifique de l’Institut Maghreb-Europe. Membre de l’Ecole Française d’Extrême-Orient (EFEO), il poursuit en 1995 et 1996 des recherches au Vietnam. Il vit alors à Hanoi, pour une étude portant sur Les imaginaires de guerres Algérie-Vietnam. Puis, il a été Professeur invité à l’université de New York (NYU, 1998), et chercheur trois années à Rabat, au Maroc (1998-2001) pour une recherche sur les nationalismes marocain et algérien (publié sous le titre : Maroc, Algérie, histoires parallèles, destins croisés, Ed Maison neuve et Larose, 2002). Il a été Professeur invité à l’université de Berlin, Freï universität, en 2011.
Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont les plus connus sont une biographie de Messali Hadj (réédition Hachette Littérature-poche, 2004) ; La gangrène et l’oubli, la mémoire de la guerre d’Algérie (La Découverte, 1991) ; Appelés en guerre d’Algérie (Gallimard, 1997) ; Algérie, la guerre invisible, Ed Presses de Sciences Po (2000). Il a dirigé avec Mohammed Harbi l’ouvrage collectif, La guerre d’Algérie, aux éditions Robert Laffont (en poche, Hachette Littérature, 2006).
Derniers ouvrages publiés : Les Clés retrouvées. Une enfance juive à Constantine (Stock, 2015), Les Mémoires dangereuses, Paris (avec Alexix Jenni, Albin Michel, 2016)
N.B : Cette intervention a été également publiée sur son blog du Club Médiapart le 21 juin 2016.
Pour son premier conseil commun de la fonction publique, le 29 mars 2016, la ministre de la Fonction Publique Annick Girardin a précisé l'agenda social 2016.
Présenté par Guillaume Vuilletet
09-05-2016
En particulier, la ministre a insisté sur la situation des fonctionnaires en regard du logement. Elle a, par ailleurs, évoqué les mesures qui permettraient de renforcer l'attractivité des carrières publiques pour la jeunesse.
Elle a bien raison sur chacun des points. Il est même possible d'aller plus loin, en croisant par exemple les deux critères. C'est ce que nous allons faire ici.
Des agents publics qui "squattent" les salles de repos
Cela fait longtemps que je m'intéresse au logement des salariés de l'Etat et de la fonction publique. En fait, j'ai été marqué par les récits qui m'étaient faits de jeunes fonctionnaires qui dormaient dans leur voiture, ou bien ceux qui "squattaient" les salles de garde ou de repos, ou bien encore ceux qui enchaînaient les journées et les gardes afin de pouvoir rentrer plus tôt dans la semaine chez leurs parents.
Ils ne sont pas les seuls. Il y a des années déjà un élu de l'agglomération de Sophia Antipolis, que j'avais rencontré dans un cadre professionnel, se plaignait de la cherté des logements sur son territoire, qui rendait difficile les recrutements et aboutissait à une véritable invasion des campings environnants par les petites mains des entreprises high-tech. Pour ces employés, le prix du loyer ou de l'achat les amenait à résider à plusieurs dizaines de kilomètres dans l'arrière-pays. Alors, en semaine, on faisait avec les moyens du bord, les campings et les mobile-homes en l'espèce.
On se dit alors que ces deux phénomènes correspondaient à la même réalité: c'est le prix du logement qui, dans certains territoires, transforme les salariés en travailleurs pauvres. Et le squat des salles de repos, les nuits dans les voitures des fonctionnaires, risquaient fort de ne pas être un mythe.
Il serait très heureux que l'Etat le prenne en compte. C'est compliqué d'être motivé, au top du service à remplir, quand on vit dans ces conditions. Et que dire quand il s'agit de personnels soignants ou des forces de sécurité.
Petit calcul sur le poids du logement dans le budget des jeunes fonctionnaires
Mais à quelle réalité cela correspond-il ?
L'INSEE publie régulièrement des statistiques concernant les revenus des fonctionnaires. Ainsi apprend-on que les fonctionnaires de moins de 30 ans perçoivent en moyenne un revenu mensuel net de 1726€. Ce chiffre cache de réelles disparités. Entre les agents de catégorie A et ceux de catégorie C, l'écart de revenu est de près de 65%. A un tel niveau de revenu, un(e) jeune fonctionnaire n'a déjà plus droit -en moyenne encore une fois- aux allocations logements. Considérons qu'un(e) jeune fonctionnaire ait comme aspiration légitime de vivre dans 30m².
Un reste à vivre qui va de 900€ à Paris à 1450€ en province...
A Paris, il lui restera un peu plus de 900€ de reste à vivre, "contre" un peu plus de 1200€ dans le reste de l'agglomération parisienne, 1250€ à Nice, 1350€ à Nantes ou Rennes, 1450€ à Besançon. Donc, pour résumer, le pouvoir d'achat hors loyer d'un bisontin est supérieur de près de 60% à celui d'un(e) jeune fonctionnaire parisien(ne). La litanie des chiffres est évidemment bien pénible mais elle traduit une réalité très concrète. Et d'autant plus forte que les territoires où les loyers sont les plus forts sont souvent aussi ceux où la présence de l'administration est la plus forte.
Alors la question est de savoir que faire. Les syndicats de fonctionnaires se battent depuis toujours pour une revalorisation du point d'indice qui détermine leur revenu. C'est leur rôle et on les comprend d'autant plus que le gel de ce fameux point d'indice érode leur pouvoir d'achat depuis plusieurs années. Pour mémoire, l'inflation sur la période 2010-2015 a été d'un peu plus de 7%.
1% de hausse du point d'indice rapporte 300€ brut par an à une infirmière qui a 10 ans d'ancienneté...
L'augmentation annoncée par le gouvernement le 17 mars dernier représente une charge pour l'Etat de 2,4 milliards d'euros. Et pour une infirmière qui a 10 ans d'ancienneté, cela va représenter un peu moins de 300€ bruts par an de revenu supplémentaire. C'est important aussi bien d'ailleurs sur le plan matériel que symbolique.
Mais pour autant, il peut y avoir des outils pour justement compléter cette discussion sur le point d'indice. Et le sujet, ce peut être justement, comme l'a dit la ministre, le logement.
L'accès à un studio HLM va augmenter le reste à vivre de 500€ par mois à Paris
Reprenons nos jeunes fonctionnaires. S'ils louent un logement social de 30m², le loyer va être à peu près et charges comprises de 276€ à Paris, 264€ à en Île-de-France ou 241€ sur les autres villes. Leur reste à vivre hors loyer va donc se situer autour de 1450€. Ce n'est pas un grand changement pour le Bisontin, un peu plus pour le Niçois ou le Nantais. Mais pour le Parisien ou le Francilien, le gain de pouvoir d'achat est de 60% pour le premier et 20% pour le second, soit plus de 500€ et 200€ par mois!
Alors oui, le logement des fonctionnaires et en particulier des plus jeunes dans la carrière est un enjeu. Je vous ai assené ces chiffres parce que cet enjeu se décline de façon très concrète et parfaitement monétaire. Et la question peut se résumer ainsi: comment augmenter le nombre de logement sociaux au profit des fonctionnaires?
Certes, les préfectures, dans le cadre de l'action sociale de l'Etat employeur, ont un contingent de réservation. Mais il est notoirement insuffisant.
Adapter le 1% logement à la fonction publique
Alors pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se passe dans le privé et que l'on appelle de façon pas tout à fait approprié le 1% logement ?
Peu ou prou, les collecteurs d'Action Logement ont consacré 1,3 milliard d'euros aux financements des bailleurs sociaux (majoritairement sous forme de prêts). Les subventions sont à un niveau inférieur à 300 millions d'euros.
Ils ont attribué près de 70.000 logements en faveur des salariés de leurs cotisants. Ils prêtent à taux bonifiés à des bailleurs sociaux qui leur assurent en contrepartie des droits de réservation au profit des salariés de leurs contributeurs. Cela montre l'effet de levier permis par le dispositif. Cet effet de levier pourrait être encore plus fort pour la puissance publique qui possède des réserves foncières importantes qu'elle pourrait pour partie mobiliser au profit du logement de ses agents.
Un élément d'attractivité des carrières
Certes, cela ne permettra pas de loger tous les fonctionnaires. Mais cela pourra permettre d'apporter une aide significative aux plus jeunes d'entre eux. Et sans doute de renforcer l'attrait de la carrière.
Alors, c'est une idée. Sans doute, la puissance publique dispose-t-elle d'autres leviers pour construire ces logements. Cela ne fera, par ailleurs, pas de mal à notre économie.
Guillaume Vuilletet est membre-fondateur du PRé, consultant, fondateur du bureau d'études Messidor, spécialisé dans le développement territorial, tout particulièrement concernant les problématiques de l'habitat. Il est par ailleurs secrétaire général d'Ecologistes !
N.B : cet article a également été publié dans le Huffington Post le 27 avril 2016 sous la signature de Guillaume Vuilletet
SILVER ECONOMIE, USAGES, TECHNOLOGIES ET SENIORS
Présenté par Serge Guérin
14-04-2016
La transition démographique devrait être un des principaux moteurs d’un développement économique qualitatif et soutenable. En particulier parce qu’elle s’appuie sur les emplois de service, qualifiés ou non, et sur de la créativité technologique et sociale.
Trois axes peuvent résumer la silver économie : développement économique global pour répondre aux besoins et usages des 16 millions de plus de 60 ans, transformation de l’écosystème du soin et de la santé sous la pression des démarches de e-santé et de la chronicisation de la maladie, investissements dans l’innovation technologique, en s’appuyant sur la ville intelligente (smart city) et l’adaptation du logement, comme dans l’innovation sociale en privilégiant les logiques de mutualisation, de participation sociale et de territoire de vie.
La Silver économie s’adresse à des publics dont les modes de vie, les situations économiques et sociales, l’organisation familiale ou encore les revenus sont pluriels, et peuvent être très différents.
Il s’agit d’abord de répondre aux attentes réelles et non de plaquer des représentations et des solutions toutes faites. Une des fragilités majeures de la silver économie c’est la méconnaissance des publics seniors par une large partie des nouveaux acteurs du secteur… La question est de faire avec la génération silver et non pas pour un public imaginaire.
Cette approche est défendue par l’OMS avec le lancement au début des années 2000 de l’initiative Ville Amie des Aînés. Cette démarche, reprise en France par le Réseau Francophone Ville Amie des Ainés, vise à appréhender la question senior sous une diversité d’axes et sans prioriser sur les questions de santé et de perte d’autonomie ; Il s’agit au contraire de favoriser un cadre de vie qui facilite et conforte la vie autonome des plus de 60 ans.
La société de la longévité est aussi porteuse d’un potentiel d’emplois nouveaux (350 000 créations d’ici à 2020 rien que dans les services à la personne, selon la Dares), d’innovations technologiques, sociales et culturelles…
La prévention en faveur d’un vieillir durable et convivial, la recherche de démarches favorisant l’implication des seniors dans la vie du territoire dépassent très largement la simple approche économique. Il s’agit bien d’inventer une société de la longévité au sens où cela concerne tous les âges. Dans cette optique, l’écosystème mutualiste a certainement un rôle spécifique à jouer pour susciter des démarches novatrices et pour entraîner des entrepreneurs, privés lucratifs comme associatifs, à innover et proposer des solutions qui respectent les personnes et répondent à leurs usages et besoins.
Beaucoup de solutions tournent autour de systèmes de surveillance, d’alerte ou d’encadrement à distance de personnes en perte d’autonomie, mais aussi pour d’autres simplement en risque de fragilisation ou souhaitant s’inscrire dans une démarche de prévention et/ou de sécurisation. Ces dispositifs, qui se multiplient, visent souvent à rassurer l’entourage et à pallier la présence insuffisante ou considérée comme trop onéreuse de personnels d’accompagnement et de soin. Ces solutions sont de fait intrusives et impliquent aussi une capacité de réaction concrète qui implique un dispositif humain (proches et/ou professionnels) suffisamment dense.
Le caractère stigmatisant, voire humiliant, de ces équipements ne doit pas être minoré, mais ces solutions répondent à une réalité qui provoque une forte inquiétude des proches : le risque de chute. Plus du quart des hospitalisations des plus de 85 ans provient d’une chute à domicile.
D’autres solutions apparaissent bien moins intrusives et tout aussi efficaces, comme de proposer un sol anti dérapant ou plus protecteur. Il s’agit là de logiques d’adaptation des logements, comme un . Par exemple, Domalys développe Novalys, un assistant de lever nocturne qui détecte le lever de la personne et éclaire le sol selon différents modes réduisant ainsi considérablement les risques de chutes dans la nuit. Ce type de solutions contribue très directement à favoriser le bien être des personnes et leur vie domicile.
Les outils numériques peuvent contribuer à renforcer les liens, à favoriser le contact, à maintenir le regard. Cela peut tout aussi bien permettre à l’aidant de rester en contact avec l’aidé, sans être tout le temps physiquement à ses côtés. Mais cela facilite aussi le lien entre la personne âgé, et/ou son proche aidant et le monde extérieur (de la santé, ou non).
La réponse technologique n’est pas la seule à devoir être mobilisée : des initiatives sont lancées pour réintroduire du service physique sur les territoires. Le commerce produisait du service, le service doit produire du commerce. Ainsi, le Groupe La Poste, qui a un rôle majeur à jouer en raison de son implantation unique sur les territoires et qui doit trouver des relais d’activité face à la diminution structurelle de son activité courrier, développe une approche qui s’inscrit dans ce sens. En s’appuyant sur cette force unique de ses 90 000 facteurs, La Poste propose aux collectivités ou à des structures de soutien comme les mutuelles, assurances ou caisses de retraite complémentaires, des services rémunérés. Le développement du numérique implique de penser l’accompagnement et l’apprentissage des plus âgés dans une démarche adaptée aux personnes. Une part des seniors, mais aussi d’autres populations, est restée loin des solutions numériques ou n’est pas en capacité de bien utiliser les outils de la e- administration, de plus en plus nécessaires pour accéder aux services publics, aux aides sociales….
L’adaptation des logements apparaît comme le levier majeur de la silver économie, car cela répond à la fois à l’attente des seniors de vivre à domicile, et à une équation économie supportable pour les personnes, mais aussi les collectivités (Etat, Départements, bailleurs sociaux…). La PME française, Indépendance Royale, propose ainsi une gamme complète d’équipements en faveur de la vie à domicile des seniors.
De même, l’initiative de Lapeyre de créer un concept store, Vita Confort, en accès libre et banalisé qui présente pour le grand public comme pour les professionnels des solutions simples, d’usage et accessibles financièrement, marque la volonté de certain acteurs de la silver économie de répondre aux attentes réelles et au mode de vie des populations silver plutôt que de privilégier une approche technique désincarnée.
La question est bien d’appréhender la personne de manière globale, de proposer des solutions qui facilitent le quotidien et dont l’accès économique soit accessible…
Serge Guérin, est sociologue. Professeur à l’ESG Management School, il
enseigne en Master Politiques gérontologiques à Sciences Po Paris. Il a contribué depuis une quinzaine d’années à faire prendre conscience de la seniorisation de la société et a insisté sur ses
effets positifs. Il intervient aussi bien sur les enjeux de l’accompagnement des plus âgés, que sur la place des seniors –et plus largement des publics vulnérables- dans l’entreprise ou encore
sur la problématique de l’intergénération et des coopérations entre les personnes. Il propose un prolongement du « care » via la notion d'accompagnement et d’écologie sociale.
Rédacteur en chef de la revue Reciproques, centrée sur la problématique des aidants et du don, il propose un prolongement du "care" via la notion d'accompagnement et d’écologie sociale. Il est
l’auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont dernièrement Le droit à la vulnérabilité, avec Th Calvat (Michalon, 2eme édition 2011), La nouvelle société des seniors (Michalon, 2eme édition 2011) et
De l’Etat providence à l’Etat accompagnant (Michalon, 2010).
Serge Guérin est membre du conseil scientifique du PRé.
Cette note a été également publiée sur son blog alternatives-economiques.fr/blogs/guerin
VERS UNE ETHIQUE CONCRETE DE LA SOLLICITUDE ?
Présenté par Serge Guérin
20-12-2015
La société Française est pour une bonne part une
société d’aidants et de personnes gravement malades, en déficit ou en perte d’autonomie… Plus de la moitié de la population est directement concernée : aidants, personnes vivant à domicile et
régulièrement aidés par un proche, personnes en ALD, à mobilité réduite, atteintes de déficience sensorielle… En fait plus de la moitié de la population française est concernée.
Et les autres sont loin d’être assurés de ne jamais l’être… La hausse continue des maladies chroniques, associé à l’augmentation de l’espérance de vie des personnes en fort déficit, ou le
vieillissement fragilisé va encore renforcer ce fait.
Devant la chronicisation de la maladie, ne peut-on pas repenser la notion de bonne santé ? Des millions de personnes vivent en étant soignée, sont-elles malades en bonne santé ? Des millions de vieux vivent en pleine forme, sont-ils en bonne santé ? Une grande part de ces personnes est autonome dès lors qu’elles bénéficient du bon traitement, des bonnes adaptations. Une des ruptures majeures reste celle de l’apparition des trithérapies pour contrecarrer les effets du Sida : les malades qui avant devaient être hospitalisés sont suivi et accompagnés mais peuvent vivre d’une manière très proche du « normal ». Restons sur le Sida. C’est aussi à travers la mobilisation des malades – et de relais dans les médias et le monde politique- que le monde de la médecine et de la recherche médicale a fini par prendre en considération les ravages épidémiques de la maladie. Cela aura été l’an I de la prise de pouvoir des malades et de leurs proches. La déclaration de Denver portée par les premiers militants de la reconnaissance du Sida, en 1983, résume bien une exigence démocratique qui va bien au-delà des enjeux de santé : « Rien pour nous sans nous ».
Finalement, devant la chronicisation de la maladie, la médecine est plus proche du care que de la cure… Elle a pour métier non pas de soigner définitivement, mais de composer, de trouver des compensations, d’accompagner et expliquer, de favoriser de nouveaux comportements… Le soignant est pédagogue et accompagnant. Il est largement aidé par l’aidant de l’aidé qu’il devrait aussi prendre en soin, accompagner et écouter.
A cette tendance majeure s’ajoute une transformation structurelle de l’économie de la santé avec l’hospitalisation à domicile qui prend une place croissante. En clair, l’hôpital tend à externaliser le soin chez la personne. L’entourage s’en trouve encore plus sollicité, encore plus aidant.
Société de l’interdépendance
Il est essentiel que l’éthique de sollicitude ne se retrouve pas détournée pour justifier et favoriser le recul de l’Etat, Il y a une autre lecture du care, que je relie au solidarisme, doctrine sociale initié par Léon Bourgois et d’autres à la fin du 19eme. Il s’agit là d’inscrire la solidarité dans le concret, en partant de la société civile plutôt que de directives venues d’en haut. L’objectif des solidaristes était déjà de permettre à chacun de faire son chemin. Une société n’est pas l’agrégat de volontés autonomes mais se définie par le sentiment d’interdépendance entre les personnes. Dans ce cadre, le soin mutuel prend son sens. Il faut donc que l’Etat soit présent pour construire des filières valorisées autour des métiers du soin, cela implique des efforts de formation et déroulé de carrière et de renforcer le nombre d’intervenants professionnels, mais aussi de mettre des moyens pour accompagner les professionnels comme les aidants informels, pour réaliser des plates-formes de soin (Centres de la santé où les professionnels du soin travaillent ensemble et de manière transversale en privilégiant l’accompagnement et le suivi, hôpitaux, lieux d’accueil et de soutien à la petite enfance, aux très âgés, aux handicapés, aux fragiles, …), pour construire et valoriser les filières autour des services à la personne. Un des enjeux majeurs est d’intégrer l’accompagnement médical, avec l’écoute et le conseil, l’éducation thérapeutique…
Il importe donc de mettre en place une véritable stratégie de santé publique accompagnant les aidants. La Loi d’adaptation de la société au vieillissement porte pour la première fois des avancées et surtout une prise de conscience. Elle reconnaît le rôle des aidants et ouvre à des droits spécifiques. En particulier, elle permet, mais de manière bien trop limitée, d’instaurer un droit au répit pour les aidants. Le soutien aux aidants passe par la possibilité pour ces derniers d’avoir du temps pour soi, pour respirer, pour penser… Le projet de Maison du répit à Lyon, porté par la Fondation France Répit, les initiatives prises par certaines collectivités comme le Conseil Départemental du Nord-Pas-de-Calais, l’initiative de l’Ehpad Saint-Joseph à Strasbourg d’accueillir le jour des personnes âgées en fort déficit d’autonomie permettant à leur proche aidant de s’évader un peu montrent que la richesse des innovations sociales. Ces initiatives proviennent de collectivités territoriales mais aussi et surtout d’associations, d’entreprises ou encore de collectifs informels. Cette société civile produit de la solidarité concrète, s’organise, s’autonomise par rapport à un Etat trop gras, trop peu efficient, trop loin…
Pour autant, il ne s’agit pas que ce dernier se lave les mains de la situation, en profite pour laisser les individus, les familles en particulier, agir seuls. C’est à la collectivité nationale de soutenir un cadre, de proposer une vision, de procéder à des choix et des arbitrages financiers pour, par exemple, démultiplier les Maisons des aidants, renforcer le nombre et la formation des intervenants professionnels, d’instaurer un réel droit de compensation sociale pour les aidants en activité professionnelle, de développer des mesures fiscales ou administratives favorisant la vie quotidienne des aidants…
C’est une Loi d’adaptation de la santé à la longévité qu’il faudrait inventer…
Serge Guérin est sociologue, directeur du Msc “Gestion des établissements de santé”, à l’INSEEC Paris.
Il est membre du conseil scientifique du PRé
Derniers ouvrages publiés : « La Silver Génération. 10 idées fausses à combattre sur les seniors », Michalon.
LES MEDICAMENTS ET MOLECULES CHIMIQUES SONT-ILS LES « NOUVEAUX CONTAMINANTS » DE NOS ENVIRONNEMENTS MARINS, RIVIERES, EAUX PROFONDES ET SOUTERRAINES EN FRANCE EN 2015
Présenté par le groupe de travail "Pollutions, risques sanitaires non maîtrisés, gestion des déchets et énergies renouvelables" (animé par François Caillaud)
Octobre 2015
Quel(s) impact(s) sur l'environnement et la santé ?
Depuis plusieurs années, la question se pose sur la présence dans les milieux aquatiques (eaux de surface, eaux souterraines) et dans l'eau potable, à l'état de traces, de résidus de médicaments, ainsi que sur leurs effets sur l'environnement et la santé.
Or il n'existe pas actuellement de réglementation sur les normes et valeurs de référence à respecter et qualifiant l'impact et la présence des résidus de médicaments dans les eaux.
Il en existe pour certains micropolluants (substances susceptibles d'avoir une action toxique à faible dose dans un milieu donné : de l'ordre du nano ou du microgramme par litre d'eau).
Outre les produits immédiats qui peuvent être retrouvés dans l'eau, les effets des mélanges et d'interactions possibles avec d'autres polluants déjà présents dans les milieux aquatiques (par exemple chimiques ou pesticides), appelées parfois effet « cocktail », ne sont pas forcément connus.
A ces différents éléments vient s'ajouter la préoccupation du renforcement de l'antibiorésistance des bactéries (résistance des bactéries aux antibiotiques) dans l'environnement, mises en contact prolongé et répété avec des résidus d'antibiotiques.
La nature chimique et microbiologique des « eaux usées » se complexifie au rythme des progrès en recherche et développement des industries et Laboratoires identifiés et agréés.
La France est le 4e consommateur mondial de médicaments.
Qu'ils soient à usage humain ou vétérinaire, la France est le 1er marché de l'Union Européenne.
Ainsi, plus de 3 000 principes actifs à usage humain et 300 à usage vétérinaire sont disponibles actuellement (source : Plan National Résidus de Médicaments).
Après la prise de médicaments par une personne ou un animal, l'ensemble du médicament n'est pas utilisé ou dégradé par l'organisme.
Ces résidus vont être évacués par les selles et les urines. Ils vont être retrouvés dans les rejets des eaux usées et les stations d'épuration (collective ou individuelle) ne sont pas équipées pour traiter ces molécules.
Après passage en station de traitement, elles vont être évacuées avec les eaux traitées vers le milieu naturel. Pour les rejets d'effluents issus des installations d'élevage : directement dans le milieu (activités piscicoles par exemple), ou par ruissellement, après épandage sur des sols agricoles.
Enfin, les médicaments non utilisés et jetés (dans l'évier, les toilettes) au lieu d'être ramenés à la pharmacie pour recyclage, vont se retrouver également dans ces effluents.
Il est « estimé » que 30 % de la pollution reçue par les 12 000 Stations d’épurations (STEP) françaises retourne directement dans les rivières sans traitement particulier…
Que font nos dirigeants politiques ?
Dans un communiqué de Presse datant de Mai 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement ainsi que le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé « reconnaissaient » que des molécules issues des médicaments humains et vétérinaires (antibiotiques, antidépresseurs, bêtabloquants, oncologiques , contraceptifs…) peuvent atteindre les milieux aquatiques.
Une étude réalisée par l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, en janvier 2011, montre qu’un quart des échantillons d’eau testés contiennent des traces de médicaments (caféine, antiépileptiques et anxiolytiques sont les plus représentés).
Elles proviennent principalement de nos urines et des déjections des animaux d’élevage.
Sur près de 30 000 tonnes de médicaments non utilisés par an, seules 13 000 tonnes sont récupérées dans les pharmacies.
Car que ce soit via les réseaux d’eau usée ou indirectement à travers les sols des décharges, en raison du ruissellement, ces résidus médicamenteux se diffusent dans les rivières comme
dans les nappes souterraines.
Depuis plusieurs années, la question se pose sur la présence dans les milieux aquatiques (eaux de surface, eaux souterraines) et dans l'eau potable, à l'état de traces, de résidus de médicaments, ainsi que sur leurs effets sur l'environnement et la santé.
Or il n'existe pas actuellement de réglementation sur les normes et valeurs de référence à respecter et qualifiant l'impact et la présence des résidus de médicaments dans les eaux.
Il en existe pour certains micropolluants (substances susceptibles d'avoir une action toxique à faible dose dans un milieu donné : de l'ordre du nano ou du microgramme par litre d'eau).
Outre les produits immédiats qui peuvent être retrouvés dans l'eau, les effets des mélanges et d'interactions possibles avec d'autres polluants déjà présents dans les milieux aquatiques (par exemple chimiques ou pesticides), appelées parfois effet « cocktail », ne sont pas forcément connus.
A ces différents éléments vient s'ajouter la préoccupation du renforcement de l'antibiorésistance des bactéries (résistance des bactéries aux antibiotiques) dans l'environnement, mises en contact prolongé et répété avec des résidus d'antibiotiques.
Une campagne nationale de mesure dans l'eau potable et les eaux destinées à la production d'eau potable a été confiée en 2009 par le ministre en charge de la Santé au Laboratoire d'Hydrologie de Nancy (ANSES).
Les réglementations européennes et françaises relatives à la qualité des eaux ne prévoient pas de rechercher les résidus de médicaments dans les EDCH…curieux ?
L’ANSES Maisons-Alfort, le 17 février 2013… AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à « Évaluation des risques sanitaires liés à la présence de résidus de médicaments dans les eaux destinées à la consommation humaine : méthode générale et application à la carbamazépine et à la danofloxacine » les choses suivantes :
· En termes d’exposition, peu de données robustes sont disponibles quant à la contamination des EDCH en France par les résidus de médicaments et surtout par leurs métabolites et produits de transformation.
· L’évaluation de la toxicité chronique des principes actifs se heurte à un manque de données, principalement pour les médicaments à usage humain, parce qu’elles sont, soit inexistantes, soit inaccessibles.
· L’ensemble de ces limites rend l’évaluation quantitative du risque difficile et met en évidence un besoin d’études de toxicité chronique sur les résidus de médicaments et sur leurs métabolites et produits de transformation en vue de pouvoir établir des VTR.
· Toutefois, afin d’établir des valeurs toxicologiques de référence robustes pour une exposition chronique par voie orale, l’Agence souligne la nécessité de disposer d’études de toxicité chronique pour les résidus de médicaments mais aussi pour leur métabolites et produits de transformation pertinents.
Conclusion :
Comment avancer plus vite sur ces domaines de santé public avec une coordination plus rapide, transparente et accessible au public et Collectivités ?
Bien qu’elles ne soient pas toujours accessibles, de nombreuses sources de données sur les effets des médicaments sur la santé existent, parmi lesquelles :
· les dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et les bases de données des Agences de surveillance des médicaments (Ansm, ANMV, Agence européenne du médicament (EMA), etc.)
· les documents d’organismes de sécurité sanitaire (OMS, US-EPA, RIVM, Santé Canada, etc.) ;
· la littérature scientifique.
· Il apparait évident qu’il faut continuer avec des études épidémiologiques longues et diverses.
· Ces études (larges et ciblées) sont les préalables indispensables à toutes réglementations nouvelles, modifications des décrets et cahier des charges des STEP à ce jour.
· Les régies et/ou les opérateurs privés qui exploitent nos STEP en France ne peuvent faire évoluer les techniques de traitement ad hoc tant que la Puissance Publique et le Ministère n’auront pas fait avancer très vite ces études à spectre plus large.
D’UNE OBLIGATION DE DEPENSE A UN INVESTISSEMENT IMMATERIEL : ALLONS JUSQU’AU BOUT DE LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Présenté par le groupe de travail "Dialogue social & Démocratie sociale" (animé par Philippe Debruyne)
Septembre 2015
La dernière réforme de la formation professionnelle, négociée par les partenaires sociaux en 2013 et traduite dans la loi du 5 mars 2014[1] est tout sauf une réformette. Elle l’est tellement peu qu’elle a bousculé tous les acteurs par la radicalité de ses changements de perspective. A telle enseigne que la principale critique qu’on pourrait lui adresser est de ne pas avoir suffisamment pensé l’accompagnement des mutations qu’elle impose.
Création du Compte personnel formation en lieu et place du Droit individuel à la formation, obligation d’organiser tous les deux ans un Entretien professionnel dans l’entreprise, organisation d’un Conseil à l’évolution professionnelle hors les murs de celle-ci, chacun de ces droits nouveaux nécessiterait explication et analyse critique.
Mais l’objet de notre propos touche à la question du dialogue social.
Depuis 1971 en effet, le levier de la formation professionnelle était d’abord fiscal. C’est l’obligation de dépenser qui était le « tigre » dans le moteur, selon l’expression de Jacques Delors, l’un de ses principaux concepteurs. Pour la première fois dans l’histoire des réformes de la formation professionnelle, cette obligation est désormais circonscrite aux contributions mutualisées : une contribution unique de 1% de la masse salariale des entreprises est ainsi mobilisée pour financer le Compte personnel formation (CPF), le Congé individuel à la formation (CIF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), la Professionnalisation (périodes et contrats).
En revanche, au-delà de ce « bien commun », il n’y a plus d’obligation de dépenser une somme d’argent prédéfinie par l’Etat dans le cadre du plan de formation des entreprises de plus de 300 salariés. La loi a en revanche intégré toutes les obligations de former construites peu à peu par la jurisprudence. Mais il s’agit d’obligations qui ne sont opposables que lors de la rupture du contrat de travail. L’enjeu est bien que cette obligation s’inscrive dans les pratiques RH au long cours et concerne tous les salariés, et pas seulement ceux sur qui l’entreprise parie !
A l’heure où tous les budgets de l’entreprise sont passés au crible des contrôleurs de gestion et du reporting financier, les interrogations sont fortes sur le maintien de l’effort de formation des entreprises. Une autre critique procède de la pluri-annualité du développement des compétences : les efforts de formation sont souvent réalisés selon des cycles de trois ans, correspondant notamment au temps de renouvellement d’un certain nombre de technologies nécessitant des compétences associées. De ce point de vue, la mutualisation des 0,9% de la masse salariale à destination du plan pouvait servir de levier de financement pluriannuel.
A l’inverse, on peut remarquer que les efforts consentis par les entreprises de plus de 300 salariés sur leur plan de formation sont globalement bien supérieurs aux 0,9% qui étaient jusqu’alors obligatoires (de l’ordre de 2% pour les entreprises entre 250 et 500 salariés et davantage au-delà[2]). Et la réforme renforce également la capacité des représentants du personnel à contrôler les efforts réels de formation, notamment par trois rendez-vous avec le Comité d’entreprise : consultation sur les orientations à trois ans de la politique de formation, en lien avec la stratégie ; consultation sur le bilan du plan de formation N-1 et année en cours ; consultation sur le plan de formation N+1.
De ce point de vue, les axes du plan de formation sont toujours définis en deux catégories : les actions d’adaptation au poste de travail et plus généralement de maintien de l’emploi (catégorie 1) et les actions de développement des compétences (catégorie 2).
En revanche, il est désormais nécessaire que la direction formalise les suites qu’elle envisage en termes d’opportunité d’évolution professionnelle du salarié, et plus uniquement (comme c’était précédemment le cas) lorsque la formation a partiellement lieu en dehors du temps de travail. Vertueuse dans le principe, cette nouvelle contrainte risque d’inciter l’employeur à classer toutes ses actions de formation en catégorie 1. Sauf si…
De l’obligation fiscale au contrôle social
Dans les débats autour de la réforme de la formation professionnelle, le terme d’investissement a fait florès. François Rebsamen a même indiqué, pour qualifier la réforme, que « l’effort de formation des entreprises est redevenu ce qu’il aurait toujours dû être : un investissement pour la performance et pas un exercice imposé ».
A une petite nuance près, c’est que la notion d’investissement n’est pas anodine : elle a même une traduction comptable très précise.
Dans le budget d’une entreprise, les investissements sont répartis sur plusieurs années (selon des normes comptables basées sur la durée où ils seront raisonnablement amortis) et se retrouvent dans les immobilisations, ou dotations aux amortissements.
Très concrètement, ils ne « grèvent » le budget que de leur coût divisé par le nombre d’années d’amortissement. Second intérêt et pas des moindres, les dotations aux amortissements ne sont pas incluses dans l’EBITDA[3], principal indicateur de la santé économique d’une entreprise, qui donne à voir sur le profit généré par son activité.
C’est un indicateur d’autant plus structurant pour le pilotage stratégique et financier qu’il est scruté par les marchés.
Suite à la réforme, un groupe de travail a été créé par la DGEFP[4] pour « étudier la possibilité d’appliquer la technique de l’amortissement, notamment de manière extracomptable, pour les dépenses de formation professionnelle ». Il y a évidemment des considérations très techniques à instruire. Il y aurait aussi une « doctrine » à construire sur le rapport entre les compétences développées, les certifications associées et les durées d’amortissement.
Cela renvoie également à des considérations autour de l’obsolescence potentielle de certaines compétences. Mais toutes ces questions de spécialistes ne doivent pas nous faire perdre de vue l’enjeu politique et de démocratie sociale d’un tel projet !
Si en effet les actions de développement des compétences (catégorie 2 du plan de formation) étaient considérées comme un investissement immatériel et, ce faisant, éligibles à la dotation aux amortissements, cela signifierait qu’un langage commun pourrait réunir, dans une dynamique renouvelée de dialogue social, direction financière, direction des ressources humaines et instances représentatives du personnel. Identifier des actions de formation de catégorie 2 pourrait en effet intéresser toutes ces parties prenantes pour, respectivement, accroître la profitabilité de l’entreprise, réduire les charges annuelles du plan de formation et contribuer à l’élévation du niveau de compétences (et donc d’employabilité) des salariés.
Une telle mesure, techniquement complexe mais simple en termes de compréhension partagée, serait de nature à substituer à l’obligation fiscale de « dépenser de la formation », un véritable outil de contrôle social, par le Comité d’entreprise et les organisations syndicales représentatives, de la politique de formation, de développement des compétences et de sécurisation des parcours conduite par la direction.
Ce serait donner vie, dans le dialogue économique et social effectif de l’entreprise, au concept de « capital humain », défini par l’OCDE[5] comme « un bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité, l'innovation et l'employabilité ».
[1] Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
[2] Exploitation des déclarations fiscales 24-83 (www.cereq.fr)
[3] Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, ou en français : Bénéfices Avant Intérêts, Impôts et Amortissements
[4] Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, rattachée au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
[5] L'investissement dans le capital humain, OCDE, 1998 ; Du bien-être des nations, le rôle du capital humain et social, OCDE, 2001.
EUROPE & DEFENSE, la nécessité d'une volonté politique forte et renouvelée
Par le groupe de travail "Sécurité & Défense" (animé par Gilles Sohm)
Août 2015
Depuis la fin de la guerre froide, nous sommes entrés de nouveau dans une période d'instabilité stratégique ; le temps des deux grands blocs, « assurés d’une destruction mutuelle » (Mutual Assured Destruction MAD) qui se faisaient face sans que l’un ou l’autre puissent espérer remporter une éventuelle confrontation est révolu. La période qui l'a immédiatement suivie, a été celle de l’hyper puissance américaine et de sa domination militaire (aujourd’hui, 38 % des dépenses militaires totales dans le monde, sont le fait des seuls USA (1).
Cette période semble aujourd’hui toucher à sa fin et ce pour deux raisons. D’abord l’usage de cette hyper puissance s’est montrée inefficace en Irak et en Afghanistan où le déploiement de force n’a rien résolu et l'élimination par des forces spéciales américaines d'Oussama Ben Laden n'y change rien. Ces deux pays sont dans une situation de chaos total dont les premières victimes sont les populations locales et où finalement il apparaît, en Irak pour le moins, que de grandes sociétés américaines profitent plus de la manne de la reconstruction que les citoyens de ce pays. Ensuite, ont émergé une autre puissance de taille mondiale, la Chine, et des puissances régionales ou moyennes comme le Brésil, l'Inde, la Turquie, l'Afrique du Sud le Pakistan et quelques autres, détentrices d'armes nucléaires et bien décidées à faire entendre leur voix sur la scène internationale ; ce qui est parfaitement légitime. Nous sommes donc confrontés à la renaissance d’un monde multi polaire, où malheureusement l'Europe ne s'affirme pas.
Comme écologistes et républicains, nous élevons au cœur de nos valeurs l'humanisme et le respect de la vie. Cependant nous savons également que nous ne pouvons aborder ces questions uniquement animés par nos bons sentiments, si généreux soient-ils. L'Histoire nous a tragiquement appris qu'il fallait parfois faire face à la barbarie et même qu'il fallait être capable de s'y opposer y compris par la force.
Faut-il rappeler les funestes conséquences de la faiblesse des démocraties occidentales à Munich en 1938 face à l'expansionnisme nazi ?
Une nouvelle donne stratégique
Nous avons à peine eut le temps de nous féliciter du succès de la construction européenne, du strict point de vue de la stabilité stratégique, car pour le reste c'est un autre débat, qu'il nous faut réfléchir aux nouveaux enjeux stratégiques et aux risques qu'ils génèrent. Le monde évolue rapidement et peu de signes sont encourageants pour la paix et la stabilité, nombreux sont les sujets d'inquiétude, de DAESH à l’Ukraine en passant par la tendance au réarmement dans la zone Asie - Pacifique.
Un premier constat, le modèle de surexploitation des richesses naturelles (pétrole et autres énergies fossiles, eau, matières premières, terres arables …) génère des rivalités et des tensions porteuses de déstabilisations pour la sécurité du monde et d'affrontement voir de guerre ouverte pour la conquête et la maitrise de celles-ci. La justesse de nos analyses sur le caractère éminemment dangereux, voir intrinsèquement générateur de conflit de ce mode de développement, ne nous protègera malheureusement pas de ces tensions internationales dans le futur.
Nous sommes persuadés que la transformation écologique de la société, comme la réduction des inégalités sociales dans le monde, seront de nature à réduire ces risques, voire même à les éliminer, en assurant une meilleure allocation des ressources et un mode de développement raisonnable centré sur le bien être des hommes et des femmes. Toutefois, quelque soit la force de notre engagement, nous devons bien reconnaître qu’il y a un chemin considérable à parcourir pour accompagner cette transition sans heurts et de manière pacifique.
Par ailleurs, la déstabilisation des pouvoirs dictatoriaux du monde arabe, qui par les printemps arabes furent une source d'espoir et de confiance en l’émergence d'une paix juste et durable comme en Tunisie, ont aussi débouché sur le pire des cauchemars comme en Syrie. Les conséquences dans cette région si proche de l'Europe, nous rappellent aujourd'hui, avec les conséquences les plus dramatiques, comme hier dans l'ex Yougoslavie, que face aux terribles conséquences sur les populations civiles, il est indispensable de disposer d'un outil militaire performant, pour éviter que les pires drames ne se perpétuent. L’émotion légitime récemment suscité par les drames que subissent les réfugiés syriens doit, en corolaire de l’accueil humanitaire que nous devons leur apporter, nous inciter à une réflexion sur notre contribution à la construction d’un avenir pour ces peuples et dans la phase intermédiaire à la résolution de ces conflits y compris par l’emploi de moyens militaires.
Le non sens de l’alignement atlantiste
Cependant, si nous acceptons cette nécessité, quel regard portons nous sur la politique conduite par notre pays ? L’arrivée de Nicolas SARKOZY à la Présidence de la République, avait marqué pour la France une part de renoncement à l’indépendance de sa stratégie de défense en réintégrant le Commandement militaire de l’OTAN et ce, sans obtenir d’avancées importantes en matière de concept stratégique, ni de renforcement du pilier européen, pas plus que de partage des responsabilités au sein de l’alliance(2). L'OTAN est et demeure une alliance sous protection américaine, c'est à dire que dans les faits la sécurité de l'Europe et sa capacité à peser sur certaines grandes questions dépend d'un Etat extérieur au continent et à sa construction politique. Cette réalité pose trois types de problèmes majeurs.
D'abord l’indépendance et la souveraineté sont des conditions du plein exercice de la démocratie. Une entité politique, qu’elle soit nationale ou supra nationale, ne peut prétendre à la réalité de son fonctionnement démocratique si elle n’assume pas pleinement sa propre sécurité. Si un pays, ou une entité supra nationale, comme l’Union européenne, dépend d’un tiers pour assurer sa sécurité permanente, elle est par voie de conséquence perméable aux pressions que pourrait exercer ce protecteur. C’est toute l’ambiguïté de la place des européens au sein de l’OTAN. Comme corollaire, la présence au sein de l'alliance nous conduit à une proximité fâcheuse et à des risques d'assimilation politique que nous refusons. Rappelons nous que la, au combien fondé, décision de ne pas ce joindre aux Etats-Unis lors de la deuxième guerre d’Irak a été possible grâce à l’indépendance du renseignement satellitaire français (système Hélios) qui apporta la preuve à nos décideurs que les informations exposées par l’Administration Bush relevées de la simple mystification.
Ensuite, la délégation de défense est en réalité comme souscrire une assurance qui ne couvre pas tous les sinistres. De fait il est hasardeux de croire qu'une alliance militaire constitue une garantie de sécurité absolue. La Défense doit être assumée par ceux dont elle assure la sécurité et l'indépendance, que ce soit à l’échelon national ou européen. Les exemples sont nombreux du danger d’une telle politique. Ceci est d'autant plus vrai que le centre de gravité des intérêts stratégiques des Etats-Unis a basculé vers le Pacifique et l'Asie. Il n'y a là aucun reproche à faire à l'Administration Obama, il nous faut simplement être lucide et assumer nous même notre avenir et l'exercice de notre souveraineté. La politique de réduction drastique des effectifs conduite pendant le quinquennat précédent nous a amenée à dépasser les limites au delà desquelles nos forces armées ne sont plus capable d’accomplir les missions que nous leurs assignons. Le redressement amorcé sous la présidence de François Hollande est bien le minimum pour faire face à la multiplicité des menaces et en particulier les missions de protection des populations sur notre territoire dont l’impérieuse nécessité a été rappelée par les événements de janvier et les autres qui ont jalonnés l’année 2015.
Le dernier problème que pose la délégation à autrui, de la politique de défense, est d'ordre démocratique. En effet, comment justifier le transfère du risque de vie ou de mort que prennent les hommes et les femmes des forces armées pour notre sécurité, sur des jeunes gens issus de la société américaine et pour être plus précis des catégories sociales les plus défavorisées de celle-ci ? Il y a là pour le moins sujet à interrogation. Le problème se pose également d'un point de vue de la légitimité, une intervention armée doit être approuvée par le corps social, Nation ou Union européenne. C'est à dire que ceux qui la conduisent doivent être issus du corps social au nom duquel elle est menée et bénéficier de son soutien.
Le choix de la délégation de responsabilité militaire apparait finalement comme une forme de retour au mercenariat.
Relancer l'Europe de la défense
L'affirmation d'une Europe politique passe aussi par l'émergence d'une politique de défense autonome. On ne peut séparer la question de la construction d’une Europe politique de celle de la constitution d’une défense européenne, elles sont con-substantiellement liées. Pour saisir l'importance de l'enjeu il convient de se rappeler que la voix de l'Europe ne portera dans le monde que si celle ci est indépendante et libérée de toute influence. De la même manière, nous ne pouvons prétendre à la force de notre message de transformation écologique et social des rapports internationaux, à l'adoption de mesures sociales et environnementales si nous subissons une forme de dépendance en matière de sécurité. L'indépendance en matière de Défense est l'une des conditions d'une diplomatie efficace, nécessaire à l'adoption de règles environnementales et sociales dans la mondialisation.
Il faut donc remettre sur le métier l'ouvrage de la construction d'une défense européenne. Cependant soyons clairs, le parcours sera long et difficile. Nous partons de loin, et même si le projet d'une défense européenne est apparu dès 1992 dans le Traité de Maastricht, la réalité opérationnelle de celle-ci reste un objectif lointain.
Cette situation est paradoxale car dans le même temps on constate que la plupart des interventions militaires auxquelles les forces françaises participent sont conduites dans un contexte multilatéral. A l’exception de l’intervention au Mali ou nos forces étaient désespérément seules à l’exception notable du soutien du Danemark. Aujourd'hui, et vraisemblablement encore plus à l'avenir, nous ne seront plus seuls sur le terrain et ce, autant par nécessité politique, la constitution de coalitions internationales comme source de légitimité, que par obligation opérationnelle. Aucun Etat européen ne dispose aujourd'hui des moyens nécessaires à la conduite d'une opération de grande envergure dans la durée. Le besoin d'Europe est donc évident mais la politique ayant horreur du vide, c'est l'OTAN qui remplit cette fonction.
L'Agence Européenne de Défense (AED) fait malheureusement figure de parent pauvre avec son budget annuel de quelques dizaines de millions d'Euros dont une faible part destinée aux crédits opérationnels. Comment peut-on croire qu'avec à peine plus d'une centaine de collaborateurs cette institution intergouvernementale placée sous l'autorité de Federica MOGHERINI, le Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pourrait avoir une influence significative pour l'émergence d'une authentique politique de défense entre les 26 Etats participants(3).
Alors que ce besoin est de plus en plus évident, l'Europe de la défense est en net recul. Bien sur, certaines coopérations demeurent, mais elles ont à peine le niveau et l'importance que celles connues avec les projets industriels bilatéraux ou multilatéraux dans les années 70 et 80. L’Union européenne n’a pas mis en œuvre les éléments d’une politique propre en matière de défense. Ainsi, elle ne dispose toujours pas d’une cellule de planification militaire (élément de base d’une convergence continentale) et, au contraire, elle a vu disparaître sa cellule de planification des affaires civiles (actions corolaires de types humanitaires, administratives, sociales... des interventions armées). C’est pourtant l’absence de réflexion en la matière qui explique pour une large part la catastrophe irakienne et le fiasco libyen.
Pire même, le « Paquet défense » constitué de deux Directives européennes sur les ventes de matériels militaires ne contribue pas à renforcer la sécurité de l'Union et est même dangereuse en matière de vente d’armes. Ces Directives(4) prévoient une libre circulation des matériels militaires parmi les Etats membres au nom de la sacro-sainte concurrence et elles instaurent le contrôle à postériori. Pourtant, le matériel militaire n'est pas une marchandise « banale », son commerce international comme au sein de l'Union européenne doit être fortement réglementé et soumis à un strict contrôle politique. De plus, cela conduit à des risques réels de réexportation vers des clients non désirés de matériels vendus dans un premier temps à un Etat éligible pour la vente mais lui même peu scrupuleux en matière de réexportation (pratique courante pour contourner les mesures d'embargo sur les ventes d'armes).
Soyons clairs, cela est inacceptable. Nous avons besoin au contraire d'un plus grand contrôle et celui-ci doit s'exercer à priori par le Parlement et non plus seulement par l’exécutif.
Ces questions ont repris une brulante actualité, nous devons nous en saisir et les aborder sans tabou mais avec lucidité et conviction. L’écologie politique, comme force de gouvernement ne peut faire l’économie d’une réflexion sérieuse sur une politique de défense et de sécurité nationale et européenne réaliste, humaniste et portée vers l’avenir.
Alors, ouvrons ce débat ; ne le réduisons pas à des incantations pacifistes, aussi naïves qu’inopérantes, ne le déléguons pas non plus aux spécialistes, assumons en on l’importance démocratique.
Juin 2011 ("DEFENSE, LA NECESSITE D’UNE VOLONTE POLITIQUE EUROPEENNE FORTE ET RENOUVELEE" ), mise à jour Juillet 2015
(1) 640 Milliards de dollars sur un total de 1 702 Mds (Source : Stockholm International Peace Research Institut Military Expenditure Database 2013).
(2) Mise à part deux Commandements qui ont été attribués à des officiers français, le Commandement suprême allié chargé de la transformation des forces (ACT) à Norfolk en Virginie et le Commandement conjoint de la Force de réaction rapide (NRF) à Lisbonne au Portugal rien au sein de l'alliance n'a vraiment changé.
(3) Le Danemark n'est pas membre de l'Agence.(4) Directive du 6 mai 2009 (2009/43/CE) simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense et la Directive du 13 juillet 2009 (2009/81/CE) instituant la libre concurrence en matière de matériels militaires.
POUR UNE ECOLOGIE REPUBLICAINE
(esquisse)
Par le groupe de travail "Qu’est-ce que la République et qu'est-ce qu'une écologie républicaine?" (animé par Nathalie Krikorian-Duronsoy, Dominique Lévèque, Gilles Sohm et Guillaume Vuilletet)
Juillet 2015
La question écologique pose celle du droit de la nature et par voie de conséquence interroge notre conception moderne du droit, héritée des philosophes du XVIIIème siècle. En pensant l’autonomie de l’humain, ils ont placé l’Homme au centre de l’univers. Mais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’optimisme de cette philosophie du droit a fait place à une forme de pessimisme conduisant, parfois, à une mise en cause radicale de l’humanisme universaliste, tel que l’ont pensé Kant et Rousseau au siècle des Lumières. [1] C’est un des pièges dans lequel, une certaine critique écologique de la civilisation occidentale, peut tomber, en se positionnant contre la démocratie et les valeurs républicaines.
On observe dans l’histoire récente du mouvement écologique, deux formes de tentations vers lesquelles se tournent les partis défendant une vision réactionnaire de l’écologie. Une certaine critique de la civilisation occidentale conduit l’idéal écologique à deux formes de déviations idéologiques, à deux types d’écologismes, de droite, et de gauche. Tous deux sont animés d’un même « mépris pour la social-démocratie formelle ».
Le défi, lancé par une écologie moderne, à la tradition humaniste, ne doit pas se réduire à l’un ou l’autre de ces deux penchants pervers. La revendication d’une certaine qualité de la vie repose en effet, sur la base d’une « éthique de l’authenticité, du souci de soi » et d’autrui.[2]
Le projet écologique est vecteur d’un idéal démocratique pensé à l’échelle du monde. L’écologie est porteuse, en son fond, des valeurs du triptyque républicain dont la France est l’héritière : la Liberté, dans la conscience de la responsabilité à l’égard d’une nature que l’Homme a, depuis la nuit des temps, tenté de maîtriser pour sa survie et son bien être, l’Egalité, dans la conscience de l’unité du genre humain et, la Fraternité, qui est au cœur du projet écologique, car c’est bien dans la solidarité de tous, que l’écologie puisera la force de réussir le formidable défi qui l’anime : préserver la planète, afin d’offrir une vie meilleurs aux générations futures.
Les théories fascistes, ou le nazisme, hier, le totalitarisme islamique ou les partis nationaux populistes, aujourd’hui, ont en commun de rejeter ces éléments, fondateurs de notre culture démocratique occidentale. Le déracinement qui est une des figures de l’autonomie, et l’innovation qui réalise l’idée de progrès, s’opposent, en effet, aux revendications identitaires lorsque celles-ci réduisent les individus à leurs appartenances culturelles, coutumières, nationales, locales aussi bien qu’à leurs origines ethniques.
L’écologie européenne s’est coulée dans le moule de l’idéologie du droit à la différence contre l’uni-dimensionnalité du monde moderne. Sa logique est celle de la préservation des identités contre le métissage et par conséquent, contre l’assimilation aux valeurs démocratiques de sociétés, qui sont entrées depuis des siècles dans la modernité, et n’ont depuis, cessé d’innover. En France, l’écologie dite radicale propose une version gauchiste de l’idéal écologique. Elle s’appuie sur une vision communautariste des relations entre les hommes.
Le projet d’une écologie réaliste et républicaine refuse de se fonder sur les différences entre les groupes ou les individus et s’appuie, au contraire, sur ce qui les rassemble. Le grand défi de l’écologie contemporaine est celui d’une Humanité unie vers un même but : la préservation de la nature et de l’environnement pour un mieux être de tous les individus et des générations futures. La morale ou l’éthique d’une telle démarche repose sur la conscience de l’unité de l’espèce humaine et sur l’immense espoir d’une fraternité universelle. Les écologistes républicains posent le défi d’une écologie dont le projet concerne l’humanité tout entière. L’objectif est de s’unir pour travailler dans la même direction : pas seulement préserver la planète mais protéger l’univers dont l’Homme est responsable par-delà le temps d’une vie et l’espace qu’il occupe.
Les philosophies anti-humanistes, partagent un souci de l’enracinement dont certains discours écologistes se nourrissent. Mais l’écologie ne se réduit pas à ce fameux retour à la nature et aux coutumes ancestrales de la vie paysanne, accompagné d’un certain folklore culturel, de la manière de se vêtir, à la manière de se nourrir. Aujourd’hui, l’agriculture biologique, moquée il y a à peine 20 ans, est prise au sérieux par des gens qui ont le souci de leur santé, et les moyens économiques de se procurer le meilleurs en la matière, mais ne ils veulent pas pour autant changer de mode de vie. Le Larzac ne fait plus recette mais le Bio devrait être accessible à toutes les bourses.
L’idée, tyrannique, du renoncement à tout ce qui relève de l’artificiel, du non- naturel, comme nos Smartphones, ou les dernières avancées en matière de technologies numériques et de découvertes scientifiques confine à une forme de régression mentale, à laquelle la plupart des citoyens éclairés refusent d’adhérer. Cette vison utopiste, autant que ruineuse, d’une écologie qui prône la décroissance n’a que peu de prise sur les populations des pays développés et peut être interprétée comme une des causes de l’échec actuel de l’écologie, à convaincre. D’autant que, face au monde occidental, les pays émergents marchent à contre courant d’une telle philosophie naturaliste : l’Inde, la Chine, l’Afrique sont à la recherche de leurs propres voies de développement et se soucient d’autant moins de la question écologique, qu’elle est présentée, par les pays riches, sous le totem de la décroissance.
Les femmes ont été les premières bénéficiaires du progrès, dans ses innovations médicales et techniques. Le retour de l’accouchement à la maison et aux coupelles menstruelles a quelque chose d’effrayant, de risible et de pathétique à la fois.
Qui a envie d’un tel « retour à la nature », au rigorisme ascétique de l’écologisme allemand, qui mobilise la jeunesse des quartiers underground de Berlin ? Une toute petite minorité dans le monde.
L’écologie a déjà pénétré les consciences, il lui reste à faire preuve de son réalisme social et économique. La transition, vers une gouvernance écologique, nécessite que soit repensés les fondements intellectuels d’une écologie moderne.
Et, lorsque l’écologie se vit comme un retour à des origines fantasmées de l’Homme, fusionnant avec une nature contre laquelle, au contraire, il lui a fallu lutter pour survivre, comme en témoigne des siècles d’études historiques, depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours, elle fait fausse route. Du reste, les catastrophes naturelles, on le constate presque chaque jour, n’ont pas disparu du quotidien de l’humanité. La relation spirituelle qui lie l’homme à la nature, qui s’était manifestée dans une certaine conception du Cosmos, chez les Grecs, ou l’idée du grand Tout, dont le mystère demeure, ne doit pas être occultée, mais le sentiment d’un infini qui nous dépasse, et renvoie, a contrario, à la finitude de notre condition, ne s’accompagne pas nécessairement du rejet de la modernité et de ses valeurs.
Une partie des écologistes français souhaite rompre avec un discours gauchiste et naturaliste, qui conduit à une impasse intellectuelle, morale et politique.
Ils veulent renouer avec les valeurs d’une vision universaliste de la nature, sans pour autant verser dans l’absolutisme.
Ces écologistes veulent s’appuyer sur l’idée républicaine du progrès, et réhabiliter la volonté d’innover. L’écologie n’a de racines, que celles de l’humanité, dans laquelle, chaque individu est à égalité avec tous les autres. La recherche du bien commun, du bien public, tel est le sens profond de l’idéal écologique, démocratique et républicain, français.
Mais cela conduit à la nécessaire prise de conscience, et à la compréhension des limites d’un monde qui ne s’intéresserait qu’aux développements de la technique, et qui ferait de celle-ci, une fin en soi, et non un moyen, au service d’une cause qui demeure, depuis le XVIIIème siècle, notre idéal : le bonheur de l’humanité. La technique doit demeurer au service des progrès d’une humanité orientée, c’est à dire d’une humanité qui donne sens à la vie, alors que le monde de la technique, sans limites, soustrait l’Homme à la conscience des valeurs. La technique, pour la technique, conduit l’Homme à l’oubli du rôle des valeurs, dont l’objectif est de donner un sens à son action, et d’orienter la destinée, d’une humanité responsable d’elle même.
C’est pourquoi, en son fondement, le projet écologique repose sur l’idée universelle que, dans la succession des générations, chacune prépare et éduque la suivante.
L’objectif d’une écologie républicaine ambitieuse n’est pas seulement de préserver la planète, mais de protéger l’univers, dont l’Homme est responsable, par-delà le temps d’une vie, et l’espace qu’il y occupe.
[1] « Les Lumières c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l’entendement mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Tel est la devise des Lumières. », Emanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières, 1784
[2] Cf. Luc Ferry, le nouvel ordre écologique, Grasset, 1992. Qui pose la question du lien entre « éthique de l’environnement » et démocratie, en opposition à « l’anti-modernisme radical » de certaines idéologies écologistes.
VERS UNE « SOCIAL ECOLOGIE » ?
Par le groupe de travail « Quel projet politique pour demain ? » (animé par Dominique Lévèque, Gilles Sohm, Guillaume Vuilletet)
Mars 2015
La période offre une formidable opportunité pour l’écologie politique (dans son attention aux limites naturelles de la planète, au changement climatique, aux pollutions eau-terre-air, aux gaspillages, aux risques techno-scientifiques, aux générations futures) de se ressaisir et de se réinscrire dans un mode opératoire et non plus seulement s’enfermer dans du rêve ou de l’incantatoire.
On voit bien la nécessité qu’il y a de réfléchir à ce qui pourrait servir non seulement de symbole, de marqueur de gauche, mais aussi qui donnerait à voir et à espérer un peu plus loin : repenser notamment une politique des « services publics », et au-delà, une politique du « commun » (1) qui serait susceptible de nourrir la matrice d'un projet politique.
Il ne s’agirait pas seulement de réveiller pour notre plaisir démodé la vieille figure des enclosures analysées par Marx et des commons anglais de Thomas More, encore que (sic !)
Mais, partant du constat que l'on assiste aujourd'hui à une nouvelle forme d'accumulation primitive, non plus seulement sur les terres, mais sur à peu près tout, sur le vivant comme sur les connaissances (les entreprises se jettent sur tout ce qui peut se transformer en brevets, en dividendes, en copyrights, en droits de péage), Il s’agirait de sortir de la fausse alternative «marché ou État» qui perdure encore aujourd’hui.
En réalité, les deux peuvent aller ensemble : en France, on associe le service public à l'État. Tout ce qui est étatique est réputé «social», «de gauche», «progressiste» (2).
Chacun est supposé jouir d'un même accès au service public d’éducation (l'école), au service public de santé (l'hôpital), à la sécurité (Police), aux moyens de transports, au logement, à la culture, au numérique, etc. mais outre le fait que c’est parfois formel, le citoyen est de plus en plus amené à devoir accepter en échange de se transformer en usager passif, laissant le monopole de la gestion à l'État. Nonobstant le travail utile des associations d’usagers de ces services publics.
Le commun, ce ou ces biens que nous avons en commun, ne pourrait-il pas se définir par l'égalité non seulement dans l'accès, mais aussi dans, sinon l'élaboration, du moins la co-élaboration des buts de l'activité ?
Le commun est ce qui fait l'objet d'une décision collective qui nous engage et nous oblige, dont nous nous occupons en commun (3). Il est usuel et fréquent de se représenter le commun sous la forme des ressources naturelles (l'eau, l'air, la forêt...), comme s’il était supposé qu'un certain type de biens possédait des qualités intrinsèques qui les feraient relever du commun. Le hic, c'est que ce raisonnement revient à confier de manière fictive à la nature la responsabilité de fixer à l'avance l'organisation des activités humaines !
Tel bien serait «naturellement» un commun, tel autre relèverait «naturellement» du marché, ou de l'État.
Or les choses communes, dans une longue tradition juridique et économique, c'est ce qu'il est impossible de s'approprier physiquement.
Un enjeu intellectuel serait peut-être de dénaturaliser le commun pour le politiser, pour se le réapproprier afin de le penser comme la formule même de la démocratie.
On sait bien, par exemple, qu’il n'appartient pas à la nature de la connaissance de devoir être partagée: pendant des millénaires, la connaissance est restée l'apanage de moines et de quelques-uns. C'est en réalité un choix collectif qui en a fait un objet de partage.
Le fait d'être un commun n'est donc nullement un trait éternel.
Cela dépend entièrement d'un acte politique, d'une décision de mise en commun (4).
Il ne s’agirait pas de se cantonner à une espèce de logique d'expérimentation locale, car il n’est pas douteux que cette méthode de contournement par l'extérieur soit suffisante.
Il ne s’agit pas ici de réactiver les conseils ouvriers, mais dans le secteur privé, il pourrait être fait valoir la nécessité de passer un cap après les lois Auroux, les atermoiements, les reculades et dévoiements qui n’ont cessé d’avancer depuis, en proposant de transformer l'entreprise pour en faire un lieu de meilleure démocratie.
Dans le secteur étatique, pourquoi la gestion des services publics n’associerait-elle pas salariés, usagers et citoyens ?
Le commun pourrait devenir un véritable principe politique qui irrigue tous les secteurs de nos sociétés. Peut-être même une alternative au néo-libéralisme dont la caractéristique principale aujourd’hui, on le voit quasi tous les jours n’est plus tant le laisser-faire que la construction active du marché…
Y compris en instrumentalisant l’Etat pour y arriver.
Redonner du sens au concept d’intérêt général, d’intérêt commun (comme les Grecs le dénommaient), d’utilité publique (les Romains), de bien commun (Moyen âge) ou encore de bien public usité chez Machiavel.
Cette réflexion serait de surcroît susceptible de donner du grain à moudre à qui voudrait conforter la gauche et ne craindrait pas d’envisager le dépassement d’EELV comme celui du PS d’ailleurs ou des autres appareils politiques à gauche.
Comme à qui voudrait bien ailleurs.
Le PRé pourrait ainsi réfléchir aux contours d’une nouvelle alliance entre République et écologie politique, mais aussi libéralisme politique, « écosocialisme », anticapitalisme/ altermondialisme, relativement souple dans la doctrine, précise dans le programme et irréductible dans les valeurs.
Capable donc de surmonter l’épuisement des partis traditionnels, tant au plan organisationnel, programmatique, politique et moral, capable de réhabiliter la notion d’usage et de droits d’usage et de lutter contre la tentation d’une « nouvelle enclosure du monde », c’est à dire d’une appropriation privée tous azimuts de biens qui passaient jusqu’à il n’y a pas si longtemps pour inappropriables, comme l’air, l’eau, le vivant.
Le mot n’est sans doute pas le plus adéquat tant il renvoie à un modèle, celui de la social-démocratie, qui ne correspond - dans sa méthode politique et son contenu - ni à la tradition ni à la réalité française, mais employons-le à défaut d’en trouver un autre pour l’instant : une sorte de « social-écologie» (5) ?
Il est vrai que la social-démocratie européenne s’est paradoxalement démonétisée, alors même que la crise économique de ces dernières années a marqué la faillite des théories libérales, et que l’on n’a pas manqué d’invoquer dès 2010-11 le retour à la régulation et le renforcement de la puissance publique.
Pourtant, les partis sociaux-démocrates, y compris ceux qui étaient au pouvoir en Europe du Nord, n’ont pas profité électoralement de ce nouveau contexte, que ce soit lors des élections européennes ou aux scrutins nationaux : au contraire, c’est à la quasi-faillite de la social-démocratie européenne à laquelle l’on a assisté.
Il ne s’agit évidemment pas ici de miser sur le fait que le modèle social-démocrate aurait atteint la fin d’un cycle historique, il convient juste de s’accorder sur les termes de cette crise en postulant qu’elle n’est pas synonyme de disparition mais de recomposition, dans laquelle l’écologie politique devrait pouvoir trouver sa place en se re-légitimant, et la gauche s’augmenter au lieu de se disséminer, de s’éparpiller façon puzzle…
Les enjeux de cette réflexion ne sont pas minces : comment faire en sorte que la transition écologique ne soit pas vécue comme une punition, soit mise au cœur du projet de société par les citoyens eux-mêmes ?
Comment faire en sorte de ne pas faire subir aux populations - à commencer par les petites et moyennes gens (6), une quatrième peine avec une transition écologique qui serait vécue comme une punition ? Alors qu’ils subissent déjà la triple peine avec la peine économique (chômage, précarisation…), politique (inégalité, protection amoindrie…) et morale (le sentiment d’humiliation) ?
Comment aussi ne pas tomber dans ce grand risque qui déjà pointe son nez : celui de la résignation aux inégalités, à la misère sociale, au durcissement des conditions de vie et de travail notamment des plus pauvres d’entre nous ?
Certes, la France n’est pas la Grèce, sauf que l’on découvre, effarés, que l’Allemagne, la première économie de la zone Euro, a des pauvres, et de plus en plus (12,5 millions vivraient sous le seuil de pauvreté).
Ce qui pointe son nez est cette espèce de légitimation de cette réalité par les contraintes extérieures, la mondialisation, les lois du marché qui font qu’on ne pourrait plus rien faire : refrain hélas bien connu. Le temps ne semble pas loin où les chômeurs seront déclarés responsables de leur situation. Cela a déjà commencé. Comme l’indifférence dans le reste de la population qui pourrait s’installer.
C’est là tout le défi d’une écologie politique soucieuse de la République : redonner de l’espérance, recréer de l’esprit démocratique et réhabiliter l’idéal.
En conciliant écologie, compétitivité et justice sociale. En faisant avec une Europe qui pour l’instant ne dessine plus d’avenir et s’est muée en théâtre du renoncement des dirigeants politiques et de désorientations des peuples, et dans une France minée par un confusionnisme politique qui brouille l’espace idéologique et par un néoconservatisme - par analogie avec les « révolutionnaires conservateurs » de l’Allemagne de Weimar - qui est en train d’effectuer un Hold up d’ampleur sur le patrimoine sémantique de la gauche : « critique », « critique du néolibéralisme », « critique de la finance et des banques », « critique de la mondialisation », « peuple », « République », « justice sociale », « laïcité », « écologie », jusqu’à « démocratie » et « décroissance ». Tout en frappant d’indignité les mots « Etat », « égalité » ou « assistance ».
Le fait est que peu à gauche en semblent conscients ou acceptent de le voir, et particulièrement dans cette « gauche de la gauche » qui semble toujours croire avoir la main en matière de critique sociale, alors qu’elle est en train de la perdre au profit du « politiquement incorrect » et d’un révolutionnarisme néoconservateur.
L’enjeu pour les écologistes est donc de recrédibiliser l’écologie politique, la réhabiliter par l’action, faire en sorte que l’écologie politique et/ou l’écologie dans les partis traditionnels (pour peu qu’ils la portent avec conviction et volonté) et plus sûrement dans une nouvelle forme d’arborescence politique, de concert avec les acteurs de terrain, aient une réelle capacité à faire évoluer notre société. Tant qu’ils resteront dans la posture, ils nourriront l’incompréhension de l’opinion publique, ils s’interdiront de peser sur les décisions qui fondent l’action publique, d’élaborer des solutions qui feront de la transition écologique le chemin de la sortie de la crise. Mais peut-être craignent-ils de favoriser l’émergence d’une force de profonde transformation sociale et économique, soucieuse d’impulser un mouvement vers une transition énergétique acceptable socialement, qui remettrait en cause leur « pré-carré » ? ?
Une écologie politique soucieuse du consentement des plus faibles comme des classes moyennes, dans la voie induisant un mode de production différent, économe en ressources naturelles, moins gourmand en énergie et en matières premières, promouvant une agriculture durable de qualité, et s’intéressant à la question des biotechnologies, de la chimie du végétal, du stockage de l’électricité…
Cette conviction de la nécessité d’un rôle opérationnel de l’écologie politique, et plus largement d’une écologie au centre du projet de société pour le bien-être du plus grand nombre nous amène à différents constats au plan de la politique française :
Jamais les écologistes politiques, ceux d’EELV en l’occurrence, n’ont été si peu influents que depuis qu’ils sont sortis du gouvernement, jamais ils n’ont parlé si peu d’écologie que depuis qu’ils sont dans une semi-opposition, jamais les écologistes ils n’ont été si peu en phase avec leur électorat que depuis qu’ils fantasment sur le mirage d’un Syriza à la française.
Signalons incidemment que la période offre une non moins formidable opportunité par ailleurs, pour les socialistes, pour la social-démocratie globalement (dans son attention pragmatique à des réformes structurelles dans une dynamique de transformation sociale, depuis Jean Jaurès et Otto Bauer), de se régénérer par l’écologie, en contribuant à la construction d’une force politique alternative face à la tentation sociale-libérale pesant sur la gauche.
Cela est à prendre en considération par les écologistes.
C’est également le cas pour toute autre sensibilité susceptible de venir élargir l’indispensable critique de la logique d’accumulation du capital autour d’une stricte logique de profit comme des « rapports de classes » qui lui sont associés. Pour toute composante, toute formation qui serait d’accord pour essayer d’articuler dialectiquement réformes structurelles et horizon radical d’une société émancipée du capitalisme.
On a besoin d’un nouvel horizon pour que les réformes ne s’engluent pas dans l’ordre existant des choses. Comme on a besoin d’une vision autre que simplement gradualiste et progressive du changement politique qui passerait à côté des ruptures et négligerait la capacité créative des affrontements sociaux, une vision qui remette en cause l’hégémonie d’un modèle de croissance irraisonnée, insoutenable socialement, injustifiable moralement, suicidaire politiquement.
L’enjeu reste malheureusement le même qu’en 2012 : promouvoir une écologie opérative et lutter tout à la fois contre un écolo-scepticisme ou un écolo-fatalisme.
Il s’agit de passer aux actes en favorisant maintenant un nouveau modèle de développement, en tant qu’également un nouveau mouvement émancipateur possible de l’humanité.
Les écologistes doivent se départir d’une posture strictement morale pour accepter enfin de faire de l’écologie politique, et non pas seulement par intermittence, accepter de mettre les mains dans le cambouis, bref arrêter de mettre leur imagination sans bornes au service du pas de côté, du sur place et du stérile, voire de la marche arrière, quand ce n’est pas parfois du pire. C’est pour cela qu’il n’est plus temps d’avoir des réticences, ou quelque crainte ou honte que ce soit à continuer de faire valoir une utopie possible, réalisable et à se donner les moyens de la mettre en œuvre comme à nouer les alliances nécessaires.
Sauf à faire définitivement de l’écologie un rêve, une option décroissante.
C'est un pari (raisonné), qui a devant lui des risques et des difficultés.
Plus celles et ceux qui participeront à l'initiative seront conscients tout à la fois de ce qui s'ouvre réellement et des problèmes qui pourraient refermer ce projet, plus l'aventure a de chances d'aboutir à quelque chose d'inédit et de stimulant. Ici, esprit d'aventure et lucidité autocritique doivent être impérativement associés, sous peine de retomber dans les conformismes et les langues de bois dont les gauches, y compris dites « radicales », sont si friandes...
"Optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence", aimait à répéter Gramsci !
Combiner l’expérimentation d’autres façons de vivre, de travailler et de décider ici et maintenant, la conquête d’une « hégémonie » culturelle (au sens gramscien, mais dans une logique clairement pluraliste), une transformation des institutions étatiques existantes, une dynamique de réformes structurelles et l’émergence de formes d’auto-organisation démocratiques.
Nous avons ici évidemment plus de questions, dans la mise en tension de pôles distincts de la transformation sociale, que de réponses unifiées et définitives. Mais « l’équilibration des contraires » chère au socialiste libertaire Pierre-Joseph Proudhon sera sans doute plus utile dans les mois qui viennent à la gauche et aux écologistes que la logique de « l’harmonie », de « la synthèse » ou de « l’unité » qu’ont tant privilégiée des générations de « marxistes »…
Ce qui pourrait être proposé est finalement assez banal : stopper l’assèchement de l’écologie politique, contribuer à renouer avec l’art perdu de la conversation entre les hommes, et entre les hommes et le reste du vivant, retrouver la langue des chênes et des genêts, des castors et des abeilles, des idées et de la poésie, de la glaise et des étoiles...
(1) Comme y invitent, entre autres, le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval in «Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle» ou encore le professeur en sciences de l'information et médias, Nick Dyer-Witheford (Université de Western Ontario) qui revisite depuis 2007 le concept des biens communs sous l’angle des ressources limitées et illimitées.
(2) Or ce n’est pas si clair. Dès la fin des années 1970, Michel Foucault avait montré comment le néolibéralisme, c'est-à-dire la généralisation de la concurrence dans toutes les activités humaines (éducation, santé, comportements individuels), loin d'être le fonctionnement spontané des sociétés humaines, était un projet politique dont l'application nécessitait l'action puissante de l'État. Pour privatiser, pour déréguler, pour imposer la loi du profit, il faut un État fort, comme on le voit aux États-Unis ou en Chine…
(3) Comme nous le rappelle l'étymologie latine du mot: cum, «avec» et munus qui évoque l'idée de tâche collective et d'obligation mutuelle. Ou encore comme a essayé de le théoriser un Charles Fourier, fondateur de l’Ecole sociétaire et sa promesse de bonheur.
(4) Aristote définissait le bien commun comme ce qui est l'objet d'une délibération commune.
(5) Si le 1er secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis semble s’être emparé aujourd’hui à son tour du concept, il semblerait que ce soit Laurent Fabius le premier, dans un texte du 17 juin 2003 publié dans les colonnes de Libération dont le titre est “Pour une social-écologie“, qui emploie le terme et définit ce que doit être, de son point de vue, la « social-écologie ». Le député de Seine-Maritime reprendra cette idée de social-écologie dans un ouvrage qu’il publiera en 2004 : “une certaine idée de l’Europe“ (éditions Plon).
Le Jeudi 3 novembre 2005, on voit réapparaître dans les médias ce terme de “social-écologie”. L’ancien collaborateur de Laurent Fabius à Matignon (de 1984 à 1985), Jean-Paul Besset, dans un entretien à Politis, reprend le mot de Laurent Fabius dont il a été un temps le conseiller : “Je ne crois pas, en l’état actuel des choses, à l’émergence d’un mouvement politique ou à la transformation miraculeuse de tel ou tel parti, y compris les Verts, en porte-parole de l’analyse que je tiens. La solution naîtra de pratiques sociales qui, peu à peu (c’est la vision optimiste, pas forcément celle qui triomphera), recouvriront les anciennes pratiques sociales. De cette marée montante naîtra un mouvement politique naturel, ce que j’appelle une social-écologie, qui remplacera la social-démocratie.”
Dans un débat face à Jean-Paul Besset (Nouvel Obs en décembre 2009), Pierre Moscovici nous explique à son tour son nouveau credo écolo : “L’avenir, aujourd’hui, je suis d’accord, c’est la social-écologie. Mais pas le dépassement de la gauche et de la droite.” Le député du Doubs poursuivra cette idée lorsqu’il défendra ses orientations devant le Conseil national du PS : “Ce texte, c’est le choix de la social-écologie ».
En 2011, Eloi Laurent, économiste sénior et conseiller scientifique à l’OFCE utilise à son tour la notion de « social-écologie » in « Social-Ecologie, contre l’écolo-scepticisme et l’écolo-fatalisme » (Flammarion).
Et plus récemment, en 2015, Jean-Louis Bianco avec « Social-écologie, démocratie : en avant ! » : Contribution thématique au congrès du Parti Socialiste de Poitiers (Juin 2015) présenté par Guillaume Garot et Jean-Louis Bianco (proches de Ségolène Roya)l.
(6) Catégorie que les sciences sociales (sauf chez les anglo-saxons qui préfèrent invisibiliser cette catégorie sociale) appellent les « classes populaires ».
.
Les Jeux olympiques à Paris en 2024 ? Oui... à condition qu'ils soient écolos *
Par Guillaume Vuilletet
Février 2015
Le 13 avril, le Conseil de Paris a approuvé la candidature de la capitale pour l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de 2024. Ce vote a été acquis à une écrasante majorité au Conseil de Paris, mais les élus EELV ont voté contre, tout en reconnaissant "des avancées notables".
L'occasion d'une conversion écologique
Il est vrai que le CFSI (Comité Français du Sport International) a choisi de privilégier les infrastructures existantes plutôt que la création de nouvelles, et que les écologistes se reconnaissent dans plusieurs des buts affichés par le CFSI : proposer un grand projet fédérateur, stimuler la pratique sportive en France, améliorer la santé et le bien-être des Françaises et Français, soutenir l’engagement bénévole et associatif, accélérer l’amélioration de la place des personnes en situation de handicap en France.…
Le débat est maintenant présenté au Conseil Régional d'Ile-de-France, et le groupe écologiste devra s'exprimer à son tour.
Nous, conseillers-ères régionaux EELV d'Ile-de-France, nous choisissons aujourd'hui une approche nouvelle : sortir de l'idée un peu primaire qui porterait à penser que l'on ne pourrait pas "être écologiste et pour les Jeux olympiques et Paralympiques".
C'est un choix qui se défend sans aucun doute. Mais c'est aussi un choix qui se discute. On peut être écologiste et défendre la candidature de Paris pour les jeux de 2024, et nous voulons le démontrer. Aujourd'hui les JOP, dans leur perspective de 2024, sont une occasion inédite de contribuer à la conversion écologique de la société.
Des moments de fraternité entre les peuples
Il est vrai que les écologistes ont, à raison, eu de véritables réticences pour les grands raouts internationaux, leur empreinte carbone, leur hypocrisie souvent, et leur inutilité parfois. Mais il y a événement et événement.
Même si la comparaison est relative, tout le monde se réjouit de la tenue de la COP 21 à Paris, la conférence internationale sur le climat, et peu de participants s'y rendront à vélo. A bien y regarder, cette comparaison n'est pas si relative que ça…
L'occasion est d'abord inespérée de mener un combat de valeurs, surtout au vu des crises grandissantes que va connaître le monde d'ici à 2024.
Nous pouvons promouvoir des Jeux qui furent rêvés comme une célébration du sport et de ses vertus. Le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la compétition vécue comme un acte pacifique et rassembleur, l’égalité face à la règle, sont autant de valeurs humanistes qui ont été portées, doivent être portées et peuvent être plus portées par le sport : revenons-y !
Rappelons-nous que, même si ce n’est souvent qu’une parenthèse dans un monde brutal, et toujours un prétexte commercial, les Jeux olympiques et les compétitions sportives internationales sont aussi des moments de fraternité entre les peuples.
Les premiers Jeux "à énergie positive"
Enfin, on peut le regretter, le disséquer, le relativiser, mais il nous semble qu'il y a davantage de jeunes issus des quartiers populaires qui s’épanouissent professionnellement dans la haute compétition sportive qu’à l’ENA. Au regard de l’égalité républicaine, cela nous interroge un peu.
Nous avons par ailleurs à porter des exigences pour écologiser l’idéal olympique.
Il y a par exemple, la nécessité de faire en sorte que ces Jeux soient les premiers "à énergie positive", comme nous voulons le faire pour les territoires. Transports collectifs, bâtiments, respect de l’environnement, énergies renouvelables, économie circulaire dans les équipements et l’usage des matériels sont des défis majeurs que nous devons intégrer dans la candidature parisienne et francilienne.
Les Jeux de 2024 à Paris doivent donner l'exemple de ce que doit être le monde de demain, c'est-à-dire celui de la transition écologique.
L'essentiel de notre réflexion se porte là : en 2024, le monde sera vraiment "ailleurs", au pire sens du terme, du fait du réchauffement climatique. Des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, où qu'ils soient, n'auront pas d'autre choix que d'être des moments de mobilisation écologique et humaniste. Alors, raison de plus pour qu'ils soient en Ile-de-France !
Les Jeux seront créateurs d’emplois locaux
Enfin, et c'est aussi un enjeu utile, il y a là une excellente opportunité de valorisation de nos territoires par les Jeux et d’appropriation des Jeux par les territoires. C'est un vecteur conséquent de reconnaissance d'une identité métropolitaine à l’échelle de la région.
Nous sommes particulièrement sensibles à l’idée que les JOP puissent être créateurs d’emplois locaux et qualifiants dans notre région à l’heure où elle fait face à un taux de chômage important et nous sommes convaincus de l’impact positif concernant les enjeux d’aménagement des territoires, notamment au sein de ceux délaissés en la matière.
En outre, Paris ne candidate pas seulement à l’organisation des Jeux olympiques mais aussi Paralympiques, en intégrant une égalité de traitement des personnes en situation de handicap, afin notamment de faire évoluer le regard porté sur elles.
Au-delà, il y a la possibilité de faire de ces Jeux une immense fête populaire qui associe les Francilien(ne)s, tous les Francilien(ne)s dans leur réalisation et leur déroulement.
Des Jeux écologiques, mais aussi citoyens
Cela veut dire, par exemple, que les emplois doivent être accessibles aux jeunes des banlieues – et pas seulement comme "volontaires" corvéables à merci. Cela veut dire aussi que les jeunes, y compris ceux des cités, doivent pouvoir accéder aux stades et aux lieux de compétitions, et pas simplement par quelques centaines de billets distribués de façon quasi caritative.
Cela veut dire aussi que le monde sportif amateur, ces milliers d’associations qui font le vivre-ensemble dans notre région doivent être actrices de ces Jeux, et pas simplement pour fournir des bénévoles.
Nous croyons aux Jeux olympiques à Paris en 2024 parce que nous croyons que nous pouvons les faire différents, écologiques, citoyens.
Nous croyons en la volonté politique et nous sommes optimistes, préférant agir pour faire appliquer nos propositions que de nous abîmer dans la contestation.
Alors, parce que l’enjeu concerne toute la planète et toute l'Europe, parce que ces Jeux peuvent être un moment de joie, et d’élan pour nos territoires, nous devons soutenir la candidature de Paris et de l'Ile-de-France pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques et porter un message d'espoir et de fraternité. Mais aussi d'écologie.
[1] Cet appel-Tribune a été signé par les conseillers régionaux d’IDF suivants : Laurence Bonzani, Jean Marc Brulé, Eric Chevaillier Françoise Diehlmann, Stéphane Gatignon Maire de Sevran, Ziad Goudjil, Serge Guérin, Laure Lechatellier vice Présidente du Conseil Régional d'Ile de France, Janine Maurice Bellay, Ali Meziane maire adjoint de Clichy sous Bois, Julie Nouvion, Liliane Pays, Jean Vincent Placé président du groupe Ecologiste au Sénat, Guillaume Vuilletet conseiller régional EELV d'Ile de France.
*Publié par l’Obs le 5 mars 2015, édité par Barbara Krief, auteur parrainé par Renaud Dély
ACTUALITE DE LA LAICITE
Contribution présentée par Dominique Lévèque
Février 2015
La question de la laïcité est souvent caricaturée, soit qu’elle apparaisse comme la marque d’un universalisme républicain post-colonial ou le faux nez de « l’islamophobie », soit que l’on soupçonne ceux qui voudraient la définir comme voulant faire le lit du communautarisme.
Nous le disions déjà en 2013. Le résultat est un silence souvent gêné, ou une parole empruntée sur les questions de société ou d’actualité qui s’y rattachent.
Nous appartenons tous à des « communautés » d’origine diverses, de fait, parfois au moins autant qu’à une catégorie sociale. Sans que nous nous définissions comme tels, ni même que nous y songions !
Ces communautés peuvent être culturelles, ludiques, professionnelles, géographiques, sexuelles, religieuses, philosophiques, etc.
Ces appartenances sont même constitutives de nos identités individuelles. Le débat républicain n’a jamais reposé sur un dialogue normé entre citoyens identiques. Il repose sur la confrontation des idées entre citoyens qui précisément dans leurs singularités individuelles veulent vivre ensemble et bâtir un avenir commun. L’esprit de la laïcité tel que les pères de la République l’ont conçue depuis la Révolution française en passant par la Troisième République n’a d’autre objet que de pacifier les relations entre individus en rendant viable la valeur cardinale de notre démocratie qu’est la Liberté. Mais la liberté de conscience et la liberté de penser ne sont possibles que dans le cadre d’une société égalitaire. Et ce fragile équilibre entre les principes de Liberté et d’Egalité qui fondent notre démocratie républicaine, seul le respect de la laïcité le rend possible.
Le débat est plus que jamais posé. Encore plus depuis les effroyables attentats de janvier à Paris ou l’inconcevable s’est produit : les françaises et les français ont réalisé que l’on peut mourir ici pour avoir fait simplement son métier, pour avoir fait preuve de critique, d’irrespect, de dérision s’agissant du sacré religieux.
Ils pensaient naïvement que si respect il devait y avoir, il était dû (selon la loi) aux personnes, aux croyants, pas aux croyances, pas aux religions, qui sont à soumettre, comme les idées, à la critique de la raison et de la science, du rire et de l’humour.
Demain, devra- t-on mourir aussi pour avoir attenté aux autres formes du sacré ?
Si l’on veut bien réaliser que nous avons le bonheur en France de bénéficier de la liberté d’expression - pas totale, ni illimitée, mais encadrée par la loi dans les limites notamment de la diffamation, de l’injure, de l’incitation à la haine raciale et de l’apologie du terrorisme - alors qu’il reste tant de pays dans le monde ou la parole est réprimée durement, ou un seul mot peut vous valoir une sentence mort, si l’on veut bien réaliser que cette liberté d’expression est indissociable de la liberté de pensée, qu’elle n’est en rien une fantaisie récente puisque ce droit est si fort qu’il est inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qui en a fait « l’un des droits les plus précieux de l’homme » (conforté depuis par la Charte européenne des droits de l‘homme), si l’on veut bien se souvenir qu’en France, la satire n’est pas interdite, qu’elle est même au cœur de la liberté d’expression et des libertés tout court, au point que le délit de blasphème n’existe plus dans notre société depuis la révolution de 1830, si l’on veut bien admettre que la liberté de bouffer de l’Iman, du curé et du rabbin est consubstantiel en France à la liberté de croire, si l’on veut bien prendre conscience que l’irrévérence de Charlie Hebdo ne se traduisait que dans la drôlerie et l’humour, la satire et le rire, et enfin, si l’on veut bien savoir, accessoirement, que le Coran n’interdit nullement de représenter le prophète (il suffit de voir d’ailleurs la multitude de représentations de Mahomet dans le monde chiite), que cela en définitive n’est qu’une construction sociale et politique, on mesure mieux le caractère monstrueusement imbécile de l’attentat commis, dont la connerie et la dégueulasserie le disputent à leur inculture et leur héroïsme fantasmé, qui ont cru bon de saigner le cœur des porteurs de rire qu’étaient les journalistes dessinateurs assassinés de Charlie Hebdo.
Les dessins de Mahomet, comme ceux des autres autorités religieuses et des clergés, jusqu’au Daïla Lama et ses moines bouddhistes ou la secte apocalyptique des Témoins de Jéhovah, étaient en effet monnaie courante dans le journal satirique depuis des années.
Depuis vingt-deux ans, rares sont les numéros où il n’y ait pas eu de caricatures du pape, de Jésus, de curés, de rabbins, d’imams, de Mahomet, etc. C’est même l’ADN de ce journal ! Lequel ne s’est jamais privé pas de railler en effet la bêtise et le fanatisme, comme de moquer les puissants, quand ils étaient dans le ridicule, l’égarement ou l’erreur, et de tenter de faire surgir, au milieu des tumultes du monde, le salut par le salace et la sagacité.
L’important est ce que nous allons faire maintenant, le temps de la sidération passée, le temps de la compassion respectée, le temps de l’émotion écoulée, pour s’en sortir ensemble et être à la hauteur de la situation et des espérances des marcheuses et marcheurs.
Exorciser dans la rue notre effroi, c’est légitime, parler d’Union nationale, c’est une chose, y voir clair, passer aux actes, Citoyens !, ré-enchanter au passage nos rêves, surtout ceux des plus jeunes, ça ne serait pas plus mal…
La leçon immédiate à tirer de ces tueries, c’est la claire conscience que la liberté de la presse, encadrée notamment par la loi de 1881, à plus forte raison quand elle est caricaturiste, parce qu’elle est garante de la bonne santé démocratique d’une nation, doit être protégée, et qu’elle ne peut pas souffrir de tergiversations.
Expliquer par voie de conséquence pourquoi il ne peut y avoir de « Oui, mais… » à ce qui s’est passé, sauf à le justifier d’une certaine façon ; dire et redire, le cas échéant, que la notion de blasphème a été révoquée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789, officiellement décriminalisée en 1791 à la faveur du premier Code pénal français, et consacrée depuis lors en France comme un droit républicain et démocratique aussi élémentaire qu’indiscutable qu’il faut protéger.
Ou alors, que veux-t-on ? Que la presse se voit (re) mise en cause au nom de la bienséance et du respect des croyants, comme au 18° siècle ?
Que Charlie Hebdo devienne Okapi ou Pim Pam Poum ?!
Que l’on remette sur l’établi le travail de la monarchie restaurée en 1815 en rétablissant le délit de blasphème ?
Le dernier supplicié en France pour blasphème fut le jeune chevalier de La Barre en 1766 !
Que veux-t-on ? Que l’on envoie en prison les patrons de journaux satiriques comme au temps des premiers ancêtres de Charlie Hebdo, La Caricature, en 1830, ou Le Charivari qui se payait régulièrement la tête du Roi de France, quand le roi se vit affublé d’une tête en forme de poire ?!
Par gourmandise, l’on pourrait aussi dans la foulée rétablir la loi sur le sacrilège de 1825, qui prévoyait la condamnation à mort de tout profanateur, notamment lorsque la profanation touchait des hosties consacrées ? Et tant qu’à faire, rechristianiser la France et confier nos universités à l’Eglise ? On pourrait cette fois-ci faire dans le dur et réellement l’appliquer (alors qu’à l’époque elle ne le fut pas vraiment et qu’elle devait disparaître avec la Révolution de 1830) ?
Ce qui est en jeu ici, c’est avant tout la laïcité, acquise chèrement et durement en 1905, notre pays, instruit des ravages des guerres de religions entre catholiques et protestants, tournant résolument le dos aux tentations hégémoniques théocratiques, et voulant résolument en finir avec la prétention de la religion (à l’époque, le catholicisme) et de ses représentants sur terre d’exercer leur magistère également sur le gouvernement des hommes, en lieu et place des hommes eux-mêmes.
Là aussi, il ne peut y avoir de « Oui, mais… », comme en guise de réserve.
C’est un énorme défi pour notre pays.
Il doit, et les français et les françaises avec lui, reprendre confiance en lui-même, dans ses valeurs, et mesurer quel bien précieux constitue leur république et son caractère laïc, qui conditionne le tout.
Ce n’est pas qu’il doit, mais il n’a pas le choix, sinon, c’est le risque du délitement généralisé.
Ce qui est en jeu ici aussi, plus globalement, et singulièrement dans une partie du monde musulman, c’est aussi, comme en Europe à partir du XVIe siècle, avec l'émergence des États nationaux, l’intérêt que les gouvernants ont vu dans l'instrumentalisation des délits d'ordre religieux à des fins personnelles ou politiques... La religion a parfois bon dos !
En conséquence, il nous revient de ne pas se laisser abuser et de refuser que les limites à la liberté d’expression soient posées autrement que par la loi républicaine, la loi religieuse n’ayant pas sa place en France.
Il faut s’y faire, en France, on a le droit de moquer les religions, comme les idées ou les idéologies, comme leurs prédicateurs, leurs gourous ou autres maîtres à penser.
Car ne nous trompons pas, il n’aura pas fallu attendre longtemps, une fois le moment de compassion envers les victimes et celui de cette émotion collective retombées pour que les religieux de tous poils de toutes religions, ne viennent à l’unisson à leur tour nous seriner un « oui, mais… ». On ne sait que trop ce que les institutions religieuses sont capables de faire, y compris de s’entendre entre elles pour défendre leurs parts de marché (relativisant ainsi grandement ce que d’aucuns appellent la « guerre des religions » !), dès lors que la question de leur emprise sur les hommes est posée. Il suffit de voir ces dernières années avec quelle promptitude, ils ont été capables de faire front, ensemble, sur nombre de questions de société sur lesquelles ils ont la prétention de peser, pour s’en convaincre.
Mais force est pourtant de constater que bien peu de dirigeants, mais aussi de militants politiques, ont défendu la laïcité toutes ces dernières années. Pas davantage à gauche qu’à droite d’ailleurs. Seules quelques associations…
On est champions pour se pâmer de beaucoup de mots, on ne cesse de faire référence à la philosophie des Lumières, mais dans la pratique politique, comme dans son application dans la vie quotidienne, il y a loin de la coupe aux lèvres.
Bien peu nombreux étions-nous à faire valoir toute sa modernité, à dénoncer son affadissement, la paresse ou la mollesse de nos dirigeants sur cette question essentielle.
Le peu que nous étions, étions considérés au mieux comme des radicaux-socialistes, autant dire des Has been, à enfermer dans un jardin zoologique, au pire comme des archaïques empêcheurs d’évoluer de la société, ou l’inverse (sic !)
Il est plus que temps de faire notre examen de conscience.
Hier encore, on donnait la laïcité vieillotte, problématique (à droite notamment), quand elle n’était pas dépassée, comme faisant partie des Beaux-Arts (à gauche), voire comme la cause de l’islamophobie, alors même que ces attentats perpétrés contre Charlie Hebdo, contre des policiers et contre des juifs, uniquement parce qu’ils étaient des dessinateurs satiriques, des policiers, des juifs, montrent l’urgence qu’il y a, non pas à la faire évoluer, mais à la faire vivre, tout simplement.
Charlie Hebdo, lui-même, était bien seul, qui fut le refuge de nombre de dessinateurs de pays musulmans, à la défendre avec ses crayons depuis 2006. Comme il fut bien seul à pointer l’intolérance islamiste…
Faut-il rappeler que la laïcité n'est pas une option spirituelle parmi d'autres ?
Faut-il rappeler qu’elle est précisément ce qui rend possible leur coexistence ?
Faut-il rappeler que ce qui est commun en droit à tous les hommes doit avoir le pas sur ce qui les sépare en fait ?
Faut-il rappeler, et manifestement il faut le faire, et sans doute l’enseigner à l’école, que la laïcité, au moins en France, place la liberté de conscience au-dessus de la liberté religieuse (cette dernière étant plus restrictive puisqu'elle sous-entend que l'on a une religion) ?
Faut-il rappeler aux ignorants ou à ceux qui l’auraient oublié que la laïcité, c’est ni plus ni moins qu’un ordre de valeurs librement choisies par le peuple et ses représentants et (qui devraient être) clairement assumées, non moins contraignantes que celles des religieux et opposables à certains d'entre eux le cas échéant ?
Faut-il rappeler, avec le philosophe Henri Peña-Ruiz (1), la ligne directrice de la République française qui fait qu’elle est sur cette question autrement plus magnanime que bien d’autres pays dans le monde. Il est grand temps que l’État français réaffirme le principe de laïcité, le fasse vivre et fasse preuve de cohérence.
Sans doute incidemment serons-nous amenés à questionner et à réévaluer nos relations diplomatiques. Peut-on par exemple à la fois prétendre défendre la laïcité, tout en consolidant ses liens avec des dictatures théocratiques qui soutiennent ouvertement le salafisme djihadiste ?
Les évènements tragiques de janvier dernier nous interrogent aussi sur nos failles, celles de notre système éducatif, celles de notre politique d’emploi des jeunes, celle de notre politique d’égalité des territoires et dans nos quartiers, etc.
Au plan de l’éducation, on voit bien que c’est quelque chose qu’il faut enseigner.
Aux jeunes, comme aux nouveaux arrivants dans notre pays.
La vérité, c’est que nous avons été trop souvent dans le déni des réalités, comme des solutions qu’il aurait fallu adopter. De ce point de vue, il est temps de mettre en œuvre, pleinement et complètement, le rapport de Régis Debray « L'enseignement du fait religieux dans l'Ecole laïque » (2) remis en février 2002, à la demande du ministre de l'Education nationale. Tant il n’y a rien de plus tragique que la religion sans culture.
Or, qu’en est-il de son application ?
Il était noté les raisons urgentes à la mise en place de cet enseignement du fait religieux, de l’histoire des religions, qui restent les mêmes aujourd’hui, entre autres :
- "Une déshérence collective, une rupture des chaînons de la mémoire nationale et européenne".
- "L'angoisse d'un démembrement communautaire des solidarités civiques"
- "Tempérer l'éclatement des repères comme la diversité, sans précédent pour nous, des appartenances religieuses".
- "L'effondrement ou l'érosion des anciens vecteurs de transmission que constituaient églises, familles, coutumes et civilités, reporte sur le service public de l'enseignement les tâches élémentaires d'orientation dans l'espace-temps que la société civile n'est plus en mesure d'assurer."
- Et cette illustration devenue célèbre, non moins d’actualité aujourd’hui : "Comment comprendre le 11 septembre 2001 sans remonter au wahhabisme, aux diverses filiations coraniques, et aux avatars du monothéisme ?"
Que n’avons-nous pas généralisé toutes ces recommandations ?
Ce n’est pas un hasard si la laïcité est un point de fixation dans tel ou tel pays arabe, constitue un sujet d’incompréhension majeure de la part de bien des pays confessionnels (à commencer par les Etats-Unis qui n’ont pas toujours été exempts d’un impérialisme à fondement religieux) au point que d’aucuns voudraient en profiter pour faire passer la France comme antimusulmane.
C’est vrai qu’il y a un précédent, un immense malentendu avec le monde arabo-musulman : « l’affaire » du voile l’a révélé, alors même que le voile n'est pas à proprement interdit en France.
Ce malentendu a d’ailleurs été grandement nourri par la malveillance des groupes sectaires islamistes, passés experts dans l’art de la manipulation, alors qu’il n’a jamais été question dans cette affaire que de l'école, en tous cas pas de la religion. A ce que nous sachions, le voile n'est interdit ni dans la rue ni dans les supermarchés. Il s'est agi seulement de préserver l’école des fureurs du monde et des passions humaines et, partant, de préserver la liberté des élèves et l’autonomie du processus éducatif. Notre position relevait juste d'une tradition républicaine.
Contrairement à ce que d’aucuns ont voulu comprendre, y compris dans certains rangs de la gauche, cette position ne fut en rien une restriction de la liberté religieuse, et l’on peut même ajouter que jamais la France n'a été si attentive au fait musulman que depuis ce malentendu.
Que disait encore le rapport de Régis Debray ? Il pariait sur le fait « d’informer des faits pour en élaborer les significations ». Il ne préconisait pas la création d'une nouvelle matière dans un contexte de surcharge d'activité et de programmes déjà à l’époque passablement encombrés.
"C'est donc sur les contenus d'enseignement, par une convergence plus raisonnée entre les disciplines existantes, et surtout sur la préparation des enseignants qu'il convient de faire porter l'ambition."
Tout était dit et la boîte à outils donnée en prime !
On se demande bien pourquoi tout cela n’a pas été mis en place, ou alors de manière très parcellaire, discontinue et très inégale au plan géographique.
S’il est nécessaire plus que jamais de ne rien céder sur la laïcité, de faire l’effort d’explication aux jeunes générations, comme auprès des parents, de mettre en œuvre réellement l’enseignement de la laïcité et de l’histoire des religions, il convient aussi de regagner sur le plan idéologique en faisant notre examen de conscience.
Arrêter là-aussi de persister dans le déni.
Acceptons aujourd’hui de reconnaître notre responsabilité collective en la matière, comme de mesurer plus particulièrement les dégâts que des irresponsables, à droite, toujours à la recherche d’une fenêtre de revanche sur la République, et des naïfs, les « idiots utiles » de l'islamisme, sévissant plutôt à gauche, ont causé à la laïcité et donc à notre vivre ensemble. Il convient de faire preuve d’une volonté sans faille, d’un esprit combatif si l’on veut réellement la restauration des valeurs républicaines. Sachant que c’est d’abord un combat intellectuel qui porte sur la représentation que nous nous faisons de la société elle-même.
Abandonnée jusque-là par une partie de la gauche (singulièrement au PS), polluée, corrompue à droite par le discours de Nicolas Sarkozy au Palais du Latran à Rome en 2007 qui faisait des religions un « atout » pour la République, et instrumentalisée, cannibalisée par un Front national qui prospère depuis plus de vingt ans sur le racisme et la xénophobie, la laïcité est un combat permanent.
La gauche a sans doute trop abandonné à l’extrême-droite, non pas par peur ou calcul politique, mais essentiellement par paresse et manque de vigilance : l’idée, égalitaire et libératrice, de nation souveraine ; le drapeau tricolore, emblème de la Révolution française ; la figure de Jeanne d’Arc, la fille du peuple chère à Michelet. Sans compter aussi le monopole de certaines réalités qui dérangent.
Il est encore temps de revenir si ce n’est sur le reniement, l’abandon de notre idéal républicain universaliste, du moins sur son absence d’application pratique au quotidien.
Il est encore temps de questionner le dévoiement que nous avons laissé faire de la démocratie, comme si elle devait se refonder sur une vision libérale de la société, addition interminable de particularismes frendly en tous genres, comme si elle ne pouvait plus s’enraciner dans l’héritage politique de la Révolution Française ?
Avons-nous oublié à ce point que la laïcisation de notre société s’inscrit dans le sillon révolutionnaire tracé à la fin du Dix-huitième siècle ? Avons-nous à ce point la mémoire courte ? L’historien Claude Nicolet, spécialiste de la Rome antique, des institutions et des idées politiques (membre du cabinet de Pierre Mendès France, il fut secrétaire des années après, puis rédacteur en chef, des Cahiers de la République), écrivait que « la laïcité républicaine est à la fois une institution collective (c’est-à-dire une organisation de l’Etat telle qu’il s’interdise toute action autoritaire et déloyale sur les consciences, et qu’il veille soigneusement à ce que nul parti, nulle secte, nulle opinion même ne puissent en exercer), et une ascèse individuelle, une conquête de soi sur soi-même. C’est à ce prix qu’on est républicain. C’est à ce prix – qui n’est certes pas mince – que la République peut enfin mériter d’être cette unité dans la diversité, cette aspiration à l’universel au-delà d’un modeste hexagone, ce rêve français dont nous avons la charge ».
L’urgence est donc bien aujourd’hui de militer, non pas pour une laïcité dure, très stricte, molle, perméable aux expressions religieuses, fermée ou ouverte, ou même « positive », mais pour le respect de «LA» laïcité.
Ce devrait être une des tâches prioritaires de l’Etat à qui il revient d’agir, des partis politiques à qui il revient de faire des propositions, du Parlement à qui il revient de légiférer s’il y a lieu, en n’oubliant pas de faire valoir absolument que la liberté en France n’est pas négociable, et la laïcité, un principe intangible de la République qu’on ne discute pas, qui n’a pas besoin d’être aménagée ou réaménagée, pas davantage d’être redéfinie. La laïcité se décrète, point à la ligne.
Cela n’a rien de paradoxal tout simplement parce que c'est une affirmation d'Etat.
Aucune société n'est laïque spontanément !
Nous sommes tous portés par des intolérances, des indispositions, des allergies, des irritations. Nous voulons tous nos privilèges, nos groupes de paroles, de convictions...
L'Etat, autrement dit l'intérêt général, est là précisément pour essayer de pacifier, de coordonner ces tiraillements. Alors oui, il faut un Etat pour qu'il y ait une laïcité, et oui, il faut des lois pour l’organiser qui doivent être respectées.
L’urgence, dans ce contexte d’agression contre la France par la loi islamiste, par cet acte irréversible perpétré par des barbares made in France, qui n’ont fait que singer ce qui se fait malheureusement ailleurs, c’est maintenant de nous réarmer philosophiquement, idéologiquement, et de nous armer politiquement en prévention.
S’il est urgent de réagir, il convient d’abord de nommer les choses par leur nom, car ça n’est ni plus ni moins que l’obscurantisme qui pourrait être de retour, et depuis bien plus longtemps que les attentats de Paris de janvier dernier pourraient nous laisser l’imaginer : la réalité, c’est que nous sommes dans une période de relative régression, et la philosophie des Lumières que nombres d’intellectuels mettent si souvent en avant, est de plus en plus battue en brèche.
Ce que nous avons eu la faiblesse de considérer comme acquis, est remis en cause tous les jours. De sorte qu’il n’est plus impensable qu’on puisse revenir un jour sur la peine de mort.
Certains pourraient avancer une telle proposition (souvenons-nous du dernier précédent, lorsque l'Assemblée nationale examinait en 2007 un projet de loi visant à inscrire l'abolition de la peine capitale dans la Constitution, et qu’il s’est trouvé dix-huit élus UMP pour signer deux propositions d’amendement visant à la maintenir dans certains cas). Idem sur notre politique de justice, le traitement de la délinquance chez les jeunes, etc.).
Comme sur la laïcité.
C’est vrai que la situation économique, celle du travail et de l’emploi, n’aident pas à penser l’avenir de façon sereine : quand on a peur, on est en état de rétractation. La délinquance, le refuge ou l’affirmation de soi dans des actions extrémistes se nourrissent de l’absence de travail et des difficultés sociales.
Mais il ne faut pas pour autant penser que la crise économique explique tout.
Au nom du refus de l'islamophobie, qu’on a voulu associer exclusivement à une forme de racisme, on n'a cessé de minimiser les faits. On nous expliquait qu'il ne s'agissait que de jeunes en déshérence, de jeunes « paumés », d'une minorité en butte à des difficultés sociales. On nous expliquait que le problème n'était pas religieux, mais social. Social, comme un « circulez, y a rien à voir ! », comme s’il n’y avait rien d’autre à analyser.
Il ne s’agit évidemment pas ici de reprendre l’antienne du FN, car en effet, l'amalgame « musulman = terroriste » serait des plus catastrophiques.
Faut-il pour autant minimiser ce qui s'est passé ?
Qui n’a vu le désarroi de nombreux professeurs, pas ou insuffisamment formés face aux horreurs qu'ils ont entendues après les attentats ? On découvre, ou on fait semblant de découvrir, la confusion mentale, après la question de la concurrence mémorielle, avec la mise en concurrence des victimes du racisme (la mosquée contre la synagogue, quand ce n’est pas contre l’église), la bêtise, l'intolérance, parfois même la haine, une haine qui s’enkiste, devenant d’autant plus dangereuse qu’elle devient presque ordinaire. Et souvent des murs d'incompréhension qui se dressent comme pour empêcher la pédagogie de l’échange et du débat.
Ce n'est pas vraiment nouveau : les discours ont commencé à déraper il y a une dizaine d'années, mais ceux qui, déjà, tiraient sur la sonnette d'alarme n'ont pas été entendus.
Certes, qui plus est, avec la fast culture sur l’Internet, qui peut être aussi bien le plus formidable accès pour tous à des trésors de culture, qu’à une contre-culture, mais aussi à une pseudo-culture où la majorité des adolescents vont faire leurs courses en matière de « savoirs », alors qu'avant ils le tenaient d’abord de l'école, des parents et des familles, la chose se complique singulièrement. Songeons seulement que selon la ministre de l’Education, un jeune sur cinq adhérerait aux théories du complot !
Il ne faut pas nier que, dans les quartiers dits "sensibles", les salafistes religieux, ont remplacé les "grands frères", prenant toute la place dans un tissu associatif devenu bien maigre depuis que l’on a coupé les vivres des associations d’éducation populaires (qui y avaient fait un remarquable travail depuis l’après-guerre) en supprimant, à partir du début des années 90, les mises à disposition sans les remplacer par un autre système. Ce nouveau prosélytisme exerce une pression de plus en plus forte sur la population des français musulmans, oblige les femmes à se voiler, les conduit à rejeter des éléments fondamentaux de notre république et de notre contrat social (laïcité, liberté d'expression, égalité femmes/hommes), quand il ne passe pas contrat avec les trafiquants de drogue pour régner dans les quartiers.
Cette évolution s'est faite avec des municipalités que se sont voilées les yeux, pas moins que le pouvoir central, ce qui a globalement conduit à maintenir cette ghettoïsation que tout le monde se plait à dénoncer à longueur de discours.
Pour construire du lien social, commençons une fois de plus par revenir sur ce déni, non pour s’auto-flageller, mais pour y voir clair en affrontant la réalité en face : l'islamisme s’instille et infuse dans les quartiers.
De ce point de vue, force est de constater que la diffusion du modèle anglo-saxon du multiculturalisme, est assez néfaste. Sa popularisation en France, partant sans doute de bons sentiments de la part de la majorité de ses promoteurs initiaux, nous promet un désastre plus grand encore que celui que nous avons sous les yeux si nous n’y prenons garde. Pour tenir compte de la réalité en effet multiculturelle de notre société, fallait-il aller jusqu’à élaborer une nouvelle idéologie avec slogans et sommations ?
Qui ne voit qu’avec le multiculturalisme normatif, on n’a réussi qu’à grignoter peu à peu la raison universelle, qui veut qu’on pense d’abord à ce qui nous unit, avant ce qui nous distingue ou nous différencie ?
Aujourd’hui, le droit à la différence est considéré comme le summum de la liberté.
La philosophie anglo-saxonne du « différentialisme » domine : chacun, dans « sa » communauté, fait ce qu’il veut. Ce repli identitaire a un autre volet : nationaliste, régionaliste, le thème de « ma région », « mon pays d’abord », s’insinue en France comme un poison, comme dans le reste de l’Europe et est affligeant de désespérance.
Comment ne pas voir que cela contrarie sévèrement, pourrait même en signer la mort, la philosophie des Lumières, qui a résonné en termes tout à fait opposés ?
Elle proclame en effet que pour avancer, il faut considérer les essentielles ressemblances entre tous les êtres humains, quelles que soient nos différences.
Ainsi, en votant par exemple le mariage pour tous, la France a considéré les homosexuels comme identiques à leurs semblables, appartenant au même genre humain avec les mêmes droits, y compris celui de subir comme les hétéros les illusions, les galères du mariage et du divorce !
On a appliqué la philosophie de la ressemblance.
Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, par peur ou par culpabilisation du passé colonial de la France, ou craindre de devoir admettre que l’on s’est trompé par le passé : nul besoin d’aller jusqu’aux Etats-Unis, il suffit d’aller voir dans les banlieues de Londres pour constater que le multiculturalisme, c’est le séparatisme, et pas la solidarité, car chacun s’aligne sur sa communauté, s’y réfugie ou s’y enferme, et l’universalisme se meurt.
Il n’y a pas lieu d’être définitivement pessimiste, si l’on croit en l’optimisme de la volonté d’hommes et de femmes éclairées, si l’on croit en cette espérance qui a jailli lors de la marche du 11 janvier dernier. Il reste qu’il est pour le moins anachronique d’en appeler à la laïcité, comme le font nos dirigeants politiques, et de solliciter en même temps l’appartenance communautaire ou supposée comme telle de nos concitoyens pour raisonner notre monde (sic !)
Un minimum de lucidité amène à penser que ce n’est pas gagné : il suffit de voir la confusion et les dégâts que l’après Charlie commence à causer à gauche et singulièrement dans ce que l’on appelle la « gauche radicale » particulièrement déphasée.
Disons le tout net, il pourrait y avoir péril en la demeure : cette philosophie multiculturaliste séduit énormément les jeunes, qui trouvent qu’on appartient d’abord à « sa » communauté (même si la réalité de cette communauté peut être dans certains cas sujette à caution, comme précisément pour les musulmans qui n’ont jamais eu l’ambition en France de s’organiser au travers un maillage d’école religieuses, d’institutions représentatives, de parti politique ou de lobby, et pour lesquelles l’usage de communauté musulmane est impropre), avant d’appartenir à une collectivité plus large, comme la collectivité nationale, européenne, terrienne. C’est la suprématie du chacun chez soi.
Comment ne pas avoir peur de telles régressions ?
Cet enfermement, cette fierté incongrue de la différence sont terribles. Au contraire de la philosophie qui met en exergue ce qui nous unit, et qui est, elle, un puissant facteur de paix entre les hommes.
Il faut donc convaincre et tenir à certains principes.
C’est au nom de ces principes qu’il fallait refuser la généralisation de la Burqa que l’on a essayé de nous faire prendre pour un commandement religieux, alors même que son port ne relève que de la tradition wahhabite et pachtoune. Ainsi cachées, dissimulées au regard de leurs semblables, comment ne pas comprendre la défiance et la peur ainsi suscitées à l’époque ?
On ne pouvait pas laisser entretenir l’idée que le regard de l’autre serait méprisable et impur au point de lui refuser tout regard, tout contact, tout échange, tout sourire.
Notre démocratie moderne, où l'on tente de renforcer la fraternité et d'instaurer transparence et égalité des sexes, et où l’on encourage une citoyenneté active, ne pouvait supporter plus longtemps cette situation qui allait jusqu’à mettre en danger les personnes, dans les services de santé par exemple. Il fallait bien en tirer les leçons.
Il faut donc tout à la fois développer l’esprit de tolérance et la fermeté face à l’intolérance, notamment religieuse, comme face aux actions terroristes.
Notre pessimisme ou notre optimisme, notre intelligence en tous les cas, doit se fonder aussi sur le constat, sinon du retour en force du religieux - mais aussi paradoxalement de la crise de certaines religions - que de sa prétention rétrograde de régner sur le temporel comme sur le spirituel, de régir les hommes comme aux temps anciens.
Sur l’évidence aussi que les religions, puisque c’est elles qui nous séparent en définitive, ne sont pas des facteurs de paix dans une certaine partie de la population.
Enfin, et cela a à voir, refusons les confusions de sens : devrons-nous subir longtemps encore cette diarrhée verbale qui a suivi les tueries de janvier dernier avec ces appels très hétéroclites à refuser les amalgames ? Car enfin de quel amalgame parlons-nous ?
De celui qui a fait s’identifier à Charlie Hebdo et aux victimes près de 4 millions de personnes qui ont marché ensemble pour dire leur compassion et leur colère, leur exigence de vérité et d’action ?
Bien sûr qu’il faut éviter les "amalgames" et ne pas associer tous les musulmans ou ceux qui sont réputés l’être ou encore sont désignés comme tels, à des terroristes !
Il faut surtout être clair dans son expression et l’usage des mots.
Un exemple au hasard qui ferait presque douter de notre intelligence : islamophobie.
Un mot qui infuse dans le langage courant, et l’on peut s’étonner qu’il soit repris sans plus de précaution par des intellectuels, des journalistes, des politiques et même des enseignants.
Il n’y a tout de même pas besoin d’avoir fait Latin-Grec au lycée pour savoir que Phobos en grec veut dire « crainte » et pas « haine » (Misos). Confond-t-on la gamophobie et la misogamie ?
Mais peut-être faut-il rappeler que dans le vocable liberté d’expression, il y a le mot « expression » et qu’il n’est pas interdit d’éviter les attentats contre la langue française !
Comme le relève très justement, assez seul, il faut le dire, l’écrivain Olivier Rolin dans le journal Le Monde (3), « si ce mot a un sens, ce n’est donc pas celui de la haine des musulmans, qui serait déplorable en effet, mais celui de la crainte de l’Islam. Alors ce serait une grande faute d’avoir peur de l’Islam ? J’aimerais qu’on m’explique pourquoi. Au nom de nos valeurs justement. J’entends, je lis partout que les Kouachi, les Coulibaly, « n’ont rien à voir avec l’islam ». Et Boko Haram, qui répand une ignoble terreur dans le nord du Nigeria, non plus ? Ni les égorgeurs du « califat » de Mossoul, ni leurs sinistres rivaux d’Al-Qaida, ni les talibans qui tirent sur les petites filles pour leur interdire l’école ? Ni les juges mauritaniens qui viennent de condamner à mort pour blasphème et apostasie un homme coupable d’avoir critiqué une décision de Mahomet ? Ni les assassins par lapidation d’un couple d’amoureux, crime qui a décidé Abderrahmane Sissako à faire son beau film, Timbuktu ? J’aimerais qu’on me dise où, dans quel pays, l’islam établi respecte les libertés d’opinion, d’expression, de croyance, où il admet qu’une femme est l’égale d’un homme. La charia n’a rien à voir avec l’islam ? ».
On pourrait évoquer ici bien d’autres exemples tous aussi inacceptables et tristes, comme celui de ce blogueur saoudien, Raïf Badaoui condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet en 2014 pour cyber criminalité et « insulte envers l’Islam » juste pour avoir mené une critique satirique des autorités religieuses locales, après s’être attiré les foudres de la monarchie saoudienne pour avoir entrepris d’ouvrir un débat sur l’interprétation de l’Islam et raillé la police religieuse.
Il me serait interdit de regarder la réalité en face et de craindre l’Islam et toutes les autres religions ? Mais dans quel monde voulons-nous vivre ?
Le philosophe Abdennour Bidar, élevé au soufisme et à la pensée occidentale, nous invite à identifier les racines du mal et pointe la difficulté que les intellectuels occidentaux eux-mêmes, ont à les voir, tant pour beaucoup, « ils ont oublié ce qu'est la puissance de la religion - en bien et en mal, sur la vie et sur la mort - qu'ils me disent « Non, le problème du monde musulman n'est pas l'islam, pas la religion, mais la politique, l'histoire, l'économie, etc. ». Ils vivent dans des sociétés si sécularisées qu'ils ne se souviennent plus du tout que la religion peut être le cœur du réacteur d'une civilisation humaine ! Et que l'avenir de l'humanité passera demain non pas seulement par la résolution de la crise financière et économique, mais de façon bien plus essentielle par la résolution de la crise spirituelle sans précédent que traverse notre humanité toute entière ! Saurons-nous tous nous rassembler, à l'échelle de la planète, pour affronter ce défi fondamental ? La nature spirituelle de l'homme a horreur du vide, et si elle ne trouve rien de nouveau pour le remplir elle le fera demain avec des religions toujours plus inadaptées au présent - et qui comme l'islam actuellement se mettront alors à produire des monstres. » (4)
L’on pourrait ajouter que, plus que le religieux, c’est l’usage politique de la religion qui est en cause, c’est le cléricalisme qui est en cause.
En France, contrevenant à la laïcité, la loi religieuse veut de plus en plus imposer et s’imposer sur l’espace public. Pour ne (re)parler que de l’épisode du mariage pour tous, on a vu combien les autorités religieuses toutes confondues étaient promptes à faire l’union sacrée pour stigmatiser les hommes et les femmes partisans dudit mariage pour tous ! Ici, nulle guerre de religion ! Et ne parlons pas du reste du monde, loin d’être pareillement laïque !
Et nous pouvons le relever autant pour les salafistes, les musulmans dits « radicaux » (encore que cet adjectif soit assez impropre) que pour la montée en puissance de l’orthodoxie chez les Juifs ou la prégnance arachnéique des églises évangéliques qui font main basse sur l’Amérique du sud et aujourd’hui sur l’Afrique ou l’Asie...
Comment ne pas être sidérés par exemple par cette tentative des Juifs extrémistes de Jérusalem en 2012 de séparer les sexes dans les bus et d’instaurer une police de la jupe ?
Pour le sujet du moment, nous ne pouvons évidemment pas nous contenter de dire que c’est un sujet interne à l’Islam, puisque l’on voit combien certains tentent par tous les moyens d’exporter leur soif de charia et de califat jusqu’en France et en Europe, d’autres d’exploiter le sentiment religieux. Il faut sans doute réfléchir à comment peuvent être aidés ces français musulmans, pratiquants ou pas, de bonne volonté, qui voudraient encourager leurs coreligionnaires à un Islam des Lumières, si tant est que cela soit possible, prenant en compte l’évolution du temps.
Mais il ne faut pas être naïf, il existe des groupes sectaires, politico-religieux, ou carrément mafieux sous couverture religieuse, qui au nom ou sous prétexte de religion, y feront obstacle, car ils mènent une guerre de tranchées visant à enfoncer nos propres principes.
L’espèce de soumission à la religion, de l’extrême gauche, et pour le moins d’une partie des gauches dites « radicales », d’une trop grande partie de la gauche (au PS y compris), en passant par une partie importante de la frange gauchiste d’Eelv est un désastre. Comme si le religieux devait l’emporter sur tout et que toutes et tous devaient se soumettre à ses diktats.
La France comme les autres démocraties occidentales ne doit plus craindre d’être horrifiée à l’idée d’être accusée d’intolérance.
Il est symptomatique de constater qu’au moindre mot qui n’est pas conforme à l’acceptation générale, on risque d’être taxé « d’islamophobe », « d’antisémite », de « raciste », de « lepéniste»...
Quel serait ce pays où la peur d’être stigmatisé ferme la bouche à beaucoup de gens ?
Le plus chagrinant, c’est que la gauche elle-même, a été saisie par cette terreur.
Or, il ne faut pas avoir peur, mais avoir le courage de tenir sur ses principes.
Il est peut-être temps d’en finir avec la moyennisation de la pensée qui ouvre le champ à toutes les lâchetés, à toutes les outrances, à toutes les horreurs. Il est peut-être temps de faire une pause et d’arrêter de penser et de communiquer en 140 signes !
Puisons dans l’histoire de quoi nous aider à comprendre comment la raison peut se réimposer.
La leçon à tirer du passé est qu’il y a toujours un moment de révolte. Dans l’histoire de la philosophie des Lumières, il y a un moment où l’oppression exercée par les lois religieuses est trop forte, alors qu’elle est appliquée à des gens qui évoluent intellectuellement et socialement. Et ces gens disent «ça suffit». Cela peut prendre des siècles évidemment.
Après le sursaut massif de dimanche, il y a peut être là comme le ferment de quelque chose de nouveau qui monte dans la société. Qui n’oublierait pas l’école où l’on devrait pouvoir apprendre à lire, à compter et à écrire, et apprendre a minima ce que qu’est l’esprit démocratique, comme à exercer sa raison critique, à essayer de mettre un peu à distance les préjugés et les croyances de la société, de sa famille, comme des siens propres.
Car c’est proprement incroyable de voir l’école, notre école laïque, s’adapter à ces croyances ! Comme le relève très justement Elisabeth Badinter, on est passé du «cogito» au «credo» et cela ne constitue pas vraiment un progrès. Comme si le mot d’ordre dans beaucoup d’écoles était devenu : «Surtout ne choquez pas les croyances et les préjugés de vos élèves.»
Or, si on ne peut plus apprendre les fondamentaux de l’esprit démocratique et former à l’esprit critique à l’école, où pourront le faire nos enfants ? Comment deviendront-ils plus tard des citoyens
Dans l’immédiat, il revient au Président, au gouvernement, au parlement de prendre toute mesure pour protéger nos concitoyens et les fondements de notre république.
Faire œuvre de pédagogie si nécessaire en rappelant les fondamentaux : en proclamant la liberté de conscience et l’égalité des droits entre tous les hommes, l’Assemblée constituante a jeté les bases non de la tolérance mais de la laïcité, que la loi de séparation des Églises et de l’État a consacrée en 1905.
En rappelant qu’il ne faut pas confondre tolérance et laïcité.
La tolérance est une concession du prince ou du roi à certains sujets, de l’État à des corporations, des communautés, pas la reconnaissance d’un droit naturel, plein et entier, égal pour tous les citoyens.
Jaurès, qui respectait la liberté de critique, ne s’y trompait pas : « Nous ne sommes pas, disait-il en 1910, le parti de la tolérance - c’est un mot que Mirabeau avait raison de dénoncer comme insuffisant, comme injurieux même pour les doctrines des autres. Nous n’avons pas de la tolérance, mais nous avons, à l’égard de toutes les doctrines, le respect mutuel de la personnalité humaine et de l’esprit qui s’y développe. » (5)
Sans doute faudra-t-il prendre des mesures en termes de moyens, en renseignements humains et d’analyse, comme en termes de moyens techniques. Mais il est clair que des lois d’exception ne répondraient pas à l’enjeu d’aujourd’hui, pas plus que l’autocensure ou le repli sur la psychose, qui ne feraient que nous faire tomber dans le piège tendu par les djihadistes, qui ne cherchent qu’à scinder la société française en escomptant sur le concours objectif de cette frange française toujours prompte à stigmatiser les musulmans. Pas davantage une inflation législative de stricte circonstance.
Le sujet n’est pas de rogner les libertés. Il nous faut surtout être cohérent.
Par exemple, comme le relève le politologue Olivier Roy, certains ont parfois trop tendance en France à reprocher aux musulmans leur communautarisation, et dans le même temps, à les sommer de réagir face aux groupes djihadistes et au terrorisme. C’est ce qu’il appelle « la double contrainte : soyez ce que je vous demande de ne pas être. Et la réponse à une contrainte ne peut être qu’inaudible ».
En tout état de cause, il nous revient à tous et toutes de faire baisser les tensions, d’éviter une escalade de la violence, de résister à l’esprit de guerre, et de soutenir ceux qui en ont la charge pour affronter les dangers. De trouver les voies pour protéger nos enfants d’un nihilisme qui se pare de vertus religieuses. De nous protéger de l'hystérie des orthodoxies religieuses qui ne désarme pas et reste à l'œuvre...
Ce qui devrait nous amener ici, en France, à chérir la complexité de ce que nous sommes, mais aussi notre richesse, notre triptyque républicain et notre principe de laïcité.
Comme de penser notre avenir en renforçant la cohésion nationale sans demander à qui que ce soit sa religion.
(1)« La laïcité n’a jamais été l’ennemie des religions, tant que celles-ci s’expriment comme démarches spirituelles et ne revendiquent aucune emprise sur l’espace public. La séparation juridique de la puissance publique d’avec toute Église et tout groupe de pression, qu’il soit religieux, idéologique ou commercial, est pour cela essentielle. L’école publique et l’ensemble des services publics doivent être protégés contre toute intrusion de tels groupes de pression ». (Henri Peña-Ruiz in Le Monde diplomatique, février 2004).
(2) Ce rapport exposait clairement les motifs en identifiant les précautions pour éviter les quiproquos (qui valent encore aujourd’hui !) et en stipulant que le but n'est évidemment pas de remettre "Dieu à l'école", que l’'enseignement du religieux n'est pas un enseignement religieux, et que « la quête de sens est bien une réalité sociale [...] mais on ne saurait, pour répondre à la demande et par facilité, reconnaître aux "religions" [...] un quelconque monopole du sens. »
(3) « Ce que Phobie veut dire », Olivier Rolin in le Mondes Livres, 14 janvier 2015.
(4) « Lettre ouverte au monde musulman », par Abdennour Bidar, in Marianne du 3 octobre 2014. Pour le philosophe, les croyants ne peuvent pas se contenter de dénoncer la barbarie terroriste pour éluder l’origine des dérives djihadistes. Face aux dogmes et à l’instrumentalisation politique dont ils sont l’objet, le monde musulman doit faire son autocritique et œuvrer à sa propre réforme.
(5) Discours de Jean Jaurès, lors du 7° congrès des socialistes de la SFIO tenu à Nîmes les 6, 7, 8 et 9 février 1910. Sa conception de la laïcité peut se résumer en trois assertions fondamentales et complémentaires : La laïcité ne se réduit pas à la tolérance car elle est fondée, non seulement sur la liberté de conscience, mais aussi sur le respect égal et mutuel de toutes les personnes puisqu’il n’y a pas de liberté pour l’homme sans égalité de droits. « Démocratie et laïcité sont deux termes identiques» car « la démocratie n’est autre chose que l’égalité des droits » et que « la démocratie fonde en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, tout son droit politique et social, ...» (L’Humanité, 2 août 1904). « Laïcité de l’enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles. Nous lutterons pour les deux » s’exclamait encore Jaurès le 25 janvier 1910 à la fin de son célèbre discours Pour la laïque. L’émancipation laïque participe aussi bien de l’émancipation intellectuelle que de l’émancipation sociale. Cette conception de la laïcité est au cœur de la pensée jaurésienne en même temps qu’elle en est le dénominateur commun et cette « dialectique des émancipations », selon la formule d’Henri Pena-Ruiz, ne peut se comprendre que dans sa triple dimension philosophique, politique et sociale.
DEMAIN N’EST PAS FORCEMENT UN AUTRE JOUR
LES ENJEUX
LA GAUCHE EN PANNE
LES DEFIS DE L’ECOLOGIE POLITIQUE
UN ESPACE POUR EELV ?
RESTAURER LA CRITIQUE SOCIALE
PROMOUVOIR DES PERSPECTIVES POLITIQUES REALISABLES ET DESIRABLES
OUVRONS LES FENETRES ET … NOS HEMISPHERES !
(Pour la création d’un Atelier écologique)
« Comme Cézanne se demande si ce qui est sorti de ses mains
Offre un sens et sera compris, comme un homme de bonne volonté,
Considérant les conflits de sa vie, en vient à douter que les vies
Soient compatibles entre elles, le citoyen d’aujourd’hui n’est pas sûr
Que le monde humain soit possible. Mais l’échec n’est pas fatal.
Cézanne a gagné contre le hasard. Les hommes peuvent gagner
Aussi, pourvu qu’ils mesurent le risque et la tâche »
Maurice Merleau-Ponty (préface de « Sens et non-sens », 1948)
Nous vivons non seulement une crise mais aussi une métamorphose.
Et d’abord une crise de confiance que l’actualité jud
UNE REVOLUTION DEMOCRATIQUE, SEULE ISSUE A UNE RELANCE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE
Présenté par le groupe de travail "Enjeux européens et défis de la France" (animé par Stanislas Hubert)
15-04-2012
Les derniers événements (ratification du mécanisme européen de solidarité, conseil européen de mars,…) ne constitueront sans doute pas l’épisode le plus glorieux de la construction européenne.
L’Europe s’enlise. Elle s’enlise dans un libéralisme dont elle a totalement intériorisé l’idéologie et dans un refus de la démocratie qu’elle considère comme superfétatoire des lors qu’elle aurait à s’intéresser aux « choses sérieuses », en l’occurrence l’économie.
Plus grave, ces sommets à la chaine et cette production normative de traités donnent l’impression de la part de l’Europe, incarnée par l’antithétique duo Merkel-Sarko, d’une course effrénée mais perdue d’avance derrière des «marchés» et des agences de notation à qui elle souhaite donner des garanties coûte que coûte.
On sait que la crise a eu le mérite de mettre à nu les carences du modèle économique et la faiblesse des institutions de la zone euro. Et il n’est pas question de contester que la construction européenne doit irrémédiablement prendre le chemin du renforcement de la gouvernance économique qui jusque là faisait cruellement défaut dans le cadre d’une union monétaire. Dont acte.
Elle doit, on le sait aussi, prôner autre chose que la rigueur et l’austérité au risque de voir le continent européen sombrer dans une récession durable. Mais elle ne doit pas aussi négliger le fait que les crises sont liées : économique, sociale et environnementale et elle doit impérativement et réellement s’appuyer sur les peuples.
Aussi, il faut plaider pour le renforcement d’une Union européenne commandant les objectifs à long terme d’une société européenne écologiquement responsable et socialement juste, à coté d’un gouvernement économique (de la zone euro) qui sera nécessairement concentré sur la gestion à court-moyen terme.
Une sorte de système de « check and balances » entre l’avenir des générations futures et les impératifs économiques à court terme.
Malgré la crise que connait la construction européenne chacun s’accordent à penser que notre salut ne dépend que de « plus d’Europe », et certains de relever non sans ironie que ce sont les marchés qui finalement risquent de nous précipiter dans les bras d’une Europe fédérale. Et nous devrions nous en réjouir car seule l’Europe unie serait capable de faire face aux Etats-Unis, à la Chine et aux puissances émergentes pour imposer des solutions durables dans les défis climatiques, énergétiques, alimentaires et sociaux de notre monde.
Cette vision d’une Europe «rédemptrice » semble cependant aujourd’hui bien éloignée de la réalité du poids de l’Union européenne sur la scène internationale, fragilisée qu’elle est par le couperet d’une explosion de la zone euro, mais surtout en décalage réel avec les objectifs politiques que se fixe l’Europe et les moyens qu’elle y consacre.
Formuler et imposer des solutions durables nécessiterait des changements radicaux d’orientation des actuelles politiques européennes que le rapport de force politique (en défaveur des mouvements progressistes et écologistes) au PE, à la commission et dans les gouvernements européens, interdit ou en tout cas, rend difficile ( ex : 18 des 27 gouvernements européens sont de droite)
Comment plaider pour l’instauration en Europe d’une taxe sur les transactions financières en composant avec l’intransigeance des britanniques sur ce sujet ?
Comment préconiser l’inclusion de clauses sociales et environnementales avec les partenaires commerciaux de l’UE sans voir les allemands trembler pour leur commerce extérieur ?
Comment convaincre de la nécessité de l'émergence d'une politique européenne de défense autonome des pays d’Europe Centrale et orientale pour qui l’alignement atlantiste apparait comme évident et gage de sécurité devant l’hypothétique menace de leur voisin russe ?
Aussi lorsque l’Europe s’invite dans la campagne présidentielle, on se demande si la liste de bonnes intentions présentées par les candidats n’est que de l’ordre de la prophétie auto réalisatrice ou s’il y a derrière une réelle vision d’Europe et de la stratégie adaptée pour convaincre et mettre en œuvre.
Autrement dit, à quelle condition la victoire d’un ou une Présidente de gauche en 2012 en France pourrait permettre d’insuffler une nouvelle dynamique dans la construction européenne? Comment concevoir le « plus d’Europe » autrement que comme une « pensée magique » et définir une méthodologie pour en faire un outil à long terme au service de la transformation écologique et sociale de la société.
La relance de la construction européenne sur cette voie devra nécessairement s’appuyer sur une réforme des traités -Nous lui préférerions d’ailleurs une forme plus démocratique qu’une conférence intergouvernementale (ou de surcroit ou qu’un traité négocié à huis clos), mais elle devra aussi s’appuyer sur une révolution des mentalités et des pratiques. Si elle souhaite porter cette « révolution », la France devra adopter une nouvelle posture.
Une nouvelle posture européenne de la France : plus modeste mais plus fédératrice
L’Europe s’est construite pas à pas dès lors que les Etats arrivaient à faire converger leurs intérêts. A 27 Etats membres, la voie vers des compromis gagnant-gagnant est plus délicate à trouver. Depuis le traité de Nice en 2002, l’Europe est en panne, embourbée dans la pesanteur de sa gouvernance institutionnelle et dans l’absence de leadership.
Alors bien sur si réformes des traités il doit y avoir, ceux-ci doivent permettre de toujours plus favoriser le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, permettre l’émergence de l’ « opt-out » se substituant au droit de véto. Mais surtout le Conseil européen doit tracer des perspectives pour l’Europe et la France jouer un rôle d’impulsion. Or l’image de la France (et donc sa capacité de négociation et de conviction) sortira écornée de l’arrogante présidence de Nicolas SARKOZY qui aura donné l’impression à de toujours vouloir tirer la couverture à lui.
Le (ou la) nouveau (ou nouvelle) président-e- devra appliquer le B-A BA des règles du petit négociateur :
1) se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions ;
2) imaginer des solutions procurant un bénéfice mutuel avant d'arriver à un accord
3) Bien définir la marge de négociation dont dispose la France pour mettre en œuvre une véritable stratégie d’influence (plus fine) à contre pied de sa politique de puissance traditionnelle.
4) s’imposer comme méthode d’identifier clairement les objectifs européens français et de faire primer l’influence effective sur les enjeux symboliques.
Pour prendre un exemple, la France a-t-elle réellement « intérêt » à se s’arcbouter sur la présence du parlement à Strasbourg qui crispe l’ensemble des délégations et n’aurait-elle pas intérêt à abandonner cet enjeu symbolique au privilège d’autres enjeux sociaux par exemple.
Est-ce réellement de l’intérêt de français que de freiner le virage environnemental que la politique agricole commune se doit de prendre ? L’intérêt des français et de nos agriculteurs ne se trouve-il pas plutôt au carrefour entre souveraineté alimentaire, consommation durable, et environnement préservé et non dans le maintien d’une agriculture intensive subventionnée, et donc prodigieusement couteuse.
La France devra s’inventer une nouvelle posture pour permettre de dessiner les contours d’un projet ciblé, crédible pour l’Europe. Les chances de succès dépendront aussi de la capacité des citoyens d’adhérer à ce projet.
Une révolution démocratique de la techno structure bruxelloise, non seulement par conviction mais aussi par pragmatisme
L’Union européenne doit concilier impératif d’efficacité et besoin de légitimité. L’Europe s’est construite sur le postulat selon lequel l’intégration européenne était un processus continu où l’on passait d’une thématique d’intégration à une autre. Cette dynamique est enrayée et il nous faut lui en substituer une autre : Peut-on imaginer que la révolution démocratique puisse constituer le fer de lance de la construction européenne ?
Cette révolution démocratique que nous appelons de nos vœux ne doit pas être conçue comme un exercice incantatoire mais comme un impératif pragmatique. Nous ne devons pas y chercher une légitimation de la décision des ‘despotes éclairées’ qui composent nos institutions bruxelloises mais une mobilisation pour l’amélioration de la mise en œuvre de décisions européennes.
Autrement dit, parions sur le fait que la décision sera meilleure si le citoyen a été consultée et qu’elle sera mieux appliquée, si celui-ci y a adhéré.
L‘accusation de déficit démocratique au sein des institutions européennes est récurrente, pourtant elle n’a jamais été traitée de manière convaincante et ne s’est traduite en définitive que par des maxi ‘plans de communication’, comme s’il suffisait d’éclairer le citoyen européen des lumières bruxelloises pour leur faire prendre conscience de l’évidence européenne. Cela démontre à quel point la technocratie européenne est profondément convaincu d’agir pour le bien des peuples d’Europe et incapable de produire une autocritique de l’organisation et du fonctionnement de l’UE.
De quoi souffre la bureaucratie européenne ? De s’être volontairement mise -hors sol- pour ne pas être rattrapée par l’intérêt particulier des Etats mais elle n’a sans doute pas songé à la nécessité de se prévaloir de l’influences des lobbies. Il est inconcevable de penser que les groupes d’experts qui conseillent la Commission européenne sur les politiques du secteur financier sont sous l’emprise des représentants des banques, des assurances, des fonds spéculatifs, etc. L’Union européenne contrevient ainsi à l’article 9 de son propre Traité, qui parle du « principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions ».
Retisser le lien avec les citoyens tout en rompant avec les lobbies doit être un leitmotiv et susciter :
- Un rapprochement des institutions du terrain
- Une innovation en matière de participation
- L’émergence d’une démocratie sociale européenne
- Le développement d’un accès réel de la société civile aux Institutions européennes,
Le parlement : pierre angulaire de la démocratie européenne
Le renforcement des pouvoirs du parlement européen est souvent présenté comme le passage obligé pour renforcer la démocratie au sein des institutions tant il est vrai que la décision donne l’impression d’être captive d’une commission sans légitimité et d’un conseil européen prisonnier des intérêts étatiques. Cette « impression » ne reflète pas complètement la réalité car effectivement les différents traités ont progressivement étendu les domaines relevant de la codécision (aujourd’hui appelé procédure législative ordinaire) mais il est révélateur de noter que sur les principales compétences de l’UE, le parlement est encore tenu à l’écart : La politique commerciale commune lui échappe encore en partie malgré les nouveaux pouvoirs qui sont les siens depuis le traité de Lisbonne et, pourtant, si l’on songe à l’impact du commerce mondial sur la vie quotidienne, le parlement européen devrait avoir à se mêler davantage des choix opérés dans l’Union européenne et en répondre devant les citoyens qu’ils représentent.
En tant qu’instance formée d’élus du peuple elle devrait pouvoir aussi encadrer les missions de la Banque centrale européenne en veillant à ce qu’elle respecte dans ses prérogatives les dimensions sociale et environnementale.
Une « Europe des résultats » oui……mais au service du modèle social européen
L’Europe, quand elle le veut, sait être redoutablement efficace si on la juge par exemple à l’aune de son action « en faveur » du droit de la concurrence. Il n’y a dans ce domaine pas d’arsenal législatif plus complet, d’action publique mieux outillée, de politique plus interventionniste. Il faudra transposer cette efficacité au service du modèle social afin de permettre que la diversité de l’Union provoquée par l’élargissement devienne un atout et non un espace de mise en concurrence des territoires et des salariés.
L’UE devrait travailler entre autres à :
- L’établissement d'un revenu minimum d'existence financé par chaque État membre. A contrario, l’idée d’un salaire maximum pourrait s’imposer aussi au niveau européen.
- La définition d’un cadre davantage protecteur pour les services publics notamment sociaux.
- Imposer un plancher d’objectifs minimaux quantifiés de dépense sociétales pour les Etats membres en pourcentage de PIB (par exemple pour les dépenses d’éducation, de santé, de politiques familiales -sachant qu’un des principaux handicaps de l’Europe est son vieillissement).
- Exiger que tous les travailleurs soient protégés au travers de conventions collectives et/ou de la législation assurant l’égalité de traitement.
- Protéger les travailleurs migrants (la reconnaissance mutuelle de l’adhésion syndicale, le salaire égal pour un travail égal sur base du principe du pays d’accueil, l’information sur les droits des travailleurs migrants dans le pays d’accueil).
- Et bien sur une politique fiscale commune pour les pays de la zone euro et/ou harmonisée dans l’ensemble de l’UE.
La définition de nouvelles priorités visant à la transformation écologique de l’économie et de la société
Nous souhaitons en finir avec l’Europe subie et permettre l’affirmation d’une Europe voulue. L’Europe doit cesser de n’être que l’ « Empire de la norme » qui caricature son action et désespère ses défenseurs. Il y a fort à parier que les citoyens européens se retrouveraient autour d’objectifs donnant un sens nouveau à la construction européenne.
- Le développement des énergies renouvelables, les questions de dépendance énergétique, de sureté technologique (rappelons qu’il ya 146 centrales nucléaires en activité dans l’UE) sont par nature à traiter à l’échelle du continent.
- La reconversion industrielle/ ré industrialisation concernent les travailleurs européens.
- La politique de transport durable (le pendant du principe de libre circulation des marchandises).
Reste la question du financement ? Hormis le fait qu’il faille lever un impôt européen (ou en tout cas que l’UE bénéficie de ressources propres) il convient de noter qu’aujourd’hui les principaux postes de dépenses du budget européen sont impopulaires et/ou incompris et /ou inefficaces :
Les gros chèques versés à quelques agriculteurs donnent le sentiment d’un dispositif à deux vitesses et en ce qui concerne la politique dite « régionale » le mythe d’une Europe du sud
(Espagne, Portugal, Grèce) rattrapant son retard grâce aux miracles des fonds structurels a été balayé par l’effet révélateur de la crise de l’Euro. Le miracle (ou mirage) était en réalité davantage du à un dumping fiscal ou social ou à des bulles spéculatives.
Là ou elle devrait réglementer, l’Europe applique une logique de guichet insuffisante et infructueuse. Là ou elle devrait financer des infrastructures, inciter, … l’Europe renvoie à la responsabilité des Etats.
Si l’on sombre exagérément dans le pessimisme on peut légitimement se demander si les crises successives que connaît l’Europe ne font pas que précipiter le vieux continent dans la catégorie des puissances de second rang. Faut-il alors se résoudre à considérer que la construction politique de l’Europe n’aurait été qu’un sursaut dans un processus historique de déclin amorcé au lendemain de la 1ère guerre mondiale. Il faut espérer que non car si l’Europe fut la cape dans laquelle se sont drapés les Etats européens pendant des décennies pour libéraliser leurs économie, elle reste la construction politique qui se rapproche le plus du projet de paix perpétuelle énoncé par Kant.
MEDIATOR : la pilule ne passera plus
06-11-2011
L’équation chimique du Médiator, le médicament au coeur du dernier scandale sanitaire dont la France a le secret, est finalement très simple : prenez une molécule dangereuse, dérivez-là, enrobez-là pour mieux la faire glisser, puis prescrivez largement.
Le résultat ?
Des millions d’euros de gain, des milliers d’hospitalisations et 500 à 2500 morts selon les différentes estimations. Dans cette simple équation, se cache encore une inconnue de taille, le fameux X, le point d’interrogation, le responsable de cette effroyable recette pharmaceutique. Mais qui est-il ? Où plutôt qui sont-ils ?
De sa fabrication à sa prescription, la chaîne du médicament compte de nombreux acteurs privés et publics qui peuvent chacun être responsable. Le premier auquel on peut légitimement penser est le laboratoire. C’est l’auteur du fameux produit, le Benfluorex ou Mediator de son nom commercial, un médicament destiné aux diabétiques en surpoids mis au point par le laboratoire Servier en 1976. C’est ce laboratoire qui a décidé de créer un traitement à partir d’une molécule dangereuse et tout bon chimiste vous dira qu’un dérivé peut être totalement inoffensif.
Sauf que si vous développez un tel produit, vous savez qu’il faudra plus de données, plus de tests pour prouver que votre nouvelle molécule est elle totalement inoffensive.
Des effets secondaires graves et mortels incontestables révélés aujourd’hui ne nous offrent que deux conclusions possibles : soit le médicament a été mal testé, soit, et cela serait bien plus grave, l’ensemble des résultats n’a pas été porté à la connaissance des autorités sanitaires. Simple hypothèse.
Le deuxième et immédiat acteur dans cette chaîne est l’état, représenté par le très opaque terme des « autorités sanitaires ». Concernant le Médiator, et sachant qu’il était dérivé d’une molécule dangereuse, on se demande comment elles on pu passer à côté de la toxicité de ce médicament, alors que des pays voisins ne l’ont pas autorisé sur leur sol. On se demande qui sont les individus qui évaluent les dossiers ? Sont-ils vraiment indépendants ? Ont-ils vraiment la compétence ? Ont-ils aussi les moyens de contrôler ce que leur présentent les industriels ?
S’agit-il de connivence ou de négligence ? La question est grave, surtout lorsqu’il est de notoriété publique que Servier, le 2e groupe pharmaceutique français après Sanofi, travaille très étroitement avec l’INSERM (Institut National de la Recherche Médicale) et le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).
Malgré des signes, qui a posteriori semblent évidents, les fameuses autorités sanitaires ont approuvé la commercialisation du Médiator. C’est donc logiquement et en toute confiance que les médecins prescrivent le médicament à leurs patients diabétiques en surpoids pour maîtriser leur surcharge pondérale : c’est ce que dit la notice. Le médiator est d’ailleurs un vrai succès, prescrit très largement, non qu’il soit révolutionnaire, rappelons qu’il ne guérit pas le diabète, mais sans doute parce que de nombreuses publicités parviennent jusqu’aux médecins et que de larges cohortes de « visiteurs médicaux », les VRP de l’industrie pharmaceutique, se montrent convaincants ou convaincantes.
De nos jours, un médecin généraliste peut recevoir jusqu’à 15 visites par semaine. Heureusement que les gratifications directes faites un temps aux médecins ont été interdites ! Mais le hic dans l’histoire, c’est que les prescripteurs ont élargit la cible du médicament et l’ont prescrit comme coupe-faim au tout venant. Résultat : le Médiator aurait été utilisé par 5 millions de personnes, dont 2,9 millions qui l’auraient pris pendant plus de 3 mois.
Que s’est-il donc passé ? Sont-ce les médecins qui ont décidés d’en faire un médicament de régime général ?
Est-ce le laboratoire ? Qui a donc décidé de sortir le médicament de sa classe d’origine et sur la base de quelles études ?
Retour à la case départ.
L’un des autres acteurs de cette chaîne que l’on oublie bien souvent est le temps qui passe. Seul le temps permet d’observer sur des patients le véritable effet des médicaments. Les études cliniques préalables à la mise sur le marché d’une nouvelle substance sont terriblement courtes –quelques années au mieux – au regard des décennies où celle-ci sera ingérée. Or les effets secondaires du Médiator, qui existe depuis des années 70, auraient été remarqués bien avant 2009, date de son interdiction en France. Des médecins auraient signalé il y a des années de cela les risques d’hospitalisation, et certains se sont mêmes alertés sur l’utilisation du Médiator comme coupe faim dans la population non diabétique. L’enquête en cours éclaircira ces aspects, mais on ne peut s’empêcher de constater qu’à l’ère de la toute puissance de l’information et de la communication, certaines données et non des plus futiles circulent mal.
Avec l’informatisation et notre système de couverture sociale nous avons pourtant tous les outils nécessaires à disposition pour que les médecins reportent les effets secondaires de tout traitement sur leurs patients, tout comme leur réelle efficacité.
Le problème, c’est qu’au bout de cette chaîne complexe, se retrouve le patient. Nous souhaitons tous croire qu’avec une pilule -ou plutôt 30 aujourd’hui- tous nos problèmes vont s’envoler comme par miracle. Mais nous n’avons pas la compétence pour juger de cela. Celui qui doit savoir, c’est le laboratoire, l’autorité de contrôle, le médecin… mais pas le patient.
Enfin n’oublions pas le contribuable qui est aussi une victime muette de ce scandale sanitaire mais également financier. Car ce fameux Médiator est remboursé par l’Assurance maladie et les « complémentaires santé ». Entre 1999 et 2009 elles auraient déboursé respectivement 325 et 99 millions d’euros pour ce coupe-faim-coupe-cigare qui permet au groupe Servier d’afficher un superbe 3,6 milliard d’euros de chiffre d’affaire pour l’année 2009. De quoi avoir l’appétit coupé, lorsque l’on connaît le niveau du déficit de notre sécurité sociale, un appétit qui reviendra peut-être si la promesse que vient de faire l’Assurance Maladie de poursuivre le laboratoire est tenue.
Sur « l’affaire Médiator », l’enquête nous dira peut-être qui sont les véritables responsables. Mais pour les autres ?
Pour tous ces médicaments à la douteuse efficacité dont la plupart sont également remboursés par la sécurité sociale et dont on gave les français dans la plus grande banalité : que faire ? Peut-on être sûrs que ne se cachent pas dans ce pilulier géant d’autres Médiators ? Ne nous leurrons pas, cela fait des décennies que les industries pharmaceutiques n’ont pas produit un seul médicament qui vous ôte une maladie. A part quelques rares thérapies anticancer, ou la trithérapie dans le cas du VIH – qui ne guérit pas mais permet de vivre plus de 20 ans avec le virus - il n’y a pas eu de nouvelles molécules performantes mises sur le marché depuis 30 ans. Il est vrai que la recherche peine a trouver des solutions aussi radicales que la pénicilline, ou de nouveau vaccins qui éradique une maladie infectieuse aussi grave que la variole en leur temps. Mais plus on diminue les crédits de la recherche publique, moins l’on explorera de pistes. Il ne faut pas croire que la recherche soit développée par l’industrie pharmaceutique, l’industrie est la pour développer des produits qu’elle pourra vendre à des millions d’exemplaires. Exit les maladies rares, ca ne rapporte pas. Mais adieu aussi aux traitements radicaux car ça ne rapporte pas non plus. Nous sommes entrés dans l’ère du médicament de confort. Ce médicament qui vous fait vivre plus longtemps avec votre maladie, et qui pourra être votre fidèle compagnon des décennies durant.
Tout cela ne serait pas tant dérangeant si cela ne concernait pas des produits de santé, et donc notre santé. Et cette donnée là fait de l’industrie pharmaceutique une industrie à part, mais une industrie tout de même qui se trouve dans une logique de profit à court terme, et qui n’est plus là pour développer des molécules sur 20 à 30 ans pour guérir une maladie.
De nombreuses molécules de santé sont mises sur le marché régulièrement, avec l’accord des autorités sanitaires, souvent remboursées par la sécurité sociale, puis des visiteurs médicaux envoyés par les industries pharmaceutiques démarchent les médecins dans leurs cabinets, font la promotion de leurs produits, et les médecins les prescrivent à leurs patients.
Voila le système existant, un système qui n’empêche visiblement pas un « Médiator » de voir le jour, et qui place les français parmi les meilleurs consommateurs de médicaments au monde, substances dont on sait si peu au final.
Les niveaux d’exigence ne sont plus satisfaisants. Le système est à revoir urgemment. Rappelons-nous de l’épisode du vaccin contre la grippe AH1N1. Pour produire un vaccin, essais cliniques compris, il faut au minimum 6 mois. La France a passé des contrats avec l’industrie pharmaceutique pour ses fameuses 90 millions de doses, avec un délai de production de 3 mois. Il y a donc des étapes qui ont sauté, subitement considérées comme négligeables. Avec un tel arrangement, les industriels n’ont pas voulu endosser la responsabilité et s’il y avait eu des effets secondaires c’est le gouvernement français qui aurait été responsable. L’accord est de notoriété publique et peu s’en sont indignés.
Un médicament n’est pas un produit anodin, et à ce titre l’industrie de la santé n’est pas une industrie comme les autres. Quand au coût environnemental de toute cette chimie que l’on ingère et qui finit dans la nature, il n’est tout simplement pas abordé.
Il est urgent de prendre bien plus au sérieux ces pilules que l’on nous fait avaler, et pas seulement, il faut étendre la vigilance à tous ces produits chimiques qui se baladent dans la nature, et qui n’étant pas des produits de santé ne sont soumis du coup à aucun contrôle.
Et là c’est peut-être bien plus grave.
Rappelons-nous le cas de l’amiante. Eveillons nous sur les problèmes actuels de Bisphénol A, de benzène, et de tous ces composés présents dans les produits de consommation courante et que l’on sait toxiques pour l’homme. Alertons-nous sur les nanoparticules, présentes déjà partout sans qu’aucun test de toxicité sur l’homme ou notre environnement n’ait été demandé, et qui peuvent se loger n’importe où dans le corps humain y compris le cerveau. Surtout gardons en tête la phrase de Paralcèse : « Rien n'est poison, tout est poison : seule la dose fait le poison ».
Lire la notice ne suffit pas.
Enfin n’oublions pas les cotisants et les contribuables qui sont aussi des victimes muettes de ce scandale sanitaire mais également financier. Car ce fameux Médiator est remboursé par l’Assurance maladie et les complémentaires santés. Entre 1999 et 2009 elles auraient déboursé respectivement 325 et 99 millions d’euros pour ce coupe-faim-coupe-cigare qui permet au groupe Servier d’afficher un superbe 3,6 milliard d’euros de chiffre d’affaire pour l’année 2009.
De quoi avoir l’appétit coupé, lorsque l’on connaît le niveau du déficit de notre sécurité sociale, un appétit qui reviendra peut-être si la promesse que vient de faire l’Assurance Maladie de poursuivre le laboratoire est tenue.
SANTE : QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES ?
10-03-2011
Pour garantir le droit de tous les citoyens à la santé, il est urgent de dépasser les conceptions strictement comptables pour promouvoir des politiques cohérentes qui s’attaquent réellement aux inégalités.
Dans Indignez-vous, best seller du début de l’année 2011, Stéphane Hessel pointe les menaces qui pèsent sur le système français de protection sociale et de santé tel qu’il a été conçu par le Conseil National de la Résistance. Les réformes successives de l’assurance maladie, la loi Hôpital Patient Santé et Territoires de 2009 ou encore les projets du gouvernement sur la dépendance - avec un possible recours au secteur privé - conduisent effectivement à mettre en question la pertinence des politiques publiques françaises en matière de santé. En octobre 2007, Denis Kessler, PDG de Scor, n’expliquait-il pas dans le magazine Challenges - pour s’en réjouir - que les réformes du gouvernement dans le domaine social avaient toutes pour objectif commun de « défaire méthodiquement le programme du CNR » ?
N’en déplaise aux partisans de l’ « adieu à 1945 », l’accès de tous aux meilleurs soins quels que soient leurs revenus est un pilier de notre République. La préservation de la santé et l’amélioration des conditions des malades sont au cœur de l’Etat providence. Il s’agit d’un choix, d’une priorité, à notre sens non négociable, qui est également au fondement de la santé économique et sociale d’une nation.
Or les politiques de santé actuelles sont pensées de manière compartimentée, au prisme principal de la « crise » comptable de l’assurance maladie. Réduire le « trou de la Sécu » est une obsession de politiques qui porte sur le respect des normes budgétaires et comptables imposées par les marchés financiers internationaux et les suppôts Organisation intergouvernementales ou transnationales qui s’en font les fidèles interprètes. On peut noter ainsi, avec inquiétude, le synchronisme du démantèlement de l’Etat providence en santé (baisse du remboursement solidaire et poids grandissant de l’assurance privée dans le remboursement de la médecine de tous les jours, rationalisation marchande de l’offre de soins sans pour autant toucher à la médecine libérale, etc.) et le développement de politiques qui visent principalement à « responsabiliser » les individus face à leur santé …
Une réorientation des politiques de santé et de santé publique est à l’évidence nécessaire.
Politique de santé
S’agissant de l’assurance maladie, la pression a jusqu’à présent été mise sur les assurés :
augmentation croissante du reste à charge depuis de nombreuses années (franchise, forfait, etc.) et lutte contre leurs « abus ». La conséquence de cette évolution est la privatisation du « petit » risque, qui ouvre la voie d’une « sélection des risques » par les assureurs. En réalité, le problème n’est pas tant de réduire le « déficit » que d’assumer le fait qu’il faut augmenter le niveau de financement de l’assurance maladie.
L’Hôpital public est le garant de l’égal accès à des soins de haute qualité. La rationalisation est nécessaire, mais l’introduction de mécanismes de marché sans régulation n’est à l’évidence pas la solution. Une amélioration de la prise en charge hospitalière passe en priorité par l’incitation à la coopération et l’aide à la coordination entre tous les acteurs plutôt que par leur mise en concurrence. La notion de qualité des soins est tenue pour évidente, alors qu’elle renferme des choix politiques. La définition d’indicateurs de qualité pertinents doit faire l’objet d’une négociation entre tous les acteurs – dont les représentants de patients – au lieu d’être réalisée, comme cela a été le cas jusqu’à présent, de manière technocratique par des gestionnaires et des économistes de la santé. Parallèlement, il est urgent de développer le réseau ville/hôpital. Casser la frontière entre médecine de ville et médecine d’hôpital doit devenir une priorité.
Un autre chantier important de la politique de la santé est la négociation avec la médecine libérale. Depuis 1927, celle-ci jouit d’un grand nombre de libertés (installation, entente directe, etc.) sur lesquelles on doit aujourd’hui réfléchir. Depuis dix ans, les gouvernements de droite ont augmenté le tarif de la consultation dans des proportions qui ne sont pas comparables à l’évolution des salaires dans d’autres secteurs. Dans le même temps, le modèle libéral suscite de moins en moins de vocation (sauf pour les spécialistes dans les beaux quartiers des grandes villes). Un gouvernement de gauche se doit ainsi de réformer les conditions d’exercice de la médecine libérale et de repenser la répartition géographique des médecins de manière plus maîtrisée. La régulation de l’offre a essentiellement concerné la médecine hospitalière ; il est temps que l’on se penche sur le cas de la médecine libérale.
Politique de santé publique
La construction de l’Europe de la santé doit être poursuivie, en donnant des compétences propres à l’Union. Il faut éviter que la Direction Générale Santé et protection du Consommateur ne soit conduite à économiciser ses politiques. Elle doit retrouver de l’influence en matière de santé publique et pas seulement dans le domaine de la protection du consommateur.
Il est urgent de bâtir de véritables politiques de santé publique, orientées vers la réduction des inégalités sociales de santé, et non vers la seule « éducation » de ceux qui ont des comportements délétères pour leur santé (tabagisme, alcoolisme, alimentation obésogène, absence d’exercice physique, etc.) et qui, comme par hasard, sont les plus nombreux dans les couches sociales les plus défavorisées de la population.
Une action plus volontariste doit être menée à l’égard des entreprises productrices de risques (industries agro-alimentaires, industries chimiques, industries pharmaceutiques, etc.). Agir pour la santé publique, c’est aussi lier plus systématiquement santé et environnement dans le cadre d’une politique de recherche et de surveillance épidémiologique. C’est développer la recherche sur les déterminants de santé et sur les conséquences sanitaires des transformations écologiques.
De manière plus spécifique, il est urgent de concevoir de vraies politiques de santé mentale et de lutte contre le handicap, qui restent les parents pauvres des politiques publiques.
Des politiques cohérentes contre les inégalités
La priorité des politiques de santé doit être la lutte contre les vrais déterminants des inégalités de santé et des inégalités d’accès aux soins, qui sont d’ordre économique et social, par des politiques de redistribution. La transformation du comportement individuel ne doit pas être pensée indépendamment du contexte socio-économique dans lequel il se réalise.
Les politiques de santé doivent être pensées dans le cadre d’un Etat providence que l’on consolide au lieu de le dépecer. En effet, le véritable déterminant de l’état de santé d’une population n’est pas son niveau de consommation de soins (l’exemple des Etats-Unis le montre), mais le niveau de ses inégalités sociales et l’amplitude de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres.
C’est pourquoi il faut ainsi rompre avec la focalisation actuelle sur la réduction comptable des déficits de l’assurance maladie, qui justifie des réformes d’inspiration néolibérale dont la supposée efficacité mécanique est un leurre. Partout où l’on a laissé faire le marché, on a abouti à un niveau de dépenses de soins considérable (en % du PIB) et à de fortes inégalités. Là encore, le cas des Etats-Unis est éclairant.
Enfin, l’un des enjeux majeurs à l’avenir est de concevoir les politiques de santé comme de vraies politiques intersectorielles et interministérielles et éviter qu’elles ne restent l’objet de lutte entre ministères (cf. la concurrence entre les Ministère de l’alimentation et de la santé en matière de politique de lutte contre l’obésité). Les ministères en charge de l’industrie (maladies professionnelles), de l’économie (lutter contre de trop fortes inégalités salariales dont des travaux ont montré le lien avec les inégalités de santé), de l’environnement, de l’alimentation et de la santé doivent, sur chaque sujet, apprendre à travailler ensemble.
Telles sont, à notre sens, les grandes orientations propres à garantir réellement le droit à la santé, principe de valeur constitutionnelle institué, en France, en 1946.
CULTURE, FILLE PUBLIQUE
20-03-2011
La dernière politique culturelle majeure de ce pays, à proprement parler "révolutionnaire" au sens où elle accomplit une révolution complète des mécanismes publics de soutien à la création et aux professions culturelles, fut l'œuvre de Jack Lang.
Aux politiques patrimoniales, muséales ou dirigées vers de grands établissements, essentiellement parisiens, de diffusion de la culture française classique, à l’impasse des MJC, originellement pensées comme espaces d'expression d'une création contemporaine devenues symboles « sociocucul » du macramé-poterie, bref à l'échec malrucien, Jack Lang répondit comme seul Nicolas Fouquet aurait pu s'y attendre, par de somptueuses fêtes populaires.
Ah! Comme on a glosé et glose encore, de Fumarolli en Finkielkrault, Bendas du pauvre, sur l'émergence d'une culture paillette, festive, suiviste de la rue, démagogue et putassière. Lectures de gribouille : pour Lang, les fêtes n'ont jamais été que le sommet émergé de l'iceberg, ce travail de fond qu'il fit avec les professionnels de la culture.
Loi sur le prix unique du livre, création d'un maillage territorial de lieux de création et de diffusion de la culture contemporaine (centre dramatiques, théâtres nationaux, scènes nationales...), réforme du financement du cinéma, renaissance des Arts du Cirque, développement sans égal de la danse, politique de grands travaux, financement public des arts plastiques, explosion des pratiques amateurs, excellence des filières de formation... l'œuvre du ministre de la culture de François Mitterrand demeure sans égale. L'Histoire, une fois que l'agaçante posture actuelle de Jack Lang sera enfin oubliée, retiendra cette œuvre.
Depuis, que s'est-il passé ?
Interrogez les Français : tous citeront Jack Lang, nombreux même continueront de le croire Ministre, aucun, ou presque, ne se souviendra de ses successeurs. C'est parfois injuste (pour Jacques Toubon notamment, qui sut approfondir l'œuvre de Lang et la réformer), c'est souvent la sanction d'une inutilité pailletée (Tasca, Albanel), d’une erreur de casting (Léotard, Trautmann...) ou d'une impuissance dommageable (le gâchis Frédéric Mitterrand). Depuis vingt ans, la politique culturelle tourne à vide.
Si grand est l'héritage qu'on peine à voir ce lent déclin de notre intervention publique en matière culturelle.
Déclin des financements (où en sont les 1 %), mais surtout, mais pire: déclin de la pensée politique en matière de culture.
Aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques tient sur la culture un discours indigent, le défunt Parti Communiste Français excepté, lequel a rétabli un dialogue durable avec les professions culturelles (chez Europe Ecologie, la cacophonie noie les positions intéressantes, au PS, le silence est assourdissant). Pour autant, le PCF n’évite pas l’écueil, qui résume la crise actuelle de nos politiques culturelles à une crise de financement.
Certes, crise de financement il y a. Et grave. La baisse des crédits du Ministère de la Culture, durable, a longtemps été compensée par la montée en puissance des politiques culturelles des collectivités territoriales.
Aujourd’hui, avec la grave crise que traversent celles-ci, ce n’est plus vrai. Déjà, des collectivités durement touchées par la crise, les départements, sont contraints de pratiquer des coupes sombres dans leurs subventions culturelles. Déjà, des manifestations disparaissent, tuées par le manque de financement.
Déjà, l’évidence se produit : les plus grosses d’entre elles, les plus populaires, conservent leurs financements au détriment des autres, celles où se joue une partie de la création contemporaine, encore obscure, encore confidentielle.
La recentralisation à laquelle on assiste depuis 2007 est, pour la culture, une catastrophe. Non que nous défendrions, au nom d’une décentralisation qui serait, par essence, bonne, une politique girondine acharnée.
Simplement, les jacobins d’aujourd’hui, ceux qui sont au gouvernement et à l’Elysée, veulent à la fois en finir avec la décentralisation, ce qui suppose de renforcer l’Etat, et dépouiller celui-ci. Recentraliser en réduisant les effectifs de la fonction publique, en affaiblissant les pouvoirs publics, en privatisant l’action publique, c’est soigner à coups de marteau une jambe cassée.
En matière culturelle, alors que les collectivités sont contraintes de diminuer la voilure faute de compensations honnêtes et d’autonomie fiscale, le Ministère est à genoux : le Ministre n’existe pas, certaines directions disparaissent, telle celle du livre et le la lecture, une partie des crédits dévolus au Ministère est réorientée vers le conseil présidé par Marin Karmitz, une autre partie est ponctionnée par les opérations de communication du Grand Paris, lequel vient de se voir doté, par le Président de la République, d’un « Monsieur Culture » dont on se doute qu’il pourrait devenir Ministre bis de la Seine à la Loire.
Alors oui, admettons la crise de financement et soyons aux côtés de ceux qui, régulièrement, défilent devant la rue de Valois pour clamer la pénurie, la pauvreté et la disparition pure et simple de l’action culturelle dans ce pays.
Pour autant, admettons aussi que l’argent ne suffira pas. La culture contemporaine, dans son ensemble souffre d’un mal plus profond, plus grave : une forme de désaffection des publics.
Certains l’ont bien vu, qui préconisent une culture par et pour le public (voir, sur ce sujet, le programme culture du Front National contre lequel il faut lutter non pas en hurlant au loup fasciste, mais en en pointant les bêtises, l’ignorance et la vacuité). Chez les socialistes eux-mêmes des voix s’élèvent qui réclament une grande culture populaire, où le public aurait son mot à dire. Ainsi a-t-on vu certains hiérarques plaider pour que le public participe aux choix de programmation des théâtres subventionnés.
Ah, Bouvard, ah, Pécuchet, vous voilà-t-il donc la rose au poing ?
En vérité, ce que en quoi nous continuons à croire, au PRé, ce n’est pas à une moindre exigence de la création. C’est à l’adhésion d’un public nombreux, populaire, renouvelé à une création contemporaine exigeante, difficile, sans concessions.
Le peuple n’est pas l’imbécile qu’on se plaît à imaginer dans les milieux réactionnaires. Et ses choix culturels sont le fait de son éducation et de sa condition sociale, non d’un mauvais goût inné qui le pousserait vers des films médiocres, de mauvaises pièces de boulevard ou des croutes figuratives. Sans doute, la culture populaire reconnaît les classiques et les promeut.
Sans doute, si le fantasme d’aucuns, faire de la vox populi un directeur artistique, prenait corps, nos théâtres ne joueraient-ils que Molière, Beaumarchais, Rostand, peut-être Ionesco. Mais ils ne joueraient pas Bigard. Le peuple fait la différence entre TF1 et Arte ; simplement, il ne regarde pas Arte.
Pour cette raison, il faut plaider pour une fusion entre le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education Nationale. Car il faut confronter, dès leur plus jeune âge, les enfants aux Arts, aux pratiques culturelles, à la dimension muséale. Eduquer le public, former le citoyen, cela suppose de le mettre au contact régulier, pérenne, dès ses trois ans, avec l’Art dans toutes ses disciplines. Comment se fait-il qu’en France, on cesse d’aller au Louvre une fois la cinquième passée ?
Comment se fait-il que les pratiques artistiques soient abandonnées, sauf filières dédiées, dès la seconde ?
La tentative de Jack Lang, qui fut Ministre à la double casquette (1992) reste à mettre en œuvre : il faut, en France, un Ministère de la Beauté, de l’Intelligence et des Savoirs. Sinon, la scolarité restera, comme aujourd’hui, déconnectée de la culture et des perroquets qui n’auront rien lu que les œuvres au programme continueront de réussir les concours d’entrée aux grandes écoles.
Il ne s’agit pas, pour autant, de « rationaliser » et de trouver des « synergies », mots qu’on emploie pour ne jamais dire économies et rigueur. Nous plaidons pour le retour au 1%, et même pour aller au-delà. Ce que nous pensons, c’est qu’il faut consacrer 1% du budget de l’Etat à la création contemporaine et trouver d’autres sources, notamment fiscales, pour financer le patrimoine. Pour lequel, d’ailleurs, nous plaidons, à l’exception d’une dizaine de grands musées et d’autant de bâtiments de prestige, pour une décentralisation totale.
En matière culturelle, les financements croisés doivent se poursuivre, à la condition d’exiger de la transparence et de nommer, par secteur, un chef de file. Est-il normal, ainsi, que certaines Régions contribuent au financement de théâtres nationaux par ailleurs déjà bien dotés au détriment de petites compagnies et de lieux de moindre visibilité ?
A l’Etat les équipements déjà labellisés par lui, aux collectivités, le financement des autres.
Le livre est le grand oublié des politiques publiques culturelles, en termes de financement (car existent les lois sur le prix unique du livre, Lang pour le papier, en cours de vote pour le numérique). Première industrie culturelle de France, le livre est surtout la moins soutenue. Ainsi, si le Centre National du Cinéma affiche un budget de 575 millions d’euros, celui du Centre National du Livre, son pendant, peine à atteindre les 30 millions d’euros. Que les éditeurs soient, en matière de lobby, des enfants comparés aux producteurs, toujours prompts à hurler à la mort de notre exception culturelle, ne fait pas de doute.
Pourtant, il est temps de doter le CNL de moyens propres à porter, urbi et orbi, une grande ambition. La langue française reste certes la deuxième langue de traduction dans le monde mais, année après année, elle cède du terrain devant l’anglais.
Réconcilier les publics avec la création contemporaine, cela demande aussi des financements. Chaque fois qu’une compagnie, un lieu, une association culturelle, un auteur en résidence… font le choix de travailler avec le public, le résultat s’avère à la hauteur des espérances. Accompagnés dans leur découverte de la création, associés même parfois au processus créatif, les publics, y compris les plus éloignés à priori, suivent. Si exigeante que soit la création, celui auquel on a pris la peine de l’expliquer est en mesure d’y assister et de la comprendre, de faire, en conscience, le choix de l’aimer ou non.
Aussi, il nous paraît nécessaire, à tout le moins, de mettre en œuvre des financements spécifiques dédiés aux publics, au-delà même de financement associatifs, sur la base de projets, en exigeant de tous les lieux subventionnés, mais aussi de tous les arts, qu’ils associent le public étroitement au travers d’ateliers, d’interventions dans les écoles, de partenariats avec les amateurs, avec les associations, d’interventions dans les lieux de souffrance… Œuvrer pour le public sans rien sacrifier de l’exigence de sa création, voilà ce qu’on devrait pouvoir exiger de ceux qui prétendent, à juste titre, bénéficier de financements publics.
Ces quelques pistes que nous ouvrons au débat sont bien sûr loin, très loin, de constituer un programme culture complet et cohérent pour le pays.
Mais nous avons, au PRé, l’ambition de mettre la culture au cœur de nos propositions, et nous remettrons l’ouvrage sur le métier, avec d’autres pistes, d’autres propositions et des fiches sectorielles.
La culture n’est pas un supplément d’âme. Elle incarne, aux yeux du monde, la grandeur d’un peuple. Depuis des années, le débat culturel est escamoté, dans ce pays. Rouvrons-le.
C’est, modeste et démesurée, notre ambition.
A QUOI SERVENT LES BANQUES ?
04-04-2011
Tirer les leçons de la crise financière implique un encadrement strict de la spéculation et un recentrage des banques sur leur vocation première : le financement de l’économie réelle.
La crise financière de 2008 a mis en lumière un certain nombre de problèmes sous-jacents qui couvaient depuis plusieurs années et qui ont eu des répercussions soudain massives : creusement des inégalités, endettement, spéculation ont été les principaux ingrédients de ce cocktail explosif.
Les excès spéculatifs des banques et leur nécessaire sauvetage ont confirmé que le capitalisme financier dérégulé et mondialisé n’est ni rationnel, ni efficace.
En France, les PME ont beaucoup de mal à accéder au crédit, les inégalités de revenus entre les ménages continuent à se creuser et la pauvreté s’accroît. La part du salaire dans la valeur ajoutée a considérablement diminué ces dernières années. Le surendettement progresse et les frais bancaires atteignent parfois des montants prohibitifs.
Comment promouvoir un nouveau modèle de croissance et éviter que les mêmes causes produisent à nouveau les mêmes effets ?
Limiter la spéculation bancaire
La spéculation à laquelle se livrent les banques doit être limitée, ce qui suppose une régulation bancaire et financière entièrement revisitée.
Des mesures de régulation ont commencé à être prises aux Etats-Unis, en Europe et en France, mais, dans une économie mondialisée, le dispositif de gouvernance mondial est central et doit s’appuyer sur les outils existants : G20, Comité de Bâle, FMI.
Le pouvoir des autorités de contrôle doit être renforcé.
En Europe, plusieurs mesures viennent d’être prises en ce sens: création d’un système européen de surveillance financière, création d’un conseil de régulation financière et du risque systémique en France, mise en place de collèges de superviseurs dans toutes les banques européennes. Ces dispositifs devraient s’articuler avec un dispositif mondial, ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui.
La limitation des prises de risques excessives passe par la séparation des activités de marché pour compte propre des activités de banque de dépôt et par la taxation. Aux Etats-Unis, les banques ont désormais l’obligation de filialiser leur activité de marché pour compte propre afin que les difficultés dans ce domaine n’impactent pas l’activité de banque de dépôt. Une mesure similaire doit être adoptée dans l’Union européenne.
Dans plusieurs pays d’Europe (la Suède, le Royaume Uni, l’Allemagne et la France), une taxation bancaire systémique a bien été mise en place, mais tous les dispositifs n’ont pas la vertu d’abonder un fonds de secours dédié en cas de difficultés bancaires. En particulier, en France, le produit de la taxe est fondu dans le budget de l’Etat.
Le durcissement des règles prudentielles régissant les établissements financiers est indispensable. Le Comité de Bâle a édicté en septembre 2010 de nouveaux ratios prudentiels obligeant les banques à renforcer leurs fonds propres. Malheureusement, ils ne devraient s’appliquer qu’à partir de 2019 ! Il faut avancer l’entrée en vigueur de cette mesure d’au moins cinq ans pour limiter les risques d’une nouvelle crise.
Les hedge funds devraient être prochainement soumis à des conditions plus strictes pour opérer en Europe, mais cette mesure paraît bien timide au regard des dégâts causés par ces fonds à vocation spéculative.
Ne devraient-ils pas tout simplement être interdits ?
Quant aux paradis fiscaux, le G20 a décidé d’établir des sanctions à l’endroit des juridictions non coopératives en matière de fourniture d’informations fiscales. Mais le fisc du pays d’origine doit pouvoir apporter la preuve d’une fraude ou d’une évasion fiscale, ou tout au moins un faisceau d’indices, ce qui réduit considérablement la portée de la mesure. Il faudrait obtenir la levée de cette condition.
Un meilleur encadrement de la vente de produits dérivés est également nécessaire. Un projet de directive vise à mieux les encadrer, en particulier les Credit Default Swaps (CDS), dont l’objet est de transférer sur d’autres le risque de crédit. Ce type de produit comporte deux dangers auxquels la directive doit remédier : l’assureur n’est pas obligé de mettre de côté les fonds pour garantir la transaction et le produit est revendable sans limites sur des marchés opaques.
S’agissant enfin des bonus des traders, le Comité des superviseurs européens des banques a prévu leur limitation : seule une partie (20 à 30% selon les cas) pourrait être versée immédiatement en cash, le reste devant être versé en titres, dont une partie différée sur trois ans. Mais toute latitude est laissée aux législateurs nationaux pour mettre en œuvre ces mesures et il est certain que les Etats risquent fort d’être frileux en la matière par crainte de faire baisser l’attractivité de leur place financière. Aussi vaudrait-il mieux que la mesure soit applicable à l’identique dans toute l’Union européenne et que des discussions s’engagent au niveau du G20 pour harmoniser les limites posées.
Recentrer l’activité des banques
Une meilleure régulation du système bancaire et financier doit conduire à recentrer les banques sur leur mission de financement de l’économie réelle.
Des obligations de service public doivent être assumées par toutes les banques, afin d’offrir à tous les ménages un service bancaire universel et d’assurer leur contribution au financement du logement social et des PME.
Tous les ménages devraient pouvoir bénéficier d’un forfait à un prix abordable leur permettant d’obtenir une carte bancaire, de recevoir, transférer ou retirer de l’argent au guichet, par Internet ou dans un distributeur automatique.
Par ailleurs, les obligations des banques en matière de financement du logement social et des PME devraient être renforcées. En particulier, le taux de centralisation du livret A, dont la distribution est désormais assurée par toutes les banques, devrait être maintenu à un minimum de 70%. Le financement des PME par les banques, qui doit théoriquement être amélioré par la loi de modernisation de l’économie, devrait faire l’objet d’objectifs chiffrés précis et suivis, sous peine de restitution des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Une politique économique au service de l’égalité républicaine et de l’environnement
La limitation de la spéculation et le retour des banques à leur métier de base doit s’accompagner d’une réorientation de la politique économique. Il est urgent de mieux répartir les gains de productivité entre le capital et le travail, de réduire les inégalités de revenus et d’orienter les activités des entreprises vers le développement durable.
La politique budgétaire doit être revue à l’avantage des revenus salariaux, ce qui passe par une hausse de la taxation des revenus des capitaux. Par ailleurs, l’impôt sur les revenus des ménages les plus riches devrait être augmenté et les exonérations strictement limitées. Enfin, les entreprises ne devraient pouvoir bénéficier d’exonérations ou de subventions que sous conditions sociales et environnementales.
Ces propositions n’ont rien d’utopique. Elles sont nécessaires pour que l’égalité républicaine puisse exister dans un cadre économique redéfini.
AGRICULTURE : LE MAïS SUR LA TEMPE DES PAYSANS
25-02-2011
L’image du salon de l’agriculture 2011 sera belle et bien celle de cette affiche où un homme braque un épi de maïs sur sa tempe. Une image qui fait polémique car si son but premier est de dénoncer les OGMs, louable cause, ce que elle suggère en fait c’est qu’un épi de maïs, OGM ou pas, tue. Car à ce jour, on ne peut distinguer visuellement un épi de maïs, d’un maïs OGM ou même d’un maïs bio.
Le diable est dans les détails, mais lorsque le monde paysan est déjà à l’agonie, il ne s’agit pas de faire des mélanges douteux qui ne résoudront rien.
L’association France Nature Environnement en commanditant cette affiche a fait une erreur de casting : au lieu de mettre un citoyen lambda braquant un épi de maïs sur sa tempe, ils auraient dû placer un agriculteur. Car la réalité est celle-ci : qu’ils cultivent ou non des OGMs, nos agriculteurs sont au bout du rouleau. Et là, ils auraient mis dans le mille, car chaque jour en France un agriculteur se supprime.
La question dépasse celle des OGMs et ne date pas d’hier. Si aujourd’hui les agriculteurs se suicident, c’est qu’ils sont criblés de dettes, des dettes qu’ils contractent pour produire toujours plus, selon les directives qui leurs sont données, et écrites par des vendeurs de produits chimiques. Des agriculteurs qui vendent à perte, étranglés doublement : par la grande distribution et par la spéculation mondiale qui font la loi sur les prix. Quand aux engrais, et produits phytosanitaires, ils sont de plus en plus chers, car il faut coute que coute produire plus quand on ne peut savoir d’un mois sur l’autre ce que l’on pourra gagner. C’est une spirale infernale, dont le producteur ne sort pas gagnant. Et nous subventionnons cette agriculture là depuis 50 ans !
A cette échelle, osons parler de suicide de masse assisté.
Quand le miracle du productiviste tourne au cauchemar
Dans les années 60, le contexte était autre : il fallait garantir l’autosuffisance alimentaire. Il fallait donc inciter les paysans à augmenter leurs surfaces et leurs rendements. La PAC a vu le jour dans ce but : axer l’agriculture sur un modèle productiviste grâce aux récents développements de la mécanique, et aussi l’émergence de produits phytosanitaires. Alors la PAC a commencé à donner des subventions pour que les paysans se convertissent, puis des ingénieurs se sont rendus dans les champs pour former le monde agricole à la révolution productiviste. Dire que ce n’était pas nécessaire serait hypocrite, pour produire plus, il fallait être plus performant et même le plus simple jardinier amende son carré de potager. Mais adossées à ces subventions, un certain nombre de règlementations sont venues orienter la production ainsi que le métier agricole pour aboutir à la généralisation des pratiques intensives et mécanisées, dépendantes d’énergie et de produits phytosanitaires et d’engrais le tout utilisé à outrance et polluant également à outrance. Un tel système en place rapporte mais pas à ceux qui produisent, à ceux qui vendent engrais, tracteurs, pesticides, semences, ou fruits et légumes.
Le métier de la terre a profondément changé : nous sommes passé du monde paysan, qui vient de paysage, et qui nourrit donc un rapport sémantique direct avec l’environnement, au monde agricole qui a industrialisé et uniformisé l’usage de la terre. Vaniteux comme nous sommes nous autres les humains, nous n’avons pas pris en compte que ce substrat n’était pas qu’une vache à traire, mais au contraire un organe vivant très subtile, un écosystème.
Dans les années 30 déjà, les précis d’agriculture mettaient en garde sur l’usage des engrais de synthèses, phosphates et azotes qui venaient de voir le jour. Sans les rejeter au contraire, ils avisaient de connaître au mieux sa terre pour la complémenter de ce dont elle manquait en fonction de ce qu’elle allait porter. Bref d’ajuster ses amendements en fonction des besoins. A l’époque, bien qu’imprécise, la microbiologie du sol s’enseignait dans les écoles agricoles naissantes. Aujourd’hui, cette matière est totalement absente, et la terre est un substrat dont l’ingénieur agricole se sert pour faire pousser des espèces tropicales inadaptées.
Si encore les agriculteurs en vivaient, si encore c’était une activité rentable ! Mais c’est loin d’être le cas, les subventions agricoles maintiennent à peine les agriculteurs dans leurs terres. Sans elles, ils auraient sans doute mis la clé sous la porte. Les meilleurs dopants du monde ne peuvent pas éternellement augmenter les rendements. Nous avons atteint la phase descendante de la production agricole, car à force, la terre est devenue stérile, trop utilisée, trop polluée. L’apport massif de fertilisants, phytosanitaires, sans parler de l’émission de CO2 due à ces produits issus de la pétrochimie ruinent les écosystèmes (pollution des sols, réseaux hydriques, et érosion de la biodiversité) et à terme stérilisent les exploitations elles mêmes, quand elles n’ont pas déjà stérilisé ses exploitants.
Les productions augmentent, les revenus chutent
L’Europe consacre près de la moitié de son budget annuel à subventionner un modèle d’agriculture qui coule. En France, les revenus des produits agricoles ne cessent de baisser : -20% en 2009, -10% en 2008.
Malgré les 10 milliards qu’elle reçoit chaque année en subventions, l’agriculture française décline. La concurrence internationale, la financiarisation des échanges et la pression des centrales d’achats et multiples intermédiaires sur les prix font sombrer les revenus. Sur les étals, en revanche, les produits agricoles sont en constante augmentation. Et peu importe qu’ils soient bourrés de produits chimiques, et de pesticides, ils ont l’air parfait, nous payons le prix et surtout nous avalons ces salades jusqu’à 11 fois arrosées de produits chimiques lors de leur croissance.
Quand à l’agriculture bio, de quoi parlons-nous exactement ? De 3% de la production française !
L’agriculture bio augmente peu et ne bénéficie pas des mêmes subventions européennes que l’agriculture conventionnelle.
Chaque année : 10 milliards d’euros vont à l’agriculture française, dont seuls 50 millions se destinent au bio. Les producteurs français ne couvrent pas les besoins de consommateurs français, et nous sommes contraints d’importer du bio, qui n’est certainement pas de la qualité française, dont le cahier des charges est très strict !
Nombreux sont les agriculteurs qui aimeraient se convertir au bio. Mais l’aventure est risquée, c’est un nouveau métier à réapprendre, qui prend quelques années avant de donner vraiment ses fruits. Ne méprisons pas les agriculteurs conventionnels, ils sont nombreux à n’en plus pouvoir des pratiques intensives et des produits chimiques qu’ils utilisent. Ils sont les premiers souffrants en ligne pour ramasser moins de 1000 euros mensuels dettes non comprises. Seulement, se convertir au bio, c’est sauter dans le vide quand on est déjà criblé d’emprunts, et que des décennies durant on vous a promis l’eldorado agricole à renfort de phytosanitaires. Qui étaient-ils, il y a 30 ans, ces agriculteurs pour tenir têtes aux ingénieurs du privé adoubés par les ministères et leurs propres syndicats, qui les poussaient à utiliser leurs pesticides et leurs engrais polluants ?
Qu’en savions-nous vraiment des pollutions qu’engendrerait l’usage massif de tous ces produits ? Alors que les paysans ont des siècles durant sculptés les paysages, nous avons dit aux agriculteurs de tout raser, de s’endetter et de cultiver du maïs chimique à perte de vue sinon ils ne recevraient pas leurs subventions. C’est ça la réalité : un paysan et son épis de maïs sur la tempe. Et bientôt ce sera un maïs OGM.
Réformer la PAC en 2013 : notre seule chance
Dans le contexte actuel, il nous reste peu de temps pour agir.
Mais nous avons une opportunité à saisir : la réforme de la PAC en 2013. Par les aides financières qu’elle octroie et les règlementations qu’elle a su imposer, la PAC peut orienter l’agriculture vers des pratiques bien plus durables. C’est un outil qui a démontré sa redoutable efficacité, il faut désormais l’accorder aux enjeux contemporains environnementaux et sanitaires. Les propositions sont simples : il faut inclure dans les critères d’octrois de subvention les services rendus à l’environnement par les exploitants. Il est urgent de favoriser l’agriculture bio sur l’agriculture intensive, et la conversion au bio.
Des mesures simples qui pour voir le jour exigeront de mettre à la porte les lobbies agricoles qui font la loi, et de leurs demander des comptes pour la pollution planétaire qu’ils engendrent.
A l’autre bout de la chaîne, il faut lutter contre la concurrence déloyale qui tire les prix vers le bas : les normes françaises sont parmi les plus strictes sur les produits tout comme ses moyens de productions. Or la plupart des importations ne respectent pas ces normes. C’est à la fois une concurrence déloyale et un risque sanitaire.
Il nous faut aussi très sérieusement revoir les circuits économiques : promouvoir et créer des circuits courts et indépendants des marchés financiers ou des distributeurs, règlementer le circuit de la grande distribution, obliger la transparence et l’étiquetage pour le consommateur sur les marges des intermédiaires, les méthodes de production, les kilomètres parcourus et les coûts sociaux. On achète bien son lave linge grâce à une étiquette énergie : osons demander ces mêmes étiquettes sur les étals.
Le chantier est immense et l’issue des présidentielles l’année prochaine aura un impact direct sur le sort de notre agriculture. Nous avons vu ce que la droite n’a pas été capable de faire à la fois pour nos cultivateurs et pour notre environnement. Les grenelles ont été le moyen de tuer dans l’œuf les revendications citoyennes et environnementales en faisant croire aux français qu’un machin de plus allait régler la question. Nous avons été bernés, sauf que la question est grave. Depuis 2006, nous assistons à des émeutes de la faim dans le monde car les spéculateurs parient sur des matières qui ne sont pas premières mais vitales. Depuis une dizaine d’année, les fabriquant d’engrais, de semences et de phytosanitaires achètent des terres arables partout sur la planète. Si nous ne maintenons pas en France nos agriculteurs, ce sont eux qui bientôt rachèteront nos champs et nous nourrirons grâce à leurs OGMs.
Réagissons ! Tandis que de l’autre côté du monde, la Chine achète des champs en Afrique, en France un agriculteur se suicide, et nos ministres défilent au salon de l’agriculture flatter les
croupes des vaches à lait: une journée classique sur la Terre.
DEPENDANCE, 5° BRANCHE ET DIGNITE
25-02-2011
L’allongement de la durée de la vie, en moyenne trois mois d’espérance de vie gagnés chaque année dans notre pays depuis plus de dix ans, est assurément une excellente nouvelle. Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé que nos parents et grands parents.
Toutefois il convient de relativiser très rapidement notre enthousiasme car ce supplément d’existence ne se répartit pas équitablement entre tous. Il y a d’abord une inégalité de genre, mais pour une fois que celle-ci est favorable aux femmes, il ne parait pas absolument urgent d’en prévoir la compensation. Plus graves et plus permanentes sont les inégalités d’espérance de vie variables selon les classes sociales.
Arrivé à 60 ans il nous reste entre 20 et 25 d’existence en moyenne mais c’est souvent 10 à 15 pour les moins favorisés et 25 à 30 pour les cadres et professions intellectuelles.
Ceci rappelé, cet allongement de notre durée de vie fait naitre un problème nouveau, celui de la dépendance. C'est-à-dire l’incapacité pour une personne d’accomplir seule les taches les plus élémentaires de la vie quotidienne, comme se laver, s’habiller, se préparer un repas etc.… La dépendance n’est pas un phénomène nouveau par sa nature, certaines personnes en situation de handicap et quelques personnes âgées vivent dors et déjà cet état de dépendance, ce qui est nouveau c’est l’accroissement de telles situations. Le nombre de personnes qui ont ou auront besoin d’une assistance permanente dans notre société va considérablement augmenter.
Nicolas Sarkozy a décidé d’ouvrir le débat de la dépendance et de son financement pour ce printemps et bien qu’il ait annoncé que toutes les possibilités étaient ouvertes, on ne peut s’empêcher de craindre le pire. Les récentes déclarations de François Baroin, Ministre du budget ou de Laurence Parisot Présidente du MEDEF dessinent déjà les contours du projet gouvernemental. Une assurance privée obligatoire pour tous les français au lieu de la création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale (les quatre premières étant : l’assurance maladie, l’assurance vieillesse, les allocations familiales et les accidents du travail).
C’est là une autre version de la politique sociale constante au sein de la majorité actuelle. Elle arrive après une réforme profondément injuste et inefficace du régime de retraite, qui n’a pas réglé le problème mais qui permet déjà aux assureurs de saliver sur les juteux contrats que signeront ceux qui le peuvent dans l’espoir de maintenir un niveau décent de retraite. La politique du Gouvernement conduira à créer, au profit des assureurs, une rente garantie par l’Etat à l’image du système de retraite imposé par les disciples de l’école de Chicago au Chili après le coup d’Etat de Pinochet. Intéressant paradoxe que celui d’un Etat qui offre la garantie aux assureurs privés et à leurs actionnaires, de bénéficier d’une contribution obligatoire !
Que se passerait-il si la solution UMP MEDEF était adoptée ?
Il faut bien reconnaître, qu’en matière de dépendance, nous sommes encore un peu dans le flou, car pour avoir une idée précise du besoin, il faut maitriser plusieurs paramètres. D’abord le coût de la prise en charge d’une personne nécessitant cette assistance ; là nous savons que c’est autour de 1500 - 2000 euros par mois. Ensuite, se pose la question de la prévalence de l’état de dépendance dans la population générale, c'est-à-dire du nombre de cas et enfin, celle de l’espérance de vie des personnes se trouvant dans cette situation. Cela paraît un peu froid voire cynique mais tout chiffrage sérieux nécessite une connaissance statistique de ces deux dernières données.
Comme notre connaissance est imparfaite, nous manquons du recul du temps, les assureurs prendraient un maximum de précautions et limiteraient les risques le plus possible.
Cette assurance serait donc relativement surfacturée et coûteuse. Plusieurs catégories de français se dégageraient ; d’abord les indépendants et les retraités aisés qui pourraient acquitter cette dépense sans trop de difficultés. Ensuite, les salariés des grandes entreprises qui pourraient bénéficier de contrats collectifs relativement raisonnables et être ainsi couverts dans des conditions acceptables ; cela pourrait également concerner les agents de la fonction publique à la différence près qu’il n’y aurait probablement pas de participation de l’Etat employeur et que la part restant à charge du cotisant serait plus lourde. Puis les salariés des PME qui devraient probablement faire face seuls à cette dépense.
Enfin resteraient tous les précarisés, demandeurs d’emplois, retraités modestes, travailleurs pauvres, petits exploitants agricoles etc. qui devraient consentir des sacrifices importants pour souscrire cette assurance obligatoire ou contractualiser des garanties au rabais, insuffisantes pour faire face au coût réel de la dépendance.
Selon que aurez été riche ou misérable, votre avancé en âge pourrait être digne ou sordide.
Car c’est bien de cela dont il s’agit. L’assurance dépendance a pour fonction de garantir à chaque femme et à chaque homme vivant dans ce pays de pouvoir terminer sa vie dignement, comme un membre à part entière de la Communauté. Pour y parvenir, nous devons nous battre pour la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale. C’est d’abord techniquement la solution la plus raisonnable ; car si on répartit le risque sur toute la population, on profite au maximum de l’effet de mutualisation. Ensuite, c’est le meilleur moyen de rétablir un peu de justice sociale en calculant l’effort contributif sur les revenus de chacun et non sur son facteur de risque potentiel.
Enfin, la création de ce cinquième risque pourra être complétée, une fois le niveau nécessaire acquis pour tous, par des assurances complémentaires couvrant des éléments de confort. Les mutuelles et Groupes de protection sociale paritaire, entreprises de personnes sans actionnaires, pouvant se charger efficacement de cela.
DECHETS : LE RETARD FRANCAIS
21-01-2011
Seule une politique volontariste permettra la valorisation de nos déchets.
Les militants écologistes ont ouvert les yeux de tous sur l’une des plus grandes aberrations de la société de consommation : le gaspillage. Ils ont dénoncé et lutté contre les pratiques souvent irresponsables et parfois délictueuses de gestion des déchets ménagers par les collectivités locales.
Les premiers, ils ont alerté l’opinion sur la montagne de déchets produits par nos sociétés : environ une demi-tonne de déchets ménagers par habitant en France, le double provenant de l’activité économique.
Ils ont expliqué que ces déchets inutiles, encombrants et coûteux à faire disparaître pouvaient aussi, si on les valorisait, devenir un gisement de matières premières recyclables, de matières organiques fertilisantes, d’objets réutilisables… et une source d’activité et de revenus.
Or les statistiques sur la valorisation des déchets en France sont implacables : nous progressons si lentement que nous occupons la queue du pelotons des pays européens !
De leur côté, les citoyens ont très bien accepté les consignes de tri qu’on leur demandait d’effectuer à leur domicile, au travail ou dans l’espace public.
Alors comment expliquer le retard français dans la lutte contre le gaspillage? Pourquoi notre pays ne parvient-il pas à répondre à un impératif à la fois environnemental et économique et à une réelle demande sociale ?
La réponse est très simple : l’option la plus « économique » d’un point de vue strictement financier et à courte vue demeure la mise en décharge.
Elle sert aussi les intérêts des entreprises qui gèrent ces centres d’enfouissement. Les taxes mises en place par l’Etat après le Grenelle de l’environnement se sont avérées inefficaces pour pénaliser la mise en décharge.
Nous vivons dans une économie concurrentielle. Ces entreprises ont baissé leurs marges et les prix sont aujourd’hui, dans certaines régions, plus bas qu’auparavant !
Ainsi, personne n’est vraiment pressé d’agir, au-delà des belles opérations de communication.
Trop d’intérêts sont en jeu et rien ne change…
Les pays nordiques, la Suisse et quelques autres ont eu la volonté de mener une politique radicale qui leur a permis de valoriser environ 70% de leurs déchets.
Ils ont tous appliqué la même solution : l’interdiction de l’enfouissement des déchets.
Nous devons avoir le courage et l’ambition de faire de même.
Le programme des écologistes et de la gauche devra être clair sur ce point.
Si nous voulons faire cesser le gaspillage des ressources contenues dans nos déchets, il faudra mettre un terme à leur enfouissement dans notre pays au terme des cinq années de législature.
Nous dépasserons ainsi les mauvais compromis et les fausses solutions qui défigurent nos paysages, polluent nos sols et nos rivières, génèrent massivement des gaz à effet de serre et, il faut bien le dire, gangrènent notre démocratie.
UNE AUTRE DIPLOMATIE EST-ELLE POSSIBLE ?
21-01-2011
Esquisse de leçon à propos de la gestion de la crise tunisienne par les autorités françaises.
La réaction pitoyable du gouvernement Français et du président de la République devant la révolution populaire tunisienne rajoute une nouvelle ligne à la liste des ratages de la politique étrangère française en Afrique et au Proche-Orient.
’histoire retiendra que la France, et avec elle l’ensemble des puissances occidentales, n'était pas aux côtés du peuple tunisien au moment crucial de son combat pour la liberté et la démocratie. Elle retiendra également son incapacité à s'adapter et à anticiper le changement. La France aura été le dernier soutien (ou avant dernier, car heureusement, il y avait Kadhafi) du dictateur, aveuglé qu’elle était par l’apparente bonne santé et la croissance économique, dont elle espérait récolter les fruits, et cela au prix d’une flagornerie de la classe politique dans son ensemble envers le dictateur et son régime.
Cet épisode ne va que confirmer la perte d’influence et de crédibilité de la diplomatie française dans le monde et sur le continent africain en particulier.
Mais si l’on procède à une rapide introspection, qu’est ce que l’attitude de la France vis-à-vis du dictateur tunisien révèle en profondeur ?
La médiocrité d’une grande majorité de notre classe politique ? Son manque de vision ? La fragilité de ses valeurs ? Sa compromission ?
Certainement
L’imprévisibilité de cette révolution née de l’exaspération d’une jeunesse livrée à elle-même, sans leader ni idéologie, mais avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies comme détonateur ?
Aussi
Les vieux réflexes de la « françafrique » et de ses réseaux encore debout, qui ont conduit les politiques étrangères françaises officielles et officieuses depuis l’indépendance de l’Afrique à asseoir et maintenir les pires dictateurs possibles, afin d’assurer l’accès des multinationales françaises aux ressources naturelles et stratégiques ?
Essentiellement
Le fait que la politique étrangère française reste un domaine réservé (plus encore ici que dans les autres démocraties occidentales), donc par nature ne faisant pas l’objet d’un débat suffisamment nourri, notamment au Parlement ?
Forcement
Les limites de notre réseau diplomatique, subissant, incapable structurellement d’être proactif, de soutenir des alternatives aux dictatures, à l’instar du limogeage de Jean-Christophe Ruffin, ambassadeur écrivain éphémère, considéré comme trop critique vis-à-vis du Sénégal par le Chef de l’Etat de son pays de résidence , Abdoulaye Wade ?
Assurément
L’attitude du gouvernement français démontre également à quel point il semble prisonnier d’un horizon qui s’arrêterait à l’alternative entre la défense de ses intérêts versus sa vocation universaliste ? La France oscille entre un discours enflammé (mais peu crédible) sur les droits de l’homme, le « pragmatisme » de sa diplomatie, et la sacro-sainte invocation du principe de « non ingérence » dans les affaires intérieures d’un pays. Difficile exercice de contorsion qu’elle s’impose, mais qui finalement paralyse son action.
Ce que démontre la gestion de la crise tunisienne, c’est que la « realpolitik », invoquée par les gouvernements, n’a rien, en fait, de réaliste ni d’efficace. Elle n’a en tout cas pas permis d’éviter à la France de « perdre l’Afrique », pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Antoine Glaser et Stephen Smith (1) et ce, au détriment des Etats-Unis, de la Chine et de certaines puissances émergentes comme le Brésil.
En Tunisie, les récents développements amènent à penser que les Etats-Unis ont joué un rôle déclencheur dans le départ d’un dictateur qu’ils avaient contribué eux-mêmes à installer il y a 25 ans…reléguant La France au rang de simples spectateurs.
Bref, il est urgent d’inventer une nouvelle posture, un nouveau discours, de nouvelles valeurs ainsi qu’un nouveau mode opératoire pour redonner du crédit à la France dans ses relations extérieures. L’Afrique y occupant une dimension toute particulière.
Le chantier est immense, mais il pourrait partir des postulats suivants :
Premièrement, tenir compte de l’évolution du monde globalisé: le métier de dictateur séculaire est, sous l’effet de différents facteurs (fin de la guerre froide, circulation de l’information avec les NTIC, développement des échanges commerciaux, poids des diasporas, embryon de justice internationale,…), plus difficile à exercer qu’avant, il est donc aussi de en plus d’être inacceptable politiquement, stupide (plus en plus risqué) de soutenir une dictature.
Deuxièmement, considérer qu’un soutien durable et continu à la société civile et aux aspirations des peuples à épouser les valeurs démocratiques sera plus payant le moment venu que la volte-face maladroite et contre-productive.
Troisièmement, s’interroger sur la notion d’ « intérêt », et en particulier « d’intérêts économiques ».
Est-on sûr par exemple que l’implantation d’une grande surface française dans un pays quelconque bénéficiera à l’économie et à la société française ?
Sera-t-elle productrice d’emplois et de richesse sur notre territoire ?
Vecteur de diffusion de nos valeurs et de notre « modèle de société » ?
A-t-on réellement évalué l’impact « positif » sur notre économie de la mise à feu et à sang d’un continent par les pétroliers français trente ans durant ?
La réponse est non.
Cependant, les très grandes entreprises françaises ont réussi à faire croire que la somme de leurs intérêts correspondait à l’intérêt général de l’économie française.
Cette hypothèse est discutable ou tout du moins elle n’est pas généralisable. Trouver des processus « gagnant-gagnant» à la manière des brésiliens qui connaissent d’importants succès commerciaux avec les médicaments génériques. Il y a sans doute ici matière à réflexion sur la structure et la finalité de notre commerce extérieur.
Quatrièmement, s’interroger sur nos interlocuteurs.
La France doit légitimement entretenir des relations avec les pouvoirs en place quels qu’ils soient mais elle doit désormais aussi s’adresser à la jeunesse africaine, et être à son écoute (46 % de la population à moins de 16 ans)
Cinquièmement, redevenir un sanctuaire, une référence, pour les élites en devenir des pays du sud.
Les démocrates, les intellectuels ne sont pas encore une espèce en voie de disparition sur le continent africain mais ils sont largement menacés, notamment par l’islamisme radical. Beaucoup se sentent abandonnés et trahis par l’Occident. Il serait donc bienvenu de repenser notre politique vis-à-vis des futures élites en s’appuyant sur un réseau diplomatique qui gagnerait en influence.
Enfin, il faut bien sûr réformer, intensifier, prioriser l’aide au développement qui jusqu’à présent a plutôt donné l’impression d’être tout à la fois un puits sans fond et une goutte d’eau dans un océan d’indigence.
La démocratie en Afrique et au Maghreb a encore un long chemin à parcourir.
Espérons que la France et l’Europe sauront l’accompagner et l’aider à éviter les nombreux écueils qui se présenteront à elle. Pour cela, il nous faudra faire preuve à la fois de lucidité, de courage et de volonté politique au sein de l’Union pour la méditerranée qui pourrait enfin se trouver une finalité et un projet politique ???
(1) Comment la France a perdu l’Afrique, Antoine Glaser et Stéphan Smith, Calmann Lévy, 2005
DELTA DU NIGER : LA MAREE NOIRE PERMANENTE
14-01-2011
Depuis 50 ans, l’exploitation du pétrole au Nigeria provoque une catastrophe humaine et écologique majeure, loin des impératifs du développement durable et des caméras.
Pire que la marée noire de l’été 2010 dans le Golfe du Mexique ?
S’il est difficile d’en mesurer les dégâts avec précision, il est certain que le Nigeria subit depuis plusieurs décennies une pollution massive et quotidienne due aux fuites provenant de plate-forme pétrolière off shore.
Les chiffres fournis par l’ONU et Amnesty International sont terribles.
Entre 1970 et 2000, 7 000 fuites recensées ont provoqué l’écoulement de 3 millions de tonnes de pétrole brut. Les autorités nigérianes elles-mêmes évoquent 7 000 marées noires pendant cette période et plus de 2 000 sites majeurs de pollution. En mai 2010, en une semaine, 4 millions de litres de pétrole se sont encore répandus dans le delta du Niger. Chaque année, la zone connaitrait l’équivalent de la catastrophe de l’Exxon Valdes de 1989, quand 50 000 tonnes de pétrole s’étaient déversées dans la mer en Alaska.
Plusieurs milliers de kilomètres sont souillés, les réserves de poissons sont menacées d’anéantissement et les nappes phréatiques atteintes. Les populations locales, déjà démunies, consomment de l’eau et des aliments pollués et voient leurs terres agricoles détruites. 31 millions de personnes subiraient les conséquences de la pollution.
Si le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole, cette manne n’a pas profité aux populations et a ruiné l’écosystème, au mépris des principes élémentaires du développement durable. Le Delta du Niger, ancien sanctuaire écologique qui a nourri les populations pendant des siècles, est chaque jour un peu plus dévasté.
Face à cette catastrophe quotidienne, la notion de responsabilité environnementale mise en avant dans la communication des groupes pétroliers reste lettre morte.
En 2009, Amnesty International a mis en cause l’industrie pétrolière (Shell, principal opérateur dans la région, mais aussi Total, Exxon Mobil, ENI ou Chevron), qui n’a entrepris aucune opération de dépollution. Pour minorer sa responsabilité, Shell rappelle que l’Etat nigérian est actionnaire majoritaire dans les consortiums locaux et pointe du doigt les sabotages ou attentats, qui seraient, selon l’entreprise, à l’origine de 50 à 80 % des fuites de pétrole.
En 2010, le rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement confirme l’action de groupes armés de trafiquants prélevant illégalement de l’or noir pour le revendre au Nigeria et à l’étranger.
Toutefois, selon Environmental Rights Action, la branche nigériane des Amis de la Terre, ces exactions n’expliqueraient que 15 % des fuites de pétrole, le reste étant provoqué par des défaillances des équipements.
Le nouveau président du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan, élu en mai 2010, s’est déclaré déterminé à mettre fin à la pollution. En attendant, le pétrole continue, chaque jour, de s’écouler.
La catastrophe écologique qui frappe le Nigéria n’appelle pas qu’un constat attristé à distance. Elle nous concerne tous, en tant que consommateurs de pétrole et aussi parce qu’elle illustre le fonctionnement du capitalisme mondialisé dans lequel nous vivons. Les groupes pétroliers représentent des capitalisations boursières colossales, dont dépend une partie importante des retraites ou des supports de placement de certains pays comme la Grande Bretagne (17 % des pensions servies aux britanniques en dépendent) ou la France (Total est une valeur vedette de la cote qui draine une part importante de l’épargne des français sous forme de SICAV, Fonds généraux des compagnies d’assurances, supports divers…).
La pollution du Delta du Niger pose également de façon aiguë la question de l’application du principe pollueur-payeur. Les compagnies pétrolières sont évidemment redevables des dégâts liés à une exploitation irresponsable des ressources. Elles doivent financer la dépollution, la reconstitution des eux et des terres et prévenir de nouvelles marées noires.
Mais qui les y contraindra ?
Le cas Nigérian met en effet en évidence la nécessité d’une puissance publique forte pur garantir l’application des principes du développement durable.
Un Etat faible ou défaillant ne peut rien face aux seuls intérêts privés, surtout si ils sont si puissants. La question qui se pose est bien alors celle de la régulation écologique internationale, à travers la création d’une véritable organisation mondiale de l’environnement ou des initiatives fortes prises par l’ONU et l’ensemble de ses membres, pour reconnaître et défendre les richesses naturelles comme des biens publics mondiaux inaliénables.
SOMMET DE CANCUN : L’ONU SAUVE LES MEUBLES, MAIS PAS ENCORE LA PLANETE
17-12-2010
Le sommet s’ouvrait sans grand espoir mais se termine un peu mieux que prévu. L’accord signé entre les 200 pays participants ne sauvera pas la Planète mais tout au moins le processus de discussion internationale. Dans les grandes lignes, le texte de Cancun confirme l’objectif de limiter le réchauffement climatique planétaire à +2°C, seuil au-delà duquel nous serions face à un emballement climatique et où les plus sombres prévisions paraîtraient même optimistes. En revanche, il n’impose aucune contrainte et surtout pas celle de quotas d’émissions de CO2, qui auraient sans doute fait fuir la Chine ou les USA du sommet.
Ni progrès, ni recul
La modeste victoire de ce texte ne saute pas aux yeux mais se lit en fait entre les lignes.
Rappelons-nous que nous revenons de loin : le sommet onusien de l’an dernier à Copenhague avait marqué une véritable régression, les climato-sceptiques ayant réussi à remettre en cause le phénomène même de réchauffement climatique. Tous ceux qui voulaient sauver la planète se retrouvaient tout à coup du côté des imposteurs et des menteurs.
Comment parvenir à un accord sur de telles bases?
Cancun a au moins mis tout le monde d’accord et –ce ar écrit- sur l’urgence climatique, et il sera désormais difficile de revenir en arrière. L’autre article positif de l’accord mexicain est de maintenir à l’ordre du jour un sujet sensible : l’aide au pays pauvres à se développer plus vertueusement que nous ne l’avons fait. Le texte jette les bases d’un Fond Climatique Vert – déjà annoncé à Copenhague- qui fournirait 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres à réduire les émissions de CO2 et s’adapter au réchauffement climatique.
Le sommet de Cancun n’aura pas été celui d’engagements ni d’actions concrètes, mais il n’aura pas non plus sonné le glas des discussions internationales sur le sort de la planète comme la plupart le craignaient depuis l’échec de Copenhague.
Les négociations se poursuivront l’année prochaine à Durban, en Afrique du Sud, où la prolongation des accords du protocole de Kyoto, contraignant sur les émissions de CO2 et arrivant à échéance en 2012, ne pourra être écartée cette fois.
Le temps du choix
Une chose est sûre: nous avons déjà pris +1°C depuis l’ère post industrielle dont nous ne voyons que les premiers signes aujourd’hui. D’ici 50 ans, les vraies conséquences vont se révéler et avoir un impact de plus en plus fort sur nos ressources et nos modes de vie. C’est un virage inévitable qu’il faut négocier et des issues positives sont encore possibles.
L’ONU en 2005 a demandé à plus de 1300 scientifiques et experts sur le globe et de tous horizons de plancher sur les scénarios possibles pour notre planète en 2050(1). Ils en ont identifié quatre : du pire au meilleur en fonction des données actuelles et des choix politiques et économiques que les états feront. Le pire scénario est le plus simple : si rien ne change, les états devront renforcer leur sécurité pour protéger leurs ressources de plus en plus rares et convoitées ce qui creusera d’autant les inégalités entre pays et au sein même des nations. Dans ce cas, deux tiers de l’humanité vivrait sous le seuil de pauvreté et 70% des ressources de la planète seraient détruites ou inutilisables. A l’inverse, les scénarios les plus optimistes sont ceux où l’environnement et le maintien des ressources orientent les décisions politiques et économiques. Ceux-là permettront de limiter le réchauffement climatique, de relancer une économie plus vertueuse et de réduire les inégalités.
Fin 2005, lorsque cette étude est parue, leurs directeurs avertissaient que la survenue d’une crise économique mondiale ne jouerait pas en faveur des meilleurs scénarios. Ils ne pensaient sans doute pas qu’elle surviendrait si tôt. Nous sommes aujourd’hui encore à la croisée des chemins, mais le temps presse.
Les nations vont devoir faire un choix, ce qui a été totalement écarté des sommets de Copenhague puis de Cancun.
L’histoire des sociétés humaines (2) tend à nous montrer qu’un dommage écologique est rarement responsable seul du déclin ou de la disparition d’une société. L’issue dépend de la façon dont ces dites sociétés y répondent. L’histoire se répète et gageons qu’à Durban ou ailleurs dans un futur proche vienne le temps des décisions qui nous permettrons de ne pas dépasser les +2°C.
(1) Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005 b. Scenarios, Washington D.C., Island Press.
http://www.maweb.org/documents/document.332.aspx.pdf.
(2) Telle que décrite dans « Effondrement, Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » de Jared Diamond, aux Ed. Gallimard.